
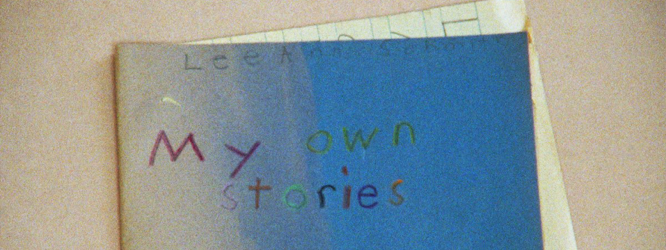
prod. Lee Anne Schmitt
EVIDENCE
Lee Anne Schmitt | États-Unis | 2025 | 76 min | Forum
Film-essai composé de gros plans d’objets anodins que vient enrober la voix douce de la réalisatrice, Evidence nous fait traverser l’histoire coloniale et écocidaire des États-Unis à travers l’expérience personnelle de la réalisatrice, dont le père a travaillé pour la compagnie Olin. Responsable de l’empoisonnement des sols et des citoyen·ne·s américain·e·s, Olin est aussi à l’origine de fortes campagnes conservatrices qui ont déterminé le paysage politique actuel.
Evidence est un film sur ce qu’on lègue, ce qu’on transmet — parfois de manière volontaire, comme lorsque les grandes familles bourgeoises consolident leur capital de génération en génération ; parfois sur le plan de l’oppression systémique, comme dans le cas de l’esclavage et de son impact transgénérationnel sur le plan traumatique comme économique ; parfois contre son gré, en termes d’idéaux, partagés ou non, sur les valeurs qu’on inculque à ses enfants ou sur ce qu’est le geste de parentalité lui-même. Mais ce que rend visible Lee Anne Schmitt, au fond, c’est que même si ces divers aspects de la transmission sont différents, ils sont interconnectés. Qu’ils se contagient les uns les autres, que ce soit sciemment, par des campagnes de propagande droitistes ou par le lobbying pour le démantèlement des programmes sociaux, parfois inconsciemment ou involontairement, tandis qu’on reproduit malgré nous ce qu’on a reçu, là aussi, malgré nous.
Tout comme l’eau et les terres que les compagnies comme Olin n’ont pas pris le soin de protéger de la destruction orchestrée par leur soin, nos héritages nous contaminent et sont contaminés. C’est de cela que nous héritons en même temps que d’un monde crépusculaire : d’une interrelation déjà surdéterminée par le passé.
Schmitt le soutient à travers ses mots, mais aussi par la succession d’images et de mots — souvent des livres, qu’elle pointe du doigt, comme si elle les accusait, mais aussi comme si elle les inscrivait dans un registre probatoire — regardez, c’est là. Son discours joue alors avec un régime de la preuve (traduction du titre, evidence), mais aussi de la flagrance (stating the evidence) des crimes contre le vivant, qui passe dans le film par un processus d’historicisation de la misère sociale, affective, environnementale comme construction politique.
Dans Evidence, la caméra, immobile, capte un objet lui aussi presque toujours immobile. Dans la salle, je me dis : Lee Anne Schmitt filme comme on prend une photo, en prenant garde à ne pas bouger — ou si peu. Mais à bien y penser, je ne suis pas si sûre du bien-fondé de cette pensée spontanée. Si les poncifs barthésiens de l’histoire de l’art veulent que l’image photographique soit un geste qui fixe le temps, l’arrête dans sa course, le travail de Schmitt, son attention, me semblent redonner tout l’espace à la durée, à une continuité qu’il s’agit de reconnaître sans la réifier. Evidence ne capture pas des bouts de présent qu’il passéifie ; il les libère afin qu’ils puissent s’échapper vers un futur plus désirable. (Laurence Perron)

prod. Rosa von Praunheim Filmproduktion
THE SATANIC SOW
Rosa von Praunheim | Allemagne | 2025 | 85 minutes | Panorama Dokumente
Une curiosité qui a atterri sur mon giron un peu malgré moi, une œuvre intrigante que j’avais sacrifiée aux aléas de la billetterie, mais qui s’est retrouvée parmi ma sélection pour les mêmes raison — ou d’autres, potentiellement astrologiques. Un film dont le titre évoque le mysticisme queer d’un Kenneth Anger ; son auteur dira d’ailleurs dans un extrait d’archives que la colère est l’une des plus grande forces créatives disponibles aux artistes, sentiment qui fluctue ici, mais se résorbe dans la douceur onirique de quelques mises en scène orgiaques à la gloire d’orifices anaux pénétrés de fleurs et de « fracassants manches remplis de délices ». The Satanic Sow, c’est un documentaire autobiographique à propos du cinéaste allemand Rosa von Praunheim, incarné à l’écran par le comédien Armin Dallapiccola, qui s’excuse d’emblée d’être « un vieil homosexuel obèse » dur à regarder. La substitution est mise de l’avant dans un processus d’entrevues qui évoque Les Ordres (1974) de Michel Brault, où les interprètes s’adressent au public en mentionnant le rôle qu’ils jouent dans une diégèse dès lors docufictionnelle, annonçant une œuvre qui réfléchit au pouvoir représentationnel, mais surtout transformatif du cinéma, et qui nous propose une incursion privilégiée dans le cerveau bordélique de l’auteur.
Constitué d’un mélange confus d’entrevues, de mises en scène oniriques ou fantasmatiques et d’extraits médiatiques impliquant von Praunheim (dans des séquences non-identifiées tirées de ses films ou dans des archives télévisuelles), The Satanic Sow ressemble à un fourre-tout où s’entrepénètrent l’horreur et la beauté qui caractérisent l’existence du cinéaste. En vrac, il est donc question d’homophobie meurtrière et d’opprobre généralisée (un détracteur écrit dans une lettre vouloir remettre en fonction les fourneaux crématoires pour y brûler les homosexuel·le·s), mais aussi des rapports problématiques que le sujet entretient avec la religion et avec sa mère, qui apparaît sous les traits de l’actrice Anne Rathsfeld pour s’entretenir avec son alter-ego. Il est aussi question de camaraderie et de liberté créative dans la cultivation d’un imaginaire fantasmatique anti-hégémonique, où Dallapiccola se retrouve au lit avec des jeunes éphèbes ou avec son urologue, qu’il convie à des jeux érotiques décadents. C’est un acte incantatoire de communion artistique avec des marginaux réels ou imaginaires, des dentistes nudistes et des étudiants en philosophie qui réclament le droit de baiser en public (comme des animaux), de même qu’avec son voisin, endeuillé de la mort d’un mari avec qui il a vécu 54 ans. C’est l’occasion aussi de faire de la politique, en refusant les codes standards de la narration documentaire, en montrant des corps boursouflés qui demeurent des objets de désir, en célébrant l’acte de chanter l’hymne national dans le cul de quelqu’un et en proposant de se suicider pour donner du courage aux autres. « Nous ne sommes pas des héros », dira von Praunheim sous les traits de Dallapiccola, « nous sommes seulement beaux ». Et c’est cette beauté extravagante qui constitue ici le plus grand acte de résistance du film. (Olivier Thibodeau)

prod. Vertov
TIME TO THE TARGET (CHAS PIDLOTU)
Vitaly Mansky | Ukraine, Lettonie, République tchèque | 2025 | 179 minutes | Forum
C'est d'abord la question du temps qui hante le plus récent documentaire du cinéaste ukrainien Vitaly Mansky. Le temps qu'il faut à un missile russe pour atteindre la ville de Lviv, où se déroule le film, mais aussi le temps de la guerre qui s'étire jusqu'à relever pour ses habitants de la funeste routine. C'est aussi par le temps que s'impose cette mise en scène d'un quotidien hanté par les signes du conflit, à environ mille kilomètres de la ligne de front. Du haut de ses trois heures, Time to the Target installe patiemment son sentiment d'oppression. Il y a d'abord l'élan de résistance initial, la solidarité d'un peuple s'unissant contre l'envahisseur. Puis la lassitude qui émerge, au fur et à mesure que les minutes de silence se succèdent et que les corps s'accumulent dans le cimetière de la ville. Il a d'abord fallu déterrer les victimes d'anciennes guerres pour enterrer celles de la nouvelle. Éventuellement, la situation dégénère. L'équipe du cimetière ne suffit plus à la tâche. Même le fossoyeur en vient à perdre la foi. Sur leur photo, les morts sont souriants. Les jeunes hommes qui assistent aux funérailles devinent le sort qui les attend.
Au gré d'une ellipse, une année passe. De l'autre côté de ce fondu au noir, les visages et les postures ont changé. Avec pudeur, Mansky capte leur usure. C'est le prix de la résilience sur l'âme humaine qu'il saisit au fil de ses déambulations dans Lviv. Même dans les écoles, il n'y a plus que la guerre, les discours patriotiques que l'on martèle. Les gens partagent leurs histoires d'horreur. L'espoir qu'il s'agit d'entretenir coûte que coûte paraît de plus en plus fragile, de plus en plus forcé. Battant tristement au vent, les drapeaux perdent progressivement leur éclat. Parfaitement conscient de la complexité de la situation, Mansky détaille les mécanismes de la machine de guerre, l'effet de ses rouages et leur fonctionnement. Il ne s'agit pas, pour lui, de produire de la propagande. Sa solidarité l'amène ailleurs, le force à confronter le désespoir qui s'installe. Même à la naissance d'un enfant, on ne trouve plus qu'à dire : « Les gens qui meurent doivent être remplacés. » Les membres de la fanfare militaire rêvent du jour où ils ne joueront plus seulement à des enterrements. Lors de la discussion suivant la projection de son film, Mansky nous apprend que les musiciens ont depuis été envoyés au front. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. Cattet-Forzani / Kozak Films
REFLET DANS UN DIAMANT MORT
Hélène Cattet et Bruno Forzani | Belgique, Luxembourg, Italie, France | 2025 | 87 minutes | Compétition
Après leurs plongées dans les eaux du giallo (Amer [2009], L’étrange couleur des larmes de ton corps [2013]) et du western spaghetti (Laissez bronzer les cadavres [2017]), le duo belge Hélène Cattet et Bruno Forzani reste fidèle à son projet d’implosion kaléidoscopique du langage filmique du cinéma de genre, en s’attardant dans ce nouvel opus à délier les mailles du film d’espionnage. On retrouve bel et bien une trame initiale, une situation d’accroche, celle de John Diman (Fabio Testi et Yannick Renier, partageant le rôle entre les deux époques de sa vie), espion vieillissant installé dans un hôtel côtier où avait mal tourné une mission accomplie quelques dizaines d’années plus tôt. Mais cette piste s’avère rapidement labyrinthique, et la possibilité d’une progression narrative ne fait que s’estomper au fil d’une infinie course-poursuite mémorielle qui brouille constamment les pistes entre le souvenir et le lieu à partir duquel il est généré. Et cet investissement primaire dans le tissu de la mémoire s’avère une stratégie parfaite pour creuser la question de la subsistance de formes cinématographiques de série B qui se fait le fondement du travail de Cattet et Forzani.
En se débarrassant de l’ambition narrative qui marquait leur dernier film (et il faudrait ici entendre par ambition quelque chose de plus banal : le désir simple, car habituel, de raconter une histoire linéaire), Reflet dans un diamant mort assume pleinement son statut de pur objet de plaisir scopique et d’érotisme cruel. La première séquence propose un superbe jeu de transition qui fait se succéder, par le regard désirant du vieil espion sur une jeune femme en maillot allongée sur la plage, le spritz versé dans le verre de l’un à la marée montante dont l’écume se dépose sur le corps de l’autre. Entre l’image qui fait contraste et celle qui traverse, entre ce qui tranche — talon haut muni d’une lame, bague en diamant cisaillant une joue — et ce qui fait passage — gadget permettant d’observer à travers les murs, portrait dont les yeux dissimulent un véritable regard humain — la grammaire usuelle de l’espionnage souligne la manière dont le cinéma de Cattet et Forzani s’intéresse avant tout à créer des moments de glissement esthétique, à partir d’une tension répétée entre la fluidité de leur montage et la violence de leurs coupes franches. Les corps aussi deviennent des cloisons à franchir, une accumulation hypnotique de masques et de combinaisons, de peaux qui, transpercées, en révèlent une seconde. Reflet dans un diamant mort canalise finalement son attention sur la tension entre alliance et rivalité, cumulant les double-jeux et les agents doubles dans les trajectoires partagées entre le protagoniste et sa rivale, la fugitive Serpentik (Maria de Medeiros, entre autres) qui, dans sa combinaison noire, rappelle immédiatement le culte Danger Diabolik de Mario Bava (1964). Ce sont leurs chassés-croisés qui permettent finalement au film de poursuivre le mode de sa surenchère par la relecture de la relation classique entre l’espion à la masculinité dignifiée et son amante qui n’attend qu’à le trahir, devenue ici un lien abstrait entre les deux personnages qui trouvent une complétion mutuelle dans l’antagonisme. C’est à travers cette insistance thématique que le film peut alors prendre une forme qui problématise sa source esthétique d’une façon plus explicite que les œuvres précédentes du duo, et qu’il réussit à se déplacer, agile, sur la fine ligne entre hommage et réécriture. (Thomas Filteau)

PARTIE 1
(Night Stage, Friendship's Death,
Spring Night, The Swan Song of Fedor Ozerov)
PARTIE 2
(Köln 75, Living the Land,
Queerpanorama, Fwends)
Woche der Kritik — Back to the Class Issue
PARTIE 3
(Evidence, Satanic Sow,
Time to the Target,
Reflet dans un diamant mort)
PARTIE 4
(Wrong Husband, Mapping Lessons,
The Memory of Butterflies, Magic Farm,
Underground)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
