

prod. Panama Film KG
BLUISH
Lilith Kraxner, Milena Czernovsky | Autriche | 2024 | 83 minutes | Panorama international
Dans un des fragments de son récit poétique Bluets, exploration intime de son rapport à la couleur bleue et à sa teneur affective, l’autrice Maggie Nelson suggère que si les hommes « get blue, [...] women get the deepest blue » (Nelson, 2009). L’impénétrabilité des relations mystérieuses entre le bleu, la mélancolie et le féminin, les réalisatrices Lilith Kraxner et Milena Czernovsky l’investiguent à leur tour dans Bluish, leur second long métrage, et ce, avec sensibilité et méticulosité.
Le film brosse le portrait d’Errol (Leonie Bramberger) et de Sasha (Natasha Goncharova), deux étudiantes en arts visuels qui, bien qu’elles participent au même cours en ligne et qu’elles assistent au même vernissage à leur insu, ne se connaissent pas et jamais ne se rencontreront au cours du film. La caméra nous présente d’abord le corps d’Errol — le personnage le plus mélancolique du récit — au moment vulnérable du réveil, puis entamant tranquillement sa journée par des actions simples et rituelles : vérifier ses messages sur son téléphone, arroser son calathea. Les nombreux et longs plans fixes sur le visage pensif de la jeune femme nous font rapidement sentir qu’elle gravite péniblement entre son lit, le cabinet du médecin, ses différents boulots et la piscine municipale, qu’elle visite non pas pour s’entraîner mais pour soigner son corps certainement tendu par toutes les pensées tributaire du blues qui assaillent son esprit. Sasha, étudiante russe arrivée il y a peu à Vienne, n'intègre quant à elle le récit que plus tard, alors qu’elle transporte une plante en tous points similaires au calathea d’Errol (dans ce film, les choses, les mouvements, les couleurs communiquent beaucoup plus aisément que les gens) dans l’appartement qu’elle partage vraisemblablement avec son copain, personnage effacé qui ne lui démontre nul signe d’affection, et dont on ne verra pas même le visage. Grâce à son tempérament extraverti, Sasha tente tant bien que mal, (et bien qu’elle ne parle pas allemand) de rencontrer de nouvelles personnes en fréquentant vernissages et autres événements sociaux. Si les caractères des jeunes femmes dont les vies quotidiennes forment le tissu de ce film fragmentaire sont aux antipodes, ce qui les rapproche immanquablement est sans nul doute un profond sentiment de solitude.
Réinvestissant l’esthétique de l’ordinaire préconisée dans Beatrix (2021), leur premier long métrage, Kraxner et Czernovsky proposent ici un film au scénario plus ambitieux et au caractère profondément intermédial qui fait la part belle à une multiplicité de supports artistiques. On y retrouve entre autres une performance musicale du trio de chanteuses Les Reines Prochaines, une errance virtuelle dans la capitale autrichienne par le biais de Google Maps, l’intégration de l’œuvre de réalité virtuelle Glitchbodies de l’artiste Rebecca Merlic, plusieurs scènes de vidéoconférences sur Zoom, de discussions téléphoniques et de moments où Errol et Sasha sont absorbées par divers écrans.
Grâce à une attention minutieuse aux corps des personnages (leur peau, leurs gestes, leurs mouvements, leurs regards) ainsi qu’aux silences, aux couleurs et aux sons qui habitent l’espace, Bluish nous offre un délicat portrait de la génération Z, forte d’un désir de proximité et de connexion difficile à assouvir au lendemain d’une pandémie, à une époque où l’événement de la rencontre est simultanément facilité et entravé par la technologie, son caractère naturel et spontané s’étant amenuisé. (Frédérique Lamoureux)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 15 octobre à 18h15 (Cinéma Moderne)

prod. Medium Density Fibreboard Films
MATT AND MARA
Kazik Radwanski | Canada | 2024 | 80 minutes | Encounters
Un petit miracle s’est produit durant le visionnage de Matt and Mara. Toutes les violences que l’œuvre semblait impliquer se sont évaporées dans un souffle sérénissime qui a guéri mon âme fatiguée, et j’ai repensé à Tower (2012) avec une certaine affection, tout en constatant avec plaisir la maturation que le réalisateur torontois Kazik Radwanski a effectué depuis. Car s’il s’agit ici d’un film à la mise en scène nerveuse, presque abrasive, faite de cadrages serrés sur le visage d’une protagoniste féminine écrite par un homme, que courtise un autre homme, de surcroît un pédant écrivain new-yorkais, ce film n’en est pas moins adorable. On est sceptique un peu au début, tant la séquence d’ouverture, où Matt fait violemment irruption dans la vie de Mara, une écrivaine en hiatus et professeure de littérature mariée à un musicien, est agressante, surtout que les allusions à la « fragilité » de l’héroïne laissent présager une dynamique de genre rétrograde. Or, il n’en est rien, puisque l’ensemble distille une surprenante sensibilité, à travers des dialogues savoureux et vraisemblables, livrés par deux merveilleux interprètes qui nuancent admirablement la caractérisation de leurs personnages, parvenant même à nous faire tomber sous le charme bourru de Matt, tout en inscrivant la vulnérabilité de Mara dans une complexité appréciable.
La relation flirteuse entre Mara et Matt, insistant dans ses velléités de renouer avec elle après des années d’éloignement est empreinte d’une tendresse exempte de romantisme et d’un réalisme émotionnel que complémente la superbe capacité d’observation du réalisateur, attentive aux regards et aux touchers. Radwanski capte ainsi avec désinvolture un genre de pittoresque du quotidien qui rend d’autant plus palpable les beautés et les aléas de la relation. On résiste surtout au piège de l’étranger cathartique, venu rescaper l’héroïne éplorée de son mariage malheureux, posant une lumière tout aussi douce sur son mari, qui nous apparaît certes comme un être imparfait, mais néanmoins tendre. Rien n’est jamais tout blanc ou tout noir dans les relations de couple, et c’est cette zone de gris que le film cultive, dont découle d’ailleurs sa puissance humaniste. La mise en abîme de la création artistique, elle aussi, est sauvée d’une certaine lourdeur discursive par la nature anodine des dialogues et l’opposition philosophique des deux protagonistes en matière de caractérisation littéraire. Selon Mara, il s’agirait d’arrogance que d’imaginer la vie intérieure d’une autre personne que soi, tandis que, pour Matt, le processus réside dans la synchronisation de son imagination et de sa stupidité. Mais qu’en est-il de Radwanski ? Il faudra voir son film pour se faire une idée. (Olivier Thibodeau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024
Prochaine projection : 16 octobre à 20h45 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. Jeonwonsa Film
A TRAVELER’S NEEDS (YEOHAENGJAUI PILYO)
Hong Sang-soo | Corée du Sud | 2024 | 90 minutes | Competition
Il y a deux types de films de Hong Sang-soo. Il y a ceux qui s’inscrivent dans une sorte de mythologie affective, une logique cumulative, où sont récompensées la loyauté auteuriste et la connaissance méta et extratextuelle de l’œuvre. Une considération du scandale entourant, par exemple, la relation extraconjugale entre Hong Sang-soo et Kim Min-hee, ajoute à la charge émotive de certains des films de sa vaste filmographie (la mise à nu paroxystique On The Beach At Night Alone [2017], le tragique The Day After [2017], ou encore The Novelist’s Film [2022] et sa déclaration d’amour). De même pour la tristesse palpable de Grass [2018] ou Hotel By The River (2018). Puis il y d’autres films de Hong Sang-soo où on observe plutôt le cinéaste creuser une idée technique (le parti pris hors foyer de l’émouvant In Water [2023]) ou structurelle (l’appartement de Walk Up [2022] et sa logique circulaire). La première catégorie n’est pas nécessairement « meilleure » que la deuxième, mais elle est souvent plus satisfaisante sur la durée. A Traveler’s Needs s’inscrit dans la deuxième, mais il s’agit également d’un des films de Hong les plus rigolos, voire loufoques, depuis un moment. Construit autour d’un personnage improbable, joué par Isabelle Huppert à la manière d’un farfadet français surgi de on-ne-sait-où, il s’agit d’une comédie de mœurs quasi-slapstick, où cette voyageuse va-nu-pieds, légèrement saoule tout du long, enseigne le français avec une méthode particulièrement désinvolte, voire insouciante et arrogante. Telle une poète vagabonde, elle titube d’une situation à l’autre, créant la structure même du film (une de ses leçons est, par exemple, répétée mot pour mot). Il s’agit ici pour Hong d’une occasion de pousser ses effets vers un registre purement comique, tandis que les enjeux émotionnels se déploient plutôt en filigrane, lorsque les élèves esseulés tentent de s’expliquer dans une langue étrangère, riche en quiproquos. Formellement, Hong continue de porter l’épure vers de nouveaux retranchements, retrouvant avec la facture numérique dégradée de In Water et In Our Day (2023), ce qui, en soit, vaut le détour. Par contre, si son film propose encore l’ébriété comme une forme de confort et renoue avec l’idée de pouvoir aimer qui l’on veut, il faudra attendre le prochain pour être totalement ému. (Ariel Esteban Cayer)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024
Prochaine projection : 16 octobre à 18h30 (Cinéma du Parc)

prod. Gema Films / Mira Film / Sutor Kolonko
REAS
Lola Arias | Argentine / Allemagne / Suisse | 2024 | 82 minutes | Forum
Imaginez un instant que Orange Is the New Black (2013-2019) soit un espace de projection fantasmatique non pas pour les spectateur·ice·s en quête de représentations sensationnalistes et sexy de la carcéralité, mais plutôt pour les personnes anciennement emprisonnées qui éprouvent le besoin d’exorciser leurs traumas en mode hyper-pop, et vous commencerez à avoir une idée de ce qu’est Reas. À mi-chemin entre le documentaire et la comédie musicale, le nouveau film de Lola Arias transforme l’établissement pénitentiaire en scène de spectacle. Ce faisant, il ne glamourise ni ne mélodramatise les existences de ses participant·e·s, mais réitère de manière exubérante cette réalité aussi simple que dure : la prison est un espace de contrôle des corps qui passe par la surveillance et la scrutation constantes. Cette contrainte scopique auxquelles sont habituellement soumises les détenues est à la fois prise en compte et contrecarrée dans une enfilade de reconstitutions de scènes réelles (toujours jouées avec une douceur camp qui oscille — parfois de manière un peu malaisante certes — entre esthétisation et mise à distance sécuritaire de la violence par la représentation) qui entretisse les récits personnels à une libération du mouvement par la danse, le jeu, le sport et l’amour. Ce dernier, quelle que soit la forme qu’il prend, est au centre des histoires vécues par les protagonistes. Sans les recouvrir d’un vernis niais, les interprètes mettent à l’avant-plan la solidarité et les liens qui se tissent entre femmes plutôt que l’éternelle compétitivité agressive dépeinte dans la majorité de nos fictions sur la détention. Il y a de la tendresse même dans le conflit chez Arias. À travers la succession de décors très artificiels et de scènes excessivement chorégraphiées (aucun rôle n’est interprété par une actrice professionnelle), Reas nous incite à voir la prison pour ce qu’elle est : un dispositif qui fabrique la culpabilité, un leurre servant à simuler la justice. Ce qui n’empêche pas de vraies relations de fleurir en son sein. (Laurence Perron)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 15 octobre à 19h00 (Cinéma du Parc)

prod. Jeonwonsa Film
BY THE STREAM
Hong Sang-soo | 2024 | Corée du Sud | 111 minutes | Les incontournables
Jeonim (Kim Min-hee), professeure d’art dans une université exclusivement féminine de Séoul, invite son oncle Sieon (Kwon Hae-hyo), ancien acteur et dramaturge, à mettre en scène une saynète théâtrale avec un groupe d’étudiantes. Les dix ans qui se sont écoulés depuis leur dernière rencontre semblent faire écho aux dix jours restants à Sieon pour monter la pièce. Si la période semble aussi courte, c’est que l’oncle remplace un précédent metteur en scène, récemment renvoyé après qu’on eut révélé qu’il avait entamé des relations avec trois des actrices faisant partie de la troupe. On dit souvent que le cinéma de Hong s’apprécie spécifiquement dans le contexte d’une vue d’ensemble, d’une accumulation comparative de sa prolifique production (comme en témoignent les deux films du réalisateur qui se côtoient dans la programmation du FNC). Film après film, les constantes — le caractère quotidien des conversations, les zooms rudimentaires, puis les confessions partagées après quelques verres de soju ou de makgeolli — finissent par servir d’arrière-plan, et ce sont les variations qui s’observent avec un peu plus d’acuité. Toujours fidèle à ses obsessions, l’auteur fait donc de By the Stream un récit sur la recherche du lien et sur l’impulsion de l’agencement amoureux, mais plus surprenamment, Kim Min-hee y émerge comme une figure de quiétude solitaire et la créatrice d’espaces sécuritaires de partage intime pour ses étudiantes, archétype rare dans une œuvre globale centrée sur les chemins retors qui nous mènent au lien.
Hong maîtrise encore ici un art de l’éclat, de l’intrusion affective qui nous prend par surprise après qu’il eut savamment mis la table pour qu’une image simple, à l’allure d’abord inoffensive, devienne le catalyseur d’une émotion en attente. Dans By the Stream, c’était pour moi la silhouette de Kim Min-hee qui, en déplacement vers une rencontre officielle avec le doyen de l’Université, se penche pour récupérer une énorme feuille tombée d’un arbre pour la brandir dans le vent, du bout des bras. Cette infime séquence quasi dansée et d’une majestueuse modestie, recoupe tant d’autres images des films de Hong où Kim Min-hee se révèle comme figure de contentement radical conjuguée à des actes mineurs de création ou de jeu. On l’avait deviné dans sa comptine naïve entonnée dans Claire’s Camera (2017), ou dans ses éloges de la marche quotidienne dans The Novelist’s Film (2022). L’insistance sur l’importance d’un lieu pour soi, celui du travail dans l’atelier où Jeonim s’affaire à ses œuvres textiles, ou des moments où elle s’assied près du cours d’eau attenant à l’université pour dessiner, font de By the Stream un exemple étonnant d’observation d’un isolement serein dans une cinématographie habituellement contrainte à l’exploration de tensions latentes et d’incompréhensions quotidiennes seulement taries lorsque coule l’alcool qui détend les corps et explicite les confrontations. Un « freeze frame » final sur l’actrice, alors qu’elle rejoint ses proches qui l’appellent après qu’elle eut passé un moment solitaire près de la rivière, insiste encore sur la nécessité d’un espace impartageable, un lieu où il n’y aurait simplement rien à montrer aux autres puisqu’il s’agit, simplement, d’un temps pour soi. (Thomas Filteau)
Prochaine projection : 16 octobre à 20h30 (Cinéma du Parc)
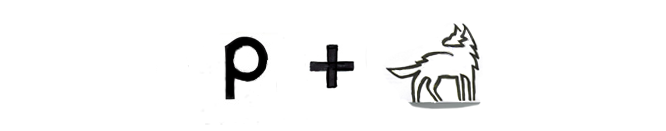
PARTIE 1
(Rumours, The Hyperboreans,
Pepe, The Box Man)
PARTIE 3
(Bluish, Matt and Mara,
A Traveler's Needs, Reas,
By the Stream)
PARTIE 4
(Lázaro de noche,
All the Long Nights, Patient #1,
Favoriten, The Real Superstar)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
