
MA NUDITE NE SERT A RIEN
Marina de Van | France | 2019 | 85 minutes | Temps Ø



prod. Ancine/Arte France Cinéma/CinemaScópio Produções/Globo Filmes
BACURAU
Kleber Mendonça Filho | Brésil/France | 2019 | 132 minutes | Temps Ø
Kleber Mendonça Filho fait du cinéma de résistance. Son premier long métrage, Les Bruits de Récife, proposait déjà une observation critique des changements de son pays à travers les tribulations d’un groupe de gens de la classe moyenne habitant un quartier en transformation, observation qu’il poursuit encore plus loin dans son film suivant, Aquarius, qui suivait le même genre de transformation, mais en y plaçant de l’avant un personnage fort qui résiste (incarné par l’incroyable Sônia Braga). Bacurau, son premier film écrit et réalisé à quatre mains, et qui s’est vu attribuer le Prix du jury à Cannes, poursuit dans la même direction mais laisse décidément la subtilité de côté pour faire place aux symboles plus évidents. Y apparaissent donc des personnages moins développés que dans les films précédents du cinéaste, qui épure son récit et s’avère plus direct dans ce qu’il a à dire. Filho nous avait déjà démontré son goût pour le thriller dès son premier long métrage mais il l’assume ici totalement dans Bacurau, qui souligne à grands traits ses influences (John Carpenter en premier lieu) et se dote d’une violence caricaturale et stylisée qui l’inscrit totalement dans le cinéma de genre vers lequel le cinéaste tend plus timidement depuis ses débuts. Le portrait social y est placé dans un film qui tend vers le western aux accents chamaniques. En ce sens, il suit les traces de John Carpenter en se servant du cinéma de genre pour critiquer le pouvoir et la politique.
Dans un village perdu dans les régions du sertão brésilien, tant isolé géographiquement que virtuellement et n’étant plus alimenté en eau, une communauté vit du mieux qu’elle le peut son quotidien alors que des gangsters, des politiciens et des mercenaires viennent compliquer la situation. On s’intéresse au barrage, à la terre, à y déplacer ses habitants qui sont un obstacle à l’enrichissement de certains autres. Le film s’ouvrira et se fermera sur un enterrement, entre les deux, on aura droit à une mise en tension maîtrisée et une riposte jouissive.
Si Aquarius avait un personnage principal riche, complexe et inspirant, démontrant de façon intelligente et subtile toute sa force contre le pouvoir qui cherche à se débarrasser d’elle, Bacurau voit ses personnages et son propos réduits à l’essentiel, laissant toute la place à l’affect et le choc de sa charge contre la corruption et l’injustice. Et si le côté simple, épuré et moins subtil que ses prédécesseurs peut surprendre, il fait parfaitement écho à la situation politique de son pays en renvoyant à la gestion grossière de celui-ci et les conséquences de ses incompétences. Le film en devient une réaction enragée, une proposition de résistance à tout ce qui s’y passe et à tout ce que l’avenir présage. Le film se situe d’ailleurs dans un futur proche où l’on découvre une communauté coupée du reste du pays et de ses lois, qui s’organise et fonctionne ensemble à travers rituels et traditions. Il ne semble pas y avoir de rapport de force entre les gens et chacun y semble égal, socialement et économiquement, qu’il soit matriarche, cultivateur ou opérant dans le crime. Chacun y est bienvenu à s’exprimer dans le respect commun et à vivre tranquillement dans cet équilibre communautaire. Cependant, on commence depuis peu à y observer des drones aux allures de soucoupes volantes, pour ensuite avoir droit à la visite d’un politicien en campagne électorale. C’est alors le lieu lui-même qui semble disparaître des cartes avant que des étrangers aux motivations louches débarquent, installant la méfiance dans ce groupe qui découvrira les connexions souterraines de toute l’intrigue. C’est alors que les habitants de Bacurau démontrent leur résistance et que le film frappe fort. Malgré l’étrange foutoir qu’il peut aussi parfois être, s’en allant dans sans doute trop de directions à la fois, Bacurau reste un film divertissant qui sent l’urgence de la riposte. Non sans humour, il est une charge violente envers l’exploitation du Brésil et la corruption qu’on y retrouve. Un film cathartique nécessaire, qui démontre une communauté solidaire qui se tient prête à faire tomber des têtes. (David Fortin)

prod. Skellig Rock
FAMILY ROMANCE, LLC
Werner Herzog | États-Unis | 2019 | 89 minutes | Les incontournables
Depuis au moins une décennie, Werner Herzog nous offre principalement des brouillons de grands films, des esquisses juste assez prometteuses pour que l’on puisse deviner le chef-d’œuvre hypothétique qu’aurait pu être l’objet inachevé occupant sa place par procuration. Family Romance, LLC ne fait pas exception à la règle, partageant ses idées parfois brillantes sous une forme qui déroute tant pour les bonnes que les mauvaises raisons. Mais cet inachèvement fait partie du jeu. Par moments, Herzog lui-même semble se demander ce qu’il veut dire, partageant avec le spectateur sa propre perplexité.
Voici donc un autre drôle de film, qui sonne à la fois étrangement faux et terriblement juste, sur de vraies relations humaines qui sont fausses – ou sur de fausses relations humaines qui sont vraies, c’est selon. Fidèle à son habitude, Werner Herzog brouille la frontière entre fiction et documentaire dans ce portrait d’une compagnie japonaise qui loue des acteurs pour se substituer aux membres manquants des familles faisant appel à ses services. Dans une certaine mesure, la qualité approximative de l’exécution contribue ici à l’ambivalence ambiante : la sensation de « réel » est parasitée par l’incertitude que nous inspirent ces images, qui semblent parfois provenir de l’avenir plutôt que du présent.
Visuellement, Family Romance, LLC est un assemblage hétéroclite de plans tournés un peu n’importe comment et d’images aériennes trop léchées, prises par des drones survolant Tokyo. La juxtaposition des deux crée une impression de flottement, qu’amplifient le rythme méditatif et le ton laconique de l’ensemble. Il se dégage de cet enchaînement de scènes, liées les unes aux autres par un fil narratif fragile, une mélancolie qui pourrait être qualifiée de paisible. Comme si Herzog avait une bonne fois pour toute accepté la folie du monde, cherchant dans les situations inusitées qu’il capte une humanité que l’on pourrait de prime abord croire absente.
Inspiré par un véritable fait divers, que l’on s’imagine bien Herzog découvrir au fil de ses errances sur internet, Family Romance, LLC cultive cette fascination amusée avec laquelle le cinéaste semble toujours approcher les sujets les plus improbables. Sa posture décalée s’avère parfois difficile à saisir, nourrissant la confusion au lieu de la dissiper. Naturellement, l’humour absurde côtoie ici le malaise. Au final, on ne sait d’ailleurs pas trop quoi penser du film. Ce qui n’est pas, en soi, une mauvaise chose. Car le résultat final nous habite encore bien longtemps après la fin de la projection — les questions qu’il laisse en suspend étant, au fond, plus importantes que l’œuvre les posant. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa/Telewizyjna i Teatralna
MONUMENT
Jagoda Szelc | Pologne | 2018 | 109 minutes | Temps Ø
Projet de fin d’études pour la vingtaine de jeunes acteurs à l’écran, Monument ressemble parfois à un grand exercice de théâtre, où tous ont pour mission de mimer une folie incontrôlable, née d’une affliction mystérieuse qui se révèle finalement comme un mécanisme narratif grossier*. Ceci dit, même si la conclusion « surprise » du film ne méritait pas ici la note de passage dans un cours de Scénarisation 101, tout le reste de la production est extrêmement soigné, proposant au spectateur une atmosphère étrange et suffocante digne des meilleurs films d’horreur. Par moments, face à l’exceptionnel travail chromatique déployé devant nous, face à la virtuosité dérangeante du coloris scénique, du mélange adroit des rouges sanguins, des bleus oniriques et des verts vomi, mais aussi face à la présence oppressante d’une force surnaturelle élusive, je m’imaginais revoir (le vrai) Suspiria (1977), mais par voie du Shining (1980) de Kubrick, ne serait-ce que pour l’hôtel lugubre qui sert de toile de fond. Il existe en effet dans ce film un air de menace qui pèse sur nous dès le premier plan, notamment dans l’éclairage crépusculaire régnant, alors que se révèlent les nombreux protagonistes du récit, jeunes finissants de techniques hôtelières en route pour un stage dans un complexe isolé au cœur de la forêt polonaise. Cette introduction rappelle évidemment l’abc du film d’horreur, mais aussi celui du drame militaire, incarné notamment par la matrone superbe chargée d’accueillir et de diriger les jeunes lors de leur séjour, la « directrice » de l’établissement (Dorota Lukasiewicz-Kwietniewska), pur fantasme S&M avec ses tempes rasées, sa luxuriante crête blonde, ses yeux bleu acier, mais surtout son attitude impérieuse et cruelle à l’égard des laquais, qui la surnommeront d’ailleurs, comme pour rappeler le film d’Argento, « la sorcière ». Or, l’entraînement rigoureux auquel celle-ci soumet ses sujets se meut bientôt en glissage effréné vers la névrose, alors que les vignettes du quotidien ouvrier deviennent de plus en plus étranges, au gré de tableaux hypnotiques d’une horreur glauque et savamment étudiée, butinés çà et là dans les recoins les plus pittoresques de l’hôtel, dont Szelc maximise avec génie le potentiel expressif. Cela dit, puisque c’est la folie grandissante des personnages qui constitue ici la ligne directrice du récit, la structure narrative se révèle forcément lâche, très lâche même, de sorte qu’il semble que les séquences aient pu être montées dans n’importe quel ordre. Qu’à cela ne tienne, l’expérience cinématographique globale est exquise, proposant même une surprenante référence au Wavelength (1967) de Michael Snow, ainsi qu’une adéquation réflexive entre le métier d’acteur et celui des ouvriers d’hôtellerie, dont la « directrice » se dédouble ici en « réalisatrice », et dont le « jeu », destiné à amadouer leurs hôtes, tient lui aussi de la performance théâtrale. (Olivier Thibodeau)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture du Festival international du film de Rotterdam 2019

prod. Barunson E&A/CJ Entertainment/TMS Entertainment
PARASITE
Bong Joon-ho | Corée du Sud | 2019 | 132 minutes | Les incontournables
Vaut mieux en savoir le moins possible avant de s’engager dans le dernier film de Bong Joon-ho, gagnant de la Palme d’Or au Festival de Cannes : comme toujours avec ce cinéaste des plus généreux, le récit semble suivre une trajectoire prévisible avant d’en dévier subitement, moins par des retournements étonnants (quoiqu’il y a de ça) que par des changements de ton habiles (ici le va-et-vient entre l’humour, l’horreur et le drame). La prémisse — une famille pauvre, les Kim, infiltre peu à peu les postes de domestiques d’une famille riche, les Park — semble nous amener vers une critique sociale convenue, sur les différences de classe, l’exploitation des uns par les autres, et de même nous devinons assez tôt que les mensonges dans lesquels s’enfoncent les Kim déboucheront sur des conséquences dramatiques, et sans doute vers une finale où éclatera la violence, dans une illustration sanglante de ces enjeux socio-économiques. En un sens, ces intuitions ne sont pas fausses, mais une fois cette situation de départ bien installée, une fois que Bong nous a familiarisé avec les lieux, qu’il a établi son contraste entre cette maison des pauvres avec sa fenêtre donnant sur une ruelle insalubre et cette maison des riches avec sa fenêtre donnant sur un grand jardin verdoyant, il ouvre une porte qu’il tenait cachée, et nous nous enfonçons dans un nouvel espace sans ouverture vers l’extérieur.
Dès lors, l’humour laisse place au thriller, et le conflit de classe que nous voyions venir, sans disparaître complètement, se complexifie en prenant une ampleur qu’il est difficile de décrire sans tomber dans les spoilers, et même si le film se dirige plus ou moins là où nous l’avions prévu, il le fait d’une manière toujours surprenante. Contentons-nous de dire alors que la mise en scène tire tout ce qu’elle peut de ces espaces – au-delà des oppositions plus évidentes entre l’ouvert et le fermé, le spacieux et l’étroit, notons cette séquence où les Kim deviennent des ombres, obligés de se faufiler à la périphérie du champ, ces multiples scènes jouant sur des personnages tapis, à l’écoute, ou sur le visible, la transparence, et à l’inverse la noirceur d’un hors-champ impénétrable – alors que le scénario multiplie les motifs qui rejoignent les enjeux de la mise en scène — pensons seulement aux jeux de rôle, ceux qui doivent se camoufler derrière un rôle social, mais demeurent identifiables par leur odeur, à l’opposé de ceux qui ont la liberté d’être « eux-mêmes », mais à travers des rôles parfaitement appris, une manière de rejouer les questions de visibilité, de transparence, etc.
Plus que cette ingéniosité formelle, c’est l’humanisme de Bong qui en fait un cinéaste d’exception, l’un des rares capables d’utiliser tout son arsenal de metteur en scène virtuose pour le mettre au service des personnages plutôt que de faire de cette technique un enjeu en soi (il est aidé en cela par des acteurs impeccables, dans des rôles difficiles jouant sur une fine ligne entre le grotesque et le subtil, l’humour et le drame). C’est en alignant ainsi sa mise en scène sur le regard de l’un ou l’autre de ses personnages que Bong en arrive à ces séquences surprenantes, trouvant une densité dramatique là où d’autres auraient joué sur une distance ironique, ou filmant une violence qui glace le sang alors que tout semblait en place pour un délire jouissif et cathartique. En cela, Parasite fait certainement partie des meilleurs films du cinéaste, un retour en forme après un détour un peu plus inégal dans ses productions internationales (Snowpiercer et Okja). Mais même si le film rit de l’art qui fait dans la métaphore (à plusieurs reprises des personnages commentent une roche, puis un tableau d’enfant, en se moquant de la métaphore grossière qu’on peut y lire), il est difficile de ne pas sentir que le propos finit par surplomber les personnages : se situant quelque part entre Memories of Murder et The Host, où la critique sociale s’infiltrait plus subtilement à travers le drame familial, et Snowpiercer et Okja, où cette fois cette dimension était plus frontale et déterministe, Parasite cherche une sorte d’équilibre entre ces deux pôles. Si pour l’essentiel l’entreprise est des plus réussie, le tout apparaît tout de même un peu lisse, trop accompli en un sens — tout est bien à sa place, exactement là où il le faut — alors que le charme singulier des premiers films de Bong reposait au contraire sur un sentiment d’improvisation, ou un ludisme de tous les instants qui cèdent ici la place à quelque chose de plus calculé (ou du moins dont on ressent plus la minutie, qui au fond a toujours été là). On ne s’en plaindra pas trop : en cette année 2019 un peu chiche, difficile d’imaginer plus grand plaisir cinématographique que ce Parasite. (Sylvain Lavallée)
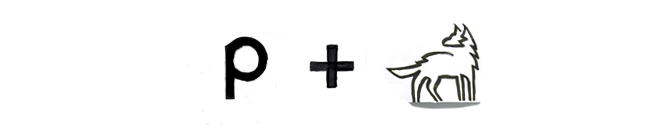
PARTIE 1
(Aren't You Happy?, Die Kinder Der Toten,
Little Joe, Ma nudité ne sert à rien)
Dieu existe, son nom est Petrunya
PARTIE 2
(Acid, Liberté, Serpentário, Soylent Green,
The Vast of Night, Wind Across the Everglades)
PARTIE 3
(Diner, 37 Seconds, Guest of Honour,
J'ai perdu mon corps, Videophobia)
PARTIE 4
(Ma nudité ne sert à rien, Bacurau,
Family Romance, LLC, , Monument, Parasite)
PARTIE 5
(A Hidden Life, Atlantique, The Halt,
Marriage Story, Raining in the Mountain,
Zombi Child)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
