
1 | 2

prod. Yintah Film
YINTAH
Jennifer Wickham, Brenda Michell et Michael Toledano | Canada | 2024 | 125 minutes | Film d’ouverture
Documentaire de lutte épique dont la production s’étend sur une dizaine d’années, Yintah constitue un coup d’envoi retentissant pour la 34e édition du Festival Présence autochtone. Il relate avec une inspirante fougue militante le combat hautement médiatisé des Wet’suwet’en pour protéger leurs terres ancestrales (sur la côte ouest du Canada) contre les envahisseurs de la compagnie Coastal GasLink, armés d’une injonction judiciaire leur permettant d’y bâtir un pipeline, supportés par un gouvernement fédéral avide d’investissements privés. Or, si son titre réfère spécifiquement à l’idée de territoire, c’est le cas de sa mise en scène également qui, en explorant les diverses dispositions du paysage, évoque simultanément les états d’âme des gens qui se battent pour en conserver l’intégrité.
Débordant de séquences familières où des frictions surviennent devant des barricades de fortune entre les manifestant·e·s autochtones et les forces écrasantes de la police et de l’industrie méprisant la souveraineté des Premiers peuples, le film tire aussi son affect d’une poétique du territoire. Ainsi, les plans de drone sur son étendue majestueuse, les images de sa flore pittoresque ou de sa faune sereine nous rappellent un état de félicité d’avant la conquête ; ces images démontrent éloquemment ce que les Wet’suwet’en risquent de perdre, et ce pourquoi ielles doivent se mobiliser. Les sillons et les arbres écrasés laissés sur le sol par la machinerie lourde des employé·e·s de GasLink évoquent des balafres, tandis que les cris des aîné∙e∙s sur fond d’aurores boréales nous donnent à goûter la liberté, tout comme le brouillard enrobant la lande une idée de la confusion provoquée par l’invasion étrangère. Plus largement, ces images démontrent le lien primordial qui existe entre le yintah et ses habitant·e·s, auquel ces dernier·ère·s appartiennent et dont ielles dépendent pour leur subsistance.
Focalisé principalement sur la lutte menée par les gardien·ne·s du territoire, particulièrement les inspirantes et coriaces Freda Huson et Molly Wickham, cheffes héréditaires des Wet’suwet’en, contre l’avancée inexorable des forces du « progrès », le film se déroule en trois temps historiques, qui incluent l’avant et l’après, épisodes qui viennent allègrement nourrir le sentiment d’urgence qui caractérise la partie centrale. Le premier acte décrit les efforts déployés pour guérir les blessures coloniales, en l’occurrence la tentative d’assimilation des Premières Nations effectuée dans les pensionnats autochtones, en réinitiant les jeunes aux pratiques ancestrales et en renouant leur rapport au territoire. On aborde aussi des blessures plus récentes, tel qu’en témoignent les robes rouges qu’on voit flotter un peu partout en souvenir des femmes autochtones disparues ou assassinées, et dont la présence contribue également à un travail de mémoire essentiel. Le dernier acte, lui, s’intéresse à la résilience des intervenant·e·s qui, même après le passage du pipeline, continuent à œuvrer pour la guérison de leurs compatriotes et de leur chez-soi, dont le film dénonce la scarification en nous rappelant (pour la énième fois) toute la violence colonialiste et l’illégitimité morale de l’entreprise capitaliste. (Olivier Thibodeau)

prod. Freedom From Fear
EALLOGIERDU – THE TUNDRA WITHIN ME
Sara Margrethe Oskal | Norvège | 2023 | 93 minutes
Il n’y a rien de particulièrement nouveau dans l’intrigue d’Eallogierdu - The Tundra Within Me de la réalisatrice samie Sara Margrethe Oskal. Rien qu’on ne trouve pas déjà dans des douzaines de téléfilms Hallmark ou de comédies romantiques populaires américaines, cette histoire éternelle de la jeune femme moderne et accomplie qui revient dans son patelin perdu au milieu de nulle part pour se mesurer à l’incompréhension de sa famille traditionnelle et trouver un amour inattendu auprès d’un jeune homme qui a tout de cette vie provinciale qu’elle a voulu laisser derrière elle. Et pourtant, malgré des échos très familiers, tout un monde sépare Eallogierdu de ces films convenus, repus de clichés judéo-chrétiens. Tout un monde qu’on pourrait résumer en deux éléments clés : le fait que le récit se déroule dans un monde autochtone que la réalisatrice connaît bien et le ton sincère et senti que celle-ci donne à son approche.
Contrairement aux romances prévisibles et factices, les enjeux décrits dans Eallogierdu n’ont rien d’inventé ou de superficiel. Sara Margrethe Oskal décrit bien le tiraillement éprouvé par certains jeunes des communautés autochtones aux prises entre l’adhérence stricte aux traditions et le désir de sortir de ce carcan étouffant. D’ailleurs, on reconnaît bien ce déchirement abordé par certains de nos propres cinéastes préoccupé·e·s par les récits autochtones, comme dans le court Sikiitu de Gabriel Allard (2022) ou le Kuessipan de Myriam Verreault, d’après un scénario de Naomi Fontaine (2019). Lena, l’héroïne d’Eallogierdu, est une artiste visuelle montante qui vit à Oslo après avoir vendu son propre troupeau de rennes qu’elle s’estimait incapable de conserver en honorant les coutumes samies. Dans ses tableaux qui allient peinture et collage, elle s’interroge sur la place des femmes dans le monde exigeant de l’élevage. Son contact avec la communauté est difficile, sa mère la première ne comprend pas pourquoi elle a rejeté son héritage, mais ne réalise pas non plus que sa fille elle-même se sent lourdement coupable de ce choix. Au centre d’art sami, d’autres femmes artistes estiment que l’œuvre de Lena pose un jugement sur les femmes propriétaires de troupeaux, alors qu’elle cherche plutôt à exprimer visuellement et métaphoriquement leurs difficultés. De son côté, malgré tous les efforts qu’il met à s’occuper de ses rennes, Máhtte, son amant, n’est pas mieux compris par sa mère, qui refuse de lui confier la propriété officielle de ceux-ci.
Si son récit résonne haut et fort, c’est que Sara Margrethe Oskal l’aborde avec authenticité, solidarité et humanité, évacuant toute forme d’exploitation sentimentaliste de son scénario et de ses images. Ses comédien·ne·s sont naturel·le·s, la lumière hivernale du Grand Nord norvégien est aussi implacable qu’éclatante dans la blancheur des paysages, les rapports avec les animaux sont empreints de respect parce qu’ils sont au cœur de la culture samie, de la nourriture qu’ils procurent aux vêtements qui sont tirés de leur fourrure pour préserver du froid. La cinéaste bâtit les rapports entre ses personnages sans jamais étirer les scènes inutilement, en les filmant de près, sans artifice, pour qu’aucune exagération ne soit nécessaire, qu’aucun tressaillement d’émotion n’échappe à notre regard, sans non plus de montage manipulateur. En fin de compte, en évitant tout ce qui rend les romances conventionnelles si réductrices, elle nous offre un couple qui parvient à trouver une compréhension, un épanouissement et un équilibre libérateurs qui lui permettront de forger une nouvelle forme de relation — l’un·e avec l’autre, avec leur communauté et leurs familles, avec leur passé et leurs traditions samis, avec la société contemporaine juste à leurs portes. (Claire Valade)

prod. Urban Ink Productions
LES FILLES DU ROI
Corey Payette | Canada | 2023 | 102 minutes
Destinée à être présentée sur scène, la comédie musicale Les filles du roi s’est finalement tournée vers le médium filmique en raison de la pandémie de COVID-19. Malheureusement, si ce n’est que cela permette de faire voyager la proposition et d’atteindre un plus grand nombre de spectateurs, on trouve peu d’avantages à voir cette pièce sur un grand écran. De fait, cette version cinématographique ne parvient pas à faire oublier qu’elle est d’abord pensée comme une rencontre avec le public. Une rencontre qui, d’ailleurs, s’annonçait fort prometteuse, car la proposition est bien exécutée et parvient sans conteste à émouvoir, voire à bouleverser, car le courage des personnages suscite de la fascination. Les partitions musicales sont splendides, souvent poignantes, autant sur le plan des paroles et de la performance que des arrangements de cordes qui créent un imaginaire très poétique. Je n’imagine pas combien ces chants gagnent encore davantage en puissance lorsqu’ils sont interprétés en direct, avec la présence du corps et la vibration des voix.
Le Festival Présence autochtone est l’une des trop rares occasions pour entendre des récits narrés par des membres des Premières Nations. Il y a quelque chose de jubilatoire à se faire raconter l’histoire des filles du roi par Corey Payette (scénariste appartenant à la Première Nation de Mattagami), alors qu’elle est toujours mise en scène à travers le même point de vue. Cette portion de l’histoire, celle des jeunes orphelines arrivées par bateau au XVIIe siècle pour peupler la Nouvelle-France, est souvent conçue sous l’angle du catholicisme et d’une colonisation providentielle. Mais les choses sont-elles si différentes ici ? Payette se réapproprie-t-il vraiment cette histoire ?
Bien que l’on mette davantage l’accent sur la primauté des Autochtones sur le territoire ainsi que sur les problèmes causés par l’arrivée des Européens en Amérique, le scénario demeure quelque peu lisse, hollywoodien et centré sur la perspective de Marie-Jean Lespérance, une fille du roi qui se cherche un mari pour passer l’hiver. Kateri et son frère Jean-Baptiste, d’origine mohawk, se lient d’amitié avec elle, une relation pour le moins inhabituelle pour l’époque. C’est avec eux qu’elle poursuivra son chemin en Amérique, défiant ainsi l’autorité coloniale, intrigue qui n’est que très peu problématisée. Si la perspective est résolument féministe, l’approche décoloniale se fait plus timide et on se serait attendu à plus d’audace de la part du cinéaste. Ce qui achoppe, c’est de n’avoir pas cherché à complexifier la performance scénique. La tradition veut que le récit des comédies musicales soit simple, or le cinéma a peut-être besoin d’un peu plus de chair autour de l’os, ou du moins d’une recherche formelle plus aboutie. On se lasse rapidement des trois mêmes lieux de tournage, des quelques cadrages en nature, et des plans très étroits qui donnent une sensation de huis clos — c’est-à-dire une sensation de théâtre filmé. Et on regrette finalement de ne pas être en salle, avec les interprètes. (Sarah-Louise Pelletier-Morin)

prod. IMCINE
VALENTINA OR THE SERENITY
Ángeles Cruz Murillo | Mexique | 2023 | 85 minutes
Le récit sublime et ardu de Valentina or the Serenity est circonscrit entre deux moments de félicité juvénile, alors que nous découvrons initialement la protagoniste titulaire en train de jouer avec son ami Pedro, puis que nous la laissons finalement à son insouciance retrouvée. Entre les deux se déploie l’expérience pénible et déroutante du deuil de son père, mort noyé dans la rivière par un jour de pluie, au sein d’un conte initiatique tragique mais optimiste où elle apprendra non seulement à composer avec la mort, mais aussi à renouer avec ses racines mixtèques. Incompréhension, douleur et beauté font bon ménage au cœur du film, gracieuseté d’une mise en scène qui focalise tout autant sur sa petite héroïne (Danae Ahuja Aparicio) que sur le monde naturel qui l’entoure.
La caméra dynamique recèle ici de somptueuses surprises, s’attardant à des éléments de décor inusités (palissades de bois, fleurs et arbres carbonisés), dont la présence à l’écran nous rappelle l’importance du non-humain au sein des croyances ancestrales de la nation mixtèque, établie sur les états mexicains actuels d’Oaxaca et de Puebla. Tout est affaire de croyances, mais sous l’angle d’un choc historique entre la tradition et la modernité responsable de la confusion et de l’incertitude de Valentina, écartelée entre les enseignements scolaires catholiques et les convictions animistes latentes de ses précurseur·e·s, qui lui font envisager la mort comme une façon de renouer avec son père. Il s’agit d’ailleurs là d’un des éléments les plus poignants du film. Convaincue que l’esprit d’Emiliano fait désormais partie de la rivière qui l’a engouffré après avoir entendu sa voix au milieu des flots lors d’une expérience de mort imminente, la fillette essaie de lui adresser la parole à partir du rivage, apprenant même le mixtèque pour y parvenir ; elle n’hésitera pas non plus à se lancer sous la surface de l’eau dans un effort de communion désespéré, jusqu’à cesser complètement de s’alimenter pour le rejoindre dans l’au-delà.
À l’instar de sa protagoniste, le film est divisé entre deux réalités distinctes mais superposées selon la logique postcoloniale qui régit son existence, se déployant à l’intersection du monde ritualisé des cérémonies chrétiennes et de l’appareil disciplinaire de l’école, où l’on découvre comment aborder la mort en lisant sa définition dans le dictionnaire, et l’univers bordélique de la nature, où différentes forces interagissent de manière symbiotique. C’est le cas du tonnerre, auquel on assimile Valentina, et dont les traces ignées sur la surface d’un arbre éventré sont auscultées lors d’un travelling sublime qui exemplifie le rythme alangui, contemplatif, et la sensualité caractéristique de la mise en scène. C’est le cas de l’eau, source de vie et de mort pour la communauté, mais aussi pour la flore riveraine, qu’on voit renaître en conclusion comme un symbole de renouveau. C’est le cas des fourmis également, leitmotiv astucieux qui, à l’occasion d’une présentation scientifique en classe, servira de pont entre les deux mondes auxquels la protagoniste appartient. (Olivier Thibodeau)

prod. Lightning Mill / North Country Cinema
HEY, VIKTOR!
Cody Lightning | Canada | 2023 | 102 minutes
L’acteur cri Cody Lightning s’amuse ferme dans ce documenteur pseudo-biographique où il interprète un ivrogne raté, empêtré dans le passé, qui se transforme en Fellini de la campagne albertaine. Le récit se déroule dans un univers parallèle où Cody, célèbre pour le rôle du jeune Victor Joseph dans Smoke Signals (1998), n’a rien fait depuis, et continue à se gargariser de son 15 minutes de gloire acquis 25 ans plus tôt. Épave narcissique, il vit des fruits pourris de la nostalgie et de la promesse d’un avenir radieux où il ne se fera plus « voler » de rôles par son ex-collègue et némésis Simon Baker et où il trouvera du financement pour produire la suite épique au film de Chris Eyre qu’il a scénarisée. Forcé de mettre la casquette de réalisateur après un argument avec son ex-copine, dont il jalouse le nouvel amoureux, le jeune et charmant Jackson Thin Elk (Peter Craig Robinson), il s’engouffrera dans un tournage catastrophique grâce auquel il parviendra finalement à émerger de la coquille du sombre Viktor.
Le charisme et l’énergie irrévérencieuse du réalisateur, scénariste et interprète Lightning ont beau nourrir le film, celui-ci bénéficie également d’une mise en scène particulièrement astucieuse, qui jongle habilement avec les codes du documenteur, et d’un scénario qui développe brillamment l’idée de faux semblants. À ce titre, il est important de noter la distinction entre le Victor de Smoke Signals, le Viktor déliquescent du présent film et le Diktor en lequel se transforme ce dernier, alter ego se situant chacun à différents degrés d’une échelle de corruption morale. En effet, s’il s’agit ici de l’histoire d’un acteur revendiquant sa participation à un célèbre conte initiatique, Hey, Viktor! constitue aussi pour lui un conte initiatique, à la recherche de ses devenirs potentiels dans une économie interpersonnelle où il devra apprendre à céder le centre et à abandonner ses rancœurs d’antan pour mieux envisager l’avenir.
Et si l’on s’amuse ferme avec les frasques de l’ami Viktor, la bande sonore et la mise en scène du film recèlent leur lot de surprises jubilatoires. Dès la première séquence, on nous mène déjà en bateau alors que Cody prend la parole et nous raconte sa descente aux enfers à la manière d’un toxicomane dans un centre de réhabilitation, évoquant le crack, la colle et les filles, juste avant qu’on réalise qu’il s’adresse en fait à un groupe de jeunes élèves dans un gymnase. Puis viennent les mises en abîme, qui nous font passer subrepticement de la biographie documentaire au reportage sur le cinéma autochtone en passant par l’émission de pop psychologie à la Dr. Phil et le film de prêtres zombies, incluant des bris constants du quatrième mur, une série d’interprètes jouant des versions décalées d’eux-mêmes et des têtes parlantes aux titres loufoques, au sein d’un joyeux fourre-tout qui module sans cesse nos horizons d’attente et incarne parfaitement l’esprit bordélique de l’idiosyncratique Cody et de son Viktor. À consommer sans modération. (Olivier Thibodeau)
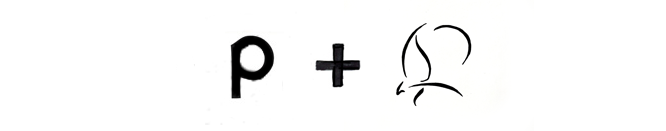
PARTIE 1
(Yintah, Eallogierdu - The Tundra Within Me
Les filles du roi, Valentina or the Serenity,
Hey, Viktor!)
PARTIE 2
(The Land of Forgotten Songs,
Diógenes, Without Arrows,
Yana-Wara, Uproar)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
