

prod. Petit Chaos / Chalk and Cheese Films / et al.
ALL WE IMAGINE AS LIGHT
Payal Kapadia | France / Inde / Pays-Bas / Luxembourg | 2024 | 115 minutes | Les incontournables
Premier long métrage à représenter l’Inde en compétition cannoise depuis 30 ans, le très attendu All We Imagine as Light de Payal Kapadia, cinéaste que l’on connaissait pour son documentaire lyrique A Night of Knowing Nothing (2022), était présenté lundi dernier en première québécoise. Bien que salué par la critique et couronné du Grand Prix au Festival de Cannes, cette première excursion dans la fiction n’a pas réussi à me retenir dans son univers sensuel et onirique, ses forces poétiques et picturales étant trop généralement entamées par un excès de romantisme et une esthétique kitsch dont la présence d’abord mesurée s’alourdit dans la seconde partie du film.
Ce sont de très beaux plans de lieux de transit, de lieux de passage, d’espaces liminaux (wagons de métro, marchés à ciel ouvert, routes saturées de voitures, de camionnettes et de vespas aux feux scintillants) qui nous transportent dans la Mumbai nimbée de bleu d’All We Imagine as Light. Ce n’est donc pas seuls, mais entourés de milliers de visages anonymes que nous intégrons l’univers du film, un univers structuré par les pluies diluviennes et l’atmosphère lourde de la mousson. Malgré l’épaisseur du brouillard, la caméra arrache trois visages de femmes à l’anonymat, ceux de Prabha (Kani Kusruti), de sa collègue et colocataire Anu (Divya Prabha) et de leur amie menacée d’éviction, Parvaty (Chhaya Kadam). Toutes trois infirmières dans un hôpital de la ville, les femmes dédient leur temps et leur énergie à soigner d’autres qu’elles-mêmes, dévotion que le karma ne semble pas prendre en compte puisqu’elles sont toutes confrontées à des situations personnelles qui leur donne l’impression de n’avoir aucune prise sur leur destin. La vie intérieure des trois femmes et ce, bien qu’elles appartiennent à des générations différentes, est donc également affectée par le soleil noir, ou devrais-je écrire bleu, de la mélancolie dont est chargé l’air de Mumbai : Prabha vit dans l’amertume et l’attente déçue du retour de son mari, parti vivre en Allemagne, et dont elle n’a plus aucune nouvelle depuis un an; Anu entretient une relation amoureuse clandestine avec Shihaz, leur confession religieuse respective (elle, hindoue, lui, musulman) leur interdisant d’assumer leurs sentiments au grand jour, et Prabha tente désespérément d’éviter l’éviction avant d’abandonner la cause et de déménager dans son village natal.
C’est peut-être là que les choses se gâtent, lorsque Prabha et Anu rejoignent Parvaty dans sa maison pour l’aider à s’installer. La lumière de l’espoir qui se veut d’abord timide, piétinante, devient alors aveuglante, effaçant les zones d’ombres, les aspérités des corps et des sentiments qu’ils renferment pour faire triompher l’amour, la sororité et l’émancipation, qui sont certes des valeurs importantes pour lesquelles il n’est pas vain de se battre, mais qui résolvent trop facilement les enjeux complexes auxquels étaient confrontées les trois femmes au début du film. En somme, All We Imagine as Light déçoit non pas par manque de beauté, mais par désir, peut-être excessif, de la sublimer. (Frédérique Lamoureux)
Prochaine projection: 20 octobre à 16h30 (Cinéma du Musée)

prod. Brass Door Productions
THERE, THERE
Heather Young | Canada | 2024 | 106 minutes | Compétition nationale
Second long métrage de la Néo-Écossaise Heather Young, There, There continue d’explorer les territoires sociopolitiques qui marquaient son impressionnant Murmur, lauréat entre autres du Prix de la FIPRESCI au Festival de Toronto en 2019. Précarité, isolement, solitude, pauvreté, marginalité, solidarité sont à nouveau au cœur de ses préoccupations et de son récit. Et elle utilise des moyens très similaires pour explorer le quotidien de ses nouvelles héroïnes ordinaires : Ruth, une vieille dame aux prises avec la démence, et son aidante, Shannon, jeune femme enceinte jusqu’aux yeux abandonnée par le père de son enfant. Film modeste, sans vedettes, There, There est aussi sobre et discret que son prédécesseur, mais tout aussi incroyablement précis dans les cadrages, la composition des plans, et les couleurs choisies pour rendre l’univers simple de cette classe économique peu choyée par la vie.
En adoptant à nouveau un format presque parfaitement carré qui lui permet de confiner Ruth et Shannon dans un cadre claustrophobe, même si l’espace filmé est vaste, et en favorisant cette caméra statique qui l’avait si bien servie dans Murmur, Heather Young exacerbe la solitude et l’isolement de ses personnages. Elle cadre donc souvent ceux-ci d’un côté de l’écran dans un espace dépouillé, comme Ruth dans ses rendez-vous avec son médecin (lequel reste toujours hors champ), ou, à l’opposé, au centre d’une pièce ou d’un lieu encombré, comme la vieille femme au milieu de sa cuisine débordée ou Shannon en voiture. Les plans éloignés montrent également les personnages perdus dans de grands espaces, comme Ruth donnant à manger aux pigeons et Shannon à la piste de course, ou au contraire en très gros plan, comme pour mieux capter leurs émotions contenues ou leur détresse. Personne ne prête vraiment attention à ces deux femmes, sauf la réalisatrice, qui est là pour capter leurs petites joies et leurs grandes tristesses.
En s’intéressant aussi aux détails répétitifs de leurs vies (le pain tranché en cubes pour les oiseaux, le contraste entre la vie réglée de Shannon et les vidéos superficielles de sa colocataire, les fleurs des draps de Ruth lavés et changés, le bain, les promenades de plus en plus précaires de la vieille dame dans la ville avec son déambulateur), Heather Young souligne la délicatesse des gestes et l’attention portée par les deux femmes à leur entourage, bien plus qu’à elles-mêmes, mais aussi la subtile affection qui se développe entre elles. Dans la seconde partie du film, la cinéaste établit un parallèle entre Ruth, installée désormais dans une maison de soins prolongés, et le bébé de Shannon — repas au sein pour l’enfant, à la petite cuiller pour Ruth, gros plans des pieds de l’une et de l’autre dans l’eau du bain qu’on leur donne. Si There, There est ultimement moins percutant que Murmur, chacun de ces moments pourtant austères marque par leur profond humanisme entièrement dépourvu de sentimentalisme. (Claire Valade)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 19 octobre à 13h30 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. Heretic
KYUKA: BEFORE SUMMER’S END
Kostis Charamountanis | Grèce / Macédoine | 2024 | 103 minutes | Panorama international
Babis emmène ses enfants, Elsa et Konstantinos, sur l’île de Poros où la famille passait autrefois ses vacances. C’est l’été. Leur bateau est d’une blancheur étincelante dans la chaleur du golfe Saronique. La langueur et l’insouciance sont au programme. Tandis que Babis essaie désespérément de pêcher et d’intéresser ses enfants à l’exercice, Elsa et Konstantinos préfèrent se prélasser au soleil sur le pont ou sortir dans le village. À leur insu, leur mère biologique les observe, incognito, revenante d’une enfance lointaine où elle a abandonné sa famille pour des raisons qui demeurent floues. Seul Babis sait qu’elle est là et attend un moment propice pour favoriser les retrouvailles. Mais les choses ne se passeront pas comme il le souhaite, son ex-femme restant instable et cachotière, et ses enfants, frivoles et inconstant·e·s.
C’est ainsi que, sous le soleil grec plombant, le film plonge dans le passé de cette famille comme une longue promenade du côté de souvenirs réincarnés, comme si leur mémoire se tenait debout au grand jour, attendant d’être découverte. Kostis Charamountanis choisit une facture visuelle qui accentue ce sentiment un peu irréel de temps suspendu, avec un format de cadre carré et des couleurs saturées qui donnent à l’image un air de polaroïd des années 1970 ou de carte postale surannée de vacances à la mer, ou peut-être plus précisément, de filtre nostalgico-tendance dont les jeunes branché·e·s accros à Instagram sont si friands. L’impression d’improvisation généralisée qui flotte sur le récit intensifie ce sentiment de désinvolture et de nonchalance estivales. Une grande partie du film est aussi tournée comme si la famille avait un membre invisible qui les épiait, en plans fixes relativement rapprochés, tournant parfois sur leur axe, intéressés par les visages et les mains, les regards et les corps. L’utilisation d’un mélange de musique classique romantique, d’airs populaires nostalgiques et de chansons grecques à tendance folklorique amplifie d’autant l’impression d’oisiveté ensoleillée et d’envies inassouvies. Comme Babis le répète à son ex-femme dans une conversation téléphonique entendue en flash-back sonore, c’est comme si la famille — et le film avec elle — avait été avalée par l’été.
Il y a beaucoup de jolies choses dans ce premier long métrage, mais pour chacune d’entre elles, il y a autant d’éléments qui n’arrivent jamais vraiment à prendre forme. La seconde moitié du scénario, consacré à la rencontre avec la petite Ioli et sa sœur aînée Artemis, puis avec le père de celles-ci, Dimitris, marié contre toute attente avec la fameuse mère disparue, se lance dans une série de modes variés, exprimés en autant d’approches cinématographiques qui finissent non seulement par s’embrouiller les unes les autres, mais aussi par embrouiller le fil narratif. Le film essaie trop de choses pour faire passer son message, de la scène à reculons qui emmène Dimitris et sa famille sur le bateau aux histoires de pêche qui se chevauchent de façon étourdissante, en passant par l’espèce de roman-photo qualité vidéo et la scène de dialogue silencieux, le récit devient un méli-mélo de techniques. On finit par chercher davantage à comprendre ce que le choix de chacune d’entre elles représente, plutôt que d’essayer de comprendre ce que les scènes elles-mêmes signifient. Avec sa fin très ambiguë sur le sort concret de Babis, ses enfants et la mère enfin retrouvée, on finit par rester sur notre faim. (Claire Valade)
Prochaine projection: 20 octobre à 18h30 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. Cadence Studio / An Nam Productions / et al.
CU LI NEVER CRIES
Phạm Ngọc Lân | 2024 | Viêtnam / Singapour / France / Philippines / Norvège | 92 minutes | Compétition internationale
Mme Nguyên (Minh Châu) est de retour à Hanoï à la suite d’un long séjour en Allemagne, au cours duquel se déroulaient les obsèques de son ex-mari. Dans ses bagages, elle transporte avec elle deux fragments d’héritage : les cendres du défunt puis, dans une cage, un silencieux primate vietnamien, le Cu Li titulaire, bête aux yeux globuleux dont il s’agira dès lors de négocier la place dans l’atmosphère mélancolique de cet ambivalent retour à la maison. Comme les souvenirs résiduels d’un lien depuis longtemps inactif, ces deux donations apparaissent comme les premiers exemples d’un motif de transmission que Pham Ngoc Lân ne cessera de décupler dans ce premier long métrage où s’interroge les implications du legs historique vietnamien. « L’oublié devenait familier, et le familier était devenu étranger », entonne la protagoniste en voix off avant de déverrouiller la porte de sa maison et d’y retrouver Vân (Hà Phương), la nièce qu’elle a élevée et qui utilise aujourd’hui leur appartement partagé pour mener une fragile entreprise de gardiennage d’enfants. Vân prépare un mariage quelque peu précipité, dissimulant une grossesse précoce, repoussant les jugements inquiets de sa tante bien qu’elle semble elle-même incertaine de l’avenir que présage l’union intempestive. Par quel chemin tracer une continuité, un mouvement de transmission linéaire entre générations, lorsque le passé se fragilise et s’oublie, ou qu’il se trouve réactivé dans la crainte de sa répétition ? Les liens troubles, non immédiats, entre parents et enfants, entre époux et ami·e·s, se multiplient, et laissent place au silence de l’observation, alors que la caméra de Ngoc Lân s’attarde sur les regards équivoques. À même les visages se reconnaît une expression répétée : c’est celle du Cu Li, son regard médusé calqué sur le visage des enfants gardés, patientant le retour de leurs parents, ou dans l’expression figée de Vân, vêtue de sa robe de mariée et observant la cérémonie d’un air distant.
On reconnaît dans Cu Li Never Cries les codes d’un cinéma vietnamien qui, dans les dernières années, a pu intégrer le parcours festivalier occidental avec des premières œuvres enthousiasmantes et délicates réalisées par de jeunes réalisateurs, telles qu’Inside the Yellow Cocoon Shell (Thien An Pham, 2023) ou le superbe Viêt and Nam (Truong Minh Quy, 2024), également en compétition cette année au FNC. Le film de Pham Ngoc Lân se distancie néanmoins des tendances allégoriques qui caractérisent ces deux films, et opte plutôt pour la conjugaison du réalisme psychologique et de l’onirisme visuel languissant de ses panoramas nocturnes de Hanoï. En résulte une certaine modestie visuelle et narrative, où la tristesse mélancolique des futurs incertains y rencontre une tendresse latente qui permet à ses personnages de se rencontrer dans un ultime acte de donation : une bague de mariage, dernier souvenir de l’ancien mari de Mme Ngûyen, transmis à Vân comme un geste tentant de composer une rencontre hors de la rigidité des tensions intergénérationnelles. Un mouvement d’une surprenante espérance, comme une incision dans l’amère solitude qui ouvrait son récit. (Thomas Filteau)

prod. ATG / Directors Company
THE CRAZY FAMILY
Gakuryū « Sōgo » Ishii | Japon | 1984 | 106 minutes | Temps Ø
Gakuryū « Sōgo » Ishii est un auteur incontournable du cinéma de genre au Japon et l’un des précurseurs du style survitaminé qui en a fait les choux gras en Occident. Après deux films d’action à saveur punk, Crazy Thunder Road (1980), considéré comme le Mad Max (1979) japonais, et le musical dystopique Burst City (1982), il se retrouve à la barre de Crazy Family, coécrit par le mangaka conservateur Yoshinori Kobayashi. Mais comment sa mise en scène délirante cadre-t-elle avec la satire suburbaine que contient le scénario ? Aisément, puisqu’il s’agit de l’énième occasion pour lui de filmer la rage et la folie, celles des punks et des motards au même titre que celles des pères traditionnels, obsédés par l’idée dogmatique de la famille parfaite et du devoir paternel.
Les Kobayashi viennent de s’acheter une maison dans un quartier banlieusard en bordure de l’autoroute, symbole de la prospérité et du sens du devoir de Katsuhiko, leur patriarche encravaté. Après une introduction qui ressemble à une publicité d’électroménagers, où les déménageurs remplissent la demeure des plus récents appareils électroniques, le rêve commence à tourner au cauchemar : le grand-père décide unilatéralement de s’y installer, les jeux de séduction de la mère (Mitsuko Baishō, actrice fétiche de Shōhei Imamura) débordent malencontreusement des murs de la chambre à coucher, et les deux enfants, laissés à eux-mêmes dans leurs chambres individuelles, s’enlisent dans leurs fantasmes respectifs d’otaku et d’aidoru. Les choses se dégradent encore davantage lorsque Katsuhiko aperçoit un termite, qu’il craint voir s’organiser pour gruger sa propriété, et lorsque, dans un élan mal placé de piété filiale, il se met à détruire la cuisine pour y creuser un sous-sol capable d’abriter son père. Plutôt qu’un lieu de communion, la maison unifamiliale devient alors un lieu de désunion et de paranoïa, et ce n’est que dans sa destruction finale que les personnages retrouveront la joie de vivre ensemble.
Question d’épaissir la satire et d’étirer le plaisir, Ishii puise dans un registre international de psychiatrie cinématographique. Non seulement préfigure-t-il l’iconographie du salarié robotique de Tsukamoto, un homme qui coure sans arrêt, se pressant le jour dans des transports bondés et s’évertuant le soir sur son appareil d’exercice, creusant frénétiquement le sol de la cuisine à l’aide de son marteau-piqueur ou traversant les wagons de métro comme une fusée dans sa quête fanatique de destruction des termites. L’obsession desdits insectes s’exprime également par un travelling contrarié digne des sueurs froides de Scottie dans le Vertigo (1958) d’Hitchcock. Lors du dernier acte, alors que Katsuhiko s’arme pour tuer, c’est-à-dire pour « guérir » sa famille de leurs psychoses, on s’enfonce dans un cloaque plus noir encore, avec des clins d’œil au père meurtrier de Shining (1980) et de Texas Chain Saw Massacre (1974). Le tout constituant une petite histoire du cinéma d’horreur pour une petite histoire de l’aliénation et de la perversité japonaises, incluant une référence troublante aux crimes commis par l’armée japonaise en Mandchourie. « This Chinese girl is very well grown for her thirteen years. » Beurk ! (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 20 octobre à 16h30 (Cinémathèque québécoise)

prod. Creative Agitation
THROUGH THE GRAVES THE WIND IS BLOWING
Travis Wilkerson | États-Unis | 2024 | 84 minutes | Les nouveaux alchimistes
Qu’ont à voir ensemble les équipes nationales de football européen, les morts inexpliquées de touristes, le breakdance, les graffitis et la chute de la Yougoslavie ? J’aurais eu du mal à répondre autre chose que « rien pantoute » avant de visionner le dernier film de Travis Wilkerson, Through the Graves the Wind Is Blowing. Et pourtant, le réalisateur arrive à faire tenir ce collage encore mieux que la présence inusitée d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une table d’autopsie, pour reprendre la célèbre formule surréaliste.
Installé en Croatie avec sa femme et ses deux enfants pour des raisons professionnelles, Wilkerson se met en tête de réaliser un film sur la République fédérale de Yougoslavie (1992-2003), ce projet panslaviste ayant donné naissance au seul pays communiste situé à l’ouest du rideau de fer. Mais bien vite, la chose s’avère impossible, moins pour des raisons logistiques que d’autres, liées à l’éthique de la représentation. En lieu et place, le cinéaste choisit d’utiliser sa caméra pour accompagner Ivan Perić, un détective chargé de résoudre les enquêtes criminelles portant sur les meurtres de touristes dans la ville de Split, où de telles affaires se multiplient en raison de l’irrespect des visiteur·ice·s et de la xénophobie ambiante. Celle-ci est si forte que Perić, véritable figure tragi-comique, est constamment empêché d’effectuer son travail par les autorités qui l’embauchent, et ce à l’aide de subterfuges administratifs proprement kafkaïens. Visitant la ville avec Perić, Wilkerson parcoure ainsi les scènes de crimes irrésolus et interroge le détective sur sa quête donquichottesque. Ses périples sont l’occasion d’une incursion anti-touristique dans le musée des désillusions du XXe siècle que constitue la ville.
L’acte cinématographique semble toujours naître d’une nécessité qu’impose l’histoire pour Wilkerson, comme si l’inintelligibilité du passé ne pouvait être traduite qu’en projet filmique. Et comme c’était déjà le cas dans Did You Wonder Who Fired the Gun? (2017), son long métrage sur le passé de klansmen de ses aïeuls, le réalisateur ne se tourne pas vers l’image pour résoudre les épineuses questions que pose le réel, mais bien dans l’espoir de répondre de lui et de son insolubilité dans l’art (comme dans quoi que ce soit d’autre). Le cinéma, pour Wilkerson, ne semble pas être une solution face à l’impossible, simplement une traduction de celui-ci dans un langage visuel.
Tout au long de cet essai documentaire, les images de sigles néonazis (croix gammées, symboles des Oustachis) s’accumulent vertigineusement sur les murs décrépis de la ville. Captés en noir et blanc, ils couvrent les murales racontant l’histoire du pays et la fin du projet de société yougoslave. Through the Graves the Wind Is Blowing semble avant tout porter sur les signes qui nous entourent et qui tapissent les parois que nous longeons. L’histoire est là, opaque, livrée sans clé : plus de noms, plus de dates, plus de mémoire, seulement la haine. Et pourtant il y a quelque chose d’optimiste, ou à tous le moins, une sorte d’espérance révolutionnaire chez Wilkerson. Les indices de l’horreur fasciste — présente et passée — existent. Ceux de la libération nationale et de la lutte antifasciste, aussi. En dormance, peut-être seront-ils un jour ceux que les Croates choisiront de réactiver. (Laurence Perron)
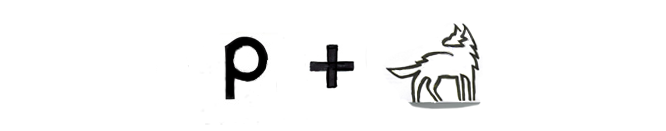
PARTIE 1
(Rumours, The Hyperboreans,
Pepe, The Box Man)
PARTIE 3
(Bluish, Matt and Mara,
A Traveler's Needs, Reas,
By the Stream)
PARTIE 4
(Lázaro de noche,
All the Long Nights, Patient #1,
Favoriten, The Real Superstar)
PARTIE 5
(All We Imagine as Light,
There, There,
Kyuka - Before Summer's End,
Cu Li Never Cries, The Crazy Family,
Through the Graves the Wind Is Blowing)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
