

prod. Urugori Films
THE BRIDE
Myriam U. Birara | Rwanda | 2023 | 73 minutes | Compétition internationale
Présenté dans la section Forum des Jungen Films, cette œuvre n’a pas grand-chose de jeune à part sa réalisatrice. Qu’à cela ne tienne, celle-ci propose néanmoins une représentation tendre et inspirante d’une amitié féminine salutaire, une amitié saphique rien de moins, chose rare dans le cinéma africain, voire dans tout le cinéma mondial. Les choses débutent d’une façon brutale et grossière, dans le Nord-Ouest du Rwanda en 1997, lorsqu’une demoiselle zaïroise cueille des fleurs dans un arbre, et qu’un homme pénètre brutalement dans le champ. « J’ai un message pour toi », lui dit-il à la manière roublarde des arnaqueurs. La jeune femme quitte alors la cadre pour lui échapper, se retrouvant sur une route de terre où elle est assaillie, puis emmenée contre son gré par un groupe d’hommes, son panier de fleurs se retrouvant étalé sur le sol. On la montre ensuite cloîtrée dans une chambre, prisonnière d’un univers ménager dont elle ne veut rien savoir — préférant poursuivre ses études de médecine —, enchaînée à un mari qui l’a choisie sans aucune réciprocité. Or, tout est déjà dit via cette matrice formelle d’une éloquente simplicité : la liberté pastorale emblématisée par les larges plans extérieurs se heurte à une domesticité carcérale, représentée par des plans intérieurs étouffants, la féminité étant du même coup allégorisée d’une façon strictement essentialiste selon l’axe nature-flore-vulve.
Débute ensuite ce qui ressemble initialement à un mélodrame lourdingue, où la douleur d’Eva est représentée à grand renfort de larmes et de cris, alors qu’elle est abandonnée par sa mère, impuissante face aux traditions locales, et réappropriée par un mari insouciant qui la baise sommairement sans son consentement pour repeupler sa famille massacrée par les Hutus. Les plans de chambre à coucher sont d’ailleurs toujours cadrés de la même façon, avec la femme étendue à l’avant-plan, son visage larmoyant ou crispé tourné vers la caméra tandis que son mari s’affaire en arrière-plan, comme une force ténébreuse à laquelle elle ne répond jamais. Ce n’est qu’au fil du temps qu’Eva quittera la prison du lit matrimonial et de la salle de bain, où elle confinée par ses douleurs génitales, pour découvrir le reste de la maison, et pour rencontrer la cousine de son mari, avec qui elle développera une amitié libératrice qui la verra tranquillement, au gré de longs plans langoureux, quitter le « nid familial » pour retrouver la liberté du dehors.
Ce qu’il y a de plus intéressant ici, c’est la façon dont cette amitié s’épanche tranquillement vers l’amour lesbien, remède idéal, dans sa douceur et sa considération, à un « amour » hétérosexuel unilatéral et possessif. Les deux femmes discutent d’abord simplement, elles apprennent à se connaître, Eva enseignant sa langue à la cousine, tandis que cette dernière, fragilisée par les traces encore récentes du massacre génocidaire de 1994, lui raconte l’histoire de sa famille, dont elle garde la mémoire en vie grâce aux photos qu’elle conserve sur une commode contre l’avis de son frère, qui préférerait les voir disparaître (et remplacées par les nombreux enfants qu’il compte extraire de sa femme volée). Les choses se réchauffent tranquillement : la jeune femme complimente les cheveux d’Eva, elle porte un toast sensuel avec celle-ci, puis, lors d’une scène où elle lui applique doucement un baume labial artisanal, lui procure finalement un peu de plaisir sexuel. Ne sachant trop comment se situer face à cette tendresse orgasmique inattendue, la protagoniste prendra quelque peu ses distances face à son amante de circonstances. Mais comment finira l’histoire ? Avec une touche douce-amère qui ne réchauffe pas moins le cœur. (Olivier Thibodeau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2023

L’une des chansons de Nick Cave que j’apprécie particulièrement est « The Mercy Seat » (tirée de l’album Tender Prey). Référant à la chaise électrique, cette enivrante élégie atteint son paroxysme en décrivant une violence institutionnelle aberrante, inspirée par la justice biblique. « And the mercy seat is glowing / And I think my head is melting / And in a way I’m helping / To be done with all this twisting of the truth / An eye for an eye / And a tooth for a tooth. » Or, l’année même de la sortie de Tender Prey, Cave participait au scénario d’une œuvre de John Hillcoat sur les excès du système carcéral australien, un film de prison impitoyable, cru, indigent et sincère qui défend une position radicale selon laquelle le mauvais traitement des détenus s’inscrirait dans un effort concerté de la société afin de créer des prédateurs psychotiques pour terroriser la population, et ainsi justifier l’existence des pouvoirs répressifs en place.
Ça commence comme un film de science-fiction (on pense au Fortress de Stuart Gordon [1992]) avec ses panoramas désertiques entourant l’institution fictive de la Central Industrial Prison, ses plans d’architecture souterraine à la géométrie brutaliste, ses interfaces informatiques et ses chaînes de prisonniers baignés de lumière bleu acier. Puis, Ghosts s’installe dans un rythme quotidien abrasif, alors qu’il commence à décrire les événements ayant mené à la quarantaine qui sévit depuis 37 mois dans le pénitencier. Or, il s’agit moins ici d’un film d’enquête traditionnel que d’une chronique cruelle de la dépossession et de la déshumanisation. De facture claustrophobe et oppressante — la poignée de plans extérieurs n’inclut jamais aucun être humain — le film nous impose une bande sonore particulièrement hostile, constituée de musique anxiogène et d’angoissants murmures, qui vise à nous faire partager le mal-être constant des personnages. Le scénario, principalement anecdotique, s’impose conséquemment comme une chorale bordélique, portée par la voix off fantomatique et colorée de différents détenus, qui partagent avec nous leurs impressions mi-prosaïques mi-philosophiques sur la situation.
La détérioration mentale des protagonistes s’exprime ainsi par leurs dialogues et leurs actions, par le teint blafard des junkies et les mains couvertes de merde des artistes de la crasse, mais aussi par l’état de plus en plus dénudé de leurs cellules, au gré d’une sorte d’architectonique de la privation. Outre les intérieurs moites et sordides des cachots destinés au confinement, on note d’abord une relative opulence dans les quartiers de chaque prisonnier, dont les murs sont tapissés d’affiches érotiques ou de bibliothèques en carton débordant de livres — l’un des caïds locaux possède même un beau réduit avec un téléviseur et un mur recouvert d’une scène tropicale. Or, les objets dont ils bénéficient (incluant les articles de contrebande et la drogue) s’inscrivent chez eux dans un système d’échange, de troc, de rituels, de recel et de vol qui s’apparente à une forme de communautarisme marginal. Malheureusement, au gré des exactions perpétrées par les gardes, qui fouillent tout, jusqu’aux cavités buccales et anales des gens à leur charge, qui confisquent les téléviseurs et la drogue, déchirent les livres et écrabouillent les maquettes navales, tout ce système s’écroule, tout le semblant de convivialité s’évapore. Ce qu’il reste, à la fin, ce ne sont que des animaux écumant dans des cages vides, implorant le massacre des agents correctionnels au sein d’une œuvre coup-de-poing qui nous force à repenser non seulement le système carcéral, mais toute l'institution disciplinaire antidémocratique qui prospère sous l’étiquette de la « sécurité publique ». (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 15 octobre à 16h00 (Cinémathèque québécoise)

prod. Jeonwomsa Film Co.
Deux trios d’individus se rencontrent, dans des appartements de Séoul se répondant comme deux images-miroir. D’un côté, l’actrice Sang-won (Kim Min-hee), réside temporairement chez son amie Jung-soo (Song Sun-mi), et reçoit la visite de l’aspirante actrice Ji-soo (Park Mi-so). De l’autre, c’est un poète vieillissant (Gi Ju-bong), qui accueille dans son appartement une jeune cinéaste observant son quotidien dans le cadre d’un tournage universitaire, puis un poète ingénu en quête de conseils illuminés. On retrouve toujours chez Hong une richesse dans la reprise thématique, dans la répétition des typologies propre à chaque interprète retrouvé·e de récit en récit. Comme dans The Novelist’s Film (2021) ou In Front of your Face (2022), Hong s’intéresse à l’attention que ses personnages créateur·ices portent sur les instants du quotidien, à la façon dont l’existence journalière réside entre une platitude du geste répété et un mystère poétique discerné lorsqu’un regard appliqué devient observateur des secrets cachés dans les plis du banal.
Se répètent dans In Our Day les gestes de don, que ceux-ci se présentent comme la livraison d’un cadeau matériel (les savons et le propolis, ramenés du Brésil par Ji-soo et offertes à Sang-won pour la remercier d’accepter sa visite) ou comme une sage parole tant souhaitée par les jeunes artistes de la part des maîtres (« Qu’est-ce que la vie ? » ou « Qu’est-ce que l’amour ? » demande le jeune poète à l’écrivain interloqué). Ces présents relèvent d’une logique de l’échange et de ses espérances. Elles enveloppent les rencontres et les joutes conversationnelles d’une formalité embarrassée, qui pourtant aspire à un candide détournement, car chaque apprenti·e souhaite récupérer de l’idole la transmission du génie.
Quand j’écoute un film de Hong, je perçois et espère habituellement un lent bouillonnement provenant de l’image, comme une fébrilité en attente d’explosion. Après avoir bu quelques bouteilles de soju, et que les langues se soient déliées, l’embarras des échanges de surface laissent place à la parole désinhibée, parfois mélancolique et brutale, ou autrement d’une admirable et douce franchise. Cette fois-ci, on peut bien boire (de la bière sans alcool, puis du soju), ou manger (des ramen), mais l’occasion d’une éruption d’honnêteté semble toujours différée, et les secrets devinés (notamment, quant au lien entre les deux histoires) restent tapis dans l’ombre, alors que les affaires du quotidien prennent le pas sur le flânage conversationnel. Même le savant poète semble désappointé de la rencontre trop courte. Finalement, les moments de liens les plus significatifs d’In Our Day relèvent d’un rapport appuyé au non-humain : le souvenir relaté par Sang-won d’une plante observée, ou les rires que génèrent l’observation d’un chat qui semble préférer l’invitée à sa maîtresse. À l’initiale frustration d’une épiphanie manquante, peut-être faudrait-il plutôt recevoir cette œuvre nouvelle avec une suspicion quant à nos propres attentes spectatoriales, afin de percevoir nous aussi la belle simplicité du cinéma de Hong Sang-soo hors de la dévotion aveuglante. (Thomas Filteau)
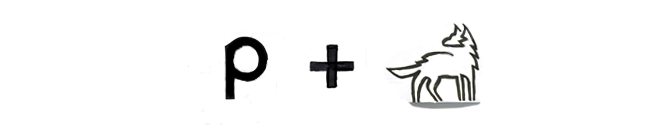
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
