

La mission du FIFEQ est plutôt noble, soit de « démocratiser l’anthropologie visuelle et le cinéma ethnographique », de les libérer du carcan académique où les fondateur·rice·s du festival, des étudiant·e·s en anthropologie de l’Université de Montréal les croyaient prisonniers. La gratuité des projections et l’organisation bénévole des événements participent admirablement de ce processus de démocratisation. On note même une posture distinctement réflexive parmi les films de la programmation, une irrésistible invitation à réfléchir sur l’idée de domination sous-jacente à la perspective ethnographique en contexte colonial. Malgré cela, malgré tous ces galants efforts, on doute pourtant que le festival puisse véritablement disloquer le rapport intrinsèquement exotisant au monde que propose le cinéma, qui est avant tout un art de l’évasion, et qui, pour l’intelligentsia cinéphile occidentale, semble offrir une tentative de rapprochement utopique, voire stérile, avec les sujets tiers-mondistes ou prolétaires d’un certain cinéma documentaire.
Pour mieux comprendre où le bât blesse, examinons le point de tension qui m’est apparu suite à l’expérience des deux programmes thématiques auxquels j’ai assisté en personne. Notons d’abord le bloc « Voyages affectifs », dédié à « l’immersion intimiste dans des histoires […] personnelles et partagées ». Les deux courts métrages sélectionnés pour l’occasion s’attellent spécifiquement à déconstruire de manière intellectuelle le regard anthropologique.
Proposant une forme « d’auto-ethnographie » (c’est le qualificatif utilisé par son auteur, Theo Panagopoulos), le premier de ces deux films, The Place Between Was and Will Be (2022), vise à définir en images le concept de « liminarité ». Doté d’un argumentaire abstrus en voix off sur les trois étapes constitutives du rite de passage défini par Arnold van Gennep (la séparation, la liminarité et la réincorporation), le film se laisse surtout apprivoiser d’une manière sensuelle, émotive, se révélant comme un touchant témoignage sur le processus de deuil vécu par le cinéaste. Le raisonnement académique qu’il déploie avec tant de soin semble donc paradoxalement superflu pour faire sens des images parfaitement lisibles qu’il glane dans la maison de son grand-père décédé. Superposant des photos et des vidéos de la maison achalandée, à l’époque de ses grands-parents, aux images des espaces vides qui demeurent aujourd’hui, Panagopoulos génère une friction créative entre la présence et l’absence de son aïeul, laquelle sied admirablement à l’idée de persistance mémorielle qui caractérise le deuil. Il immortalise en outre cet être cher via le processus de consignation cinématographique, usant de la métaphore du bourgeon floral aperçu dans le jardin pour mieux symboliser la nature cyclique de la vie. Il prouve ainsi simultanément la valeur et la futilité du discours scientifique dans la mise en contexte d’une expérience humaine universelle et immédiatement intelligible.

:: The Place Between Was and Will Be [Theo Panagopoulos / Erica Monde]
The Place emblématise également une portion plus large de la programmation, dont le caractère ethnographique provient du récit de soi, où l’auscultation du collectif émane de la vérité intime des cinéastes et de leurs sujets. Ici, le deuil du réalisateur possède certes une valeur universelle, évidente dans la représentation de la maison vide et de l’iconographie florale. C’est aussi le cas pour Ma vie en papier (2022) de Vida Dena, Things I Could Never Tell My Mother (2022) de Humaira Bilkis et Huahua’s Dazzling World and Its Myriad Temptations (2022) de Daphne Xu, où le biographique s’épanche dans l’anthropologique fidèlement au concept deleuzien de littérature mineure, grâce auquel le récit de soi peut tenir lieu de récit national.
La famille d’immigrants syriens de Ma vie en papier évoque ainsi tout le peuple syrien via son récit familier de violences confessionnelles, de traumas explosifs, de mort et de déracinement ; l’utilisation des dessins naïfs faits par les enfants pour illustrer l’innocence souillée par la guerre rappelle même distinctement l’Errance sans retour (2020) de Higgins et Carrier, à propos des Rohingyas massacrés par les Birmans. Les frasques éreintantes de l’héroïne titulaire dans Huahua’s Dazzling World, une mère de famille sursollicitée dans la Chine rurale, permettent à son tour de dégager une vérité universelle relative au caractère simultanément libérateur et esclavagiste des réseaux sociaux. Things I Could Never Tell My Mother, le documentaire à la première personne de la réalisatrice bengalie Humaira Bilkis, s’apparente quant à lui très spécifiquement au film de Panagopoulos, révélant les ravages du sectarisme religieux tout en immortalisant les traces évanescentes de ses parents, incluant celles d’un père mourant dont elle portraiture la dégénérescence cancéreuse lors du confinement pandémique de 2020.

:: Ma vie en papier [Clin d'œil Films]

:: Errance sans retour [MÖ films / SPIRA]

:: Huahua’s Dazzling World and Its Myriad Temptations [Daphne Xu]

:: Things I Could Never Tell My Mother [Les Films de l'œil sauvage / Zoo Films]
Le court métrage Les porteurs (2022) de Sarah Vanagt, qui complète la sélection du programme « Voyages affectifs » explore à son tour les limites historiques de la discipline ethnographique, constituant une salve frontale contre le processus colonial d’extraction des images et des artéfacts de l’Afrique subsaharienne. Se déroulant dans la Belgique natale de la réalisatrice et, simultanément, par le prisme des images argentiques captées par les colons du début du 20e siècle, dans l’ancien Congo belge (l’actuelle RDC), le film effectue une inversion de la perspective ethnographique, où des jeunes Noir·e·s viennent commenter le regard colonial posé sur leurs ancêtres. Pour ce faire, elle invite ses sujets à jouer au jeu de la valise en utilisant la liste des objets exposés au AfricaMuseum de Tervuren qui, de leur point de vue, rappellent toute la violence du vol et du catalogage de leurs legs ancestraux. Elle leur propose ensuite de regarder et de critiquer les images argentiques rapportées par les colons d'antan, qu’ils s’approprient pleinement en y effectuant des zooms et en réfléchissant sur le pouvoir de la manipulation psychologique qui a initialement permis aux forces blanches de régner sans opposition sur le continent. Les interrogations qui s’ensuivent à propos du besoin avorté de révolte contre les pouvoirs en place possèdent d’ailleurs une résonnance contemporaine particulière à une époque où ce besoin de révolte est désormais mondialisé.
Dans son processus d’auscultation communautaire rétrospective des stéréotypes de l’Africanité, le film renvoie aussi à l’astucieux court métrage The A-Team (2021) de la réalisatrice Nnenna Onuoha (issu du programme « Caméras accompagnantes » et processus filmiques du “prendre soin” »), dans lequel un groupe d’étudiant·e·s ghanéen·ne·s se remémorent avec malaise un voyage scolaire au Mississippi organisé dix ans plus tôt. La musique inquiétante plaquée sur la poignée d’images d’archives qui complètent les voix off laisse présager un événement traumatique, qui se résume finalement à la « performance » de l’Africanité effectuée malgré eux par les sujets, qu’on a fait interpréter en chœur des chants africains et qu’on a photographié dans des champs de coton. On croirait presque assister à une version condensée des Porteurs, où le stigmate de la représentation carnavalesque, du stéréotype, est douloureusement récent, et affecte directement les intervenant·e·s, qui regrettent aujourd’hui amèrement leur participation dans la réaffirmation de leur propre image coloniale. « Should they know better? Yes. », déclare une femme à propos des étudiant·e·s mississippien·ne·s, « But have we contributed to maintaining this kind of an image? Yes. »
« Voyage affectifs » vise en somme à éroder les racines colonialistes du cinéma ethnographique. On pourrait donc dire qu’il s’agit d’un programme symptomatique de la mission sous-jacente du festival, soit d’offrir un contrepoids à une tradition passéiste d’extraction culturelle univoque tout en proposant une métaréflexion cinématographique du médium. C’est la part utopique de la programmation qui, quoiqu’elle ne risque pas de provoquer de réflexion plus large sur l’état actuel du colonialisme blanc (que nous supportons dans la majorité de nos achats) permet au moins d’entrevoir un monde où les colonisés peuvent désormais retourner le regard et le partager.

:: Les porteurs [Balthasar & Michigan Films]
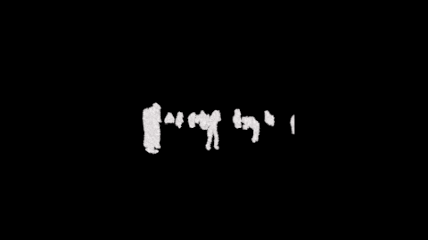
:: The A-Team [Sensory Ethnography]
L’autre programme auquel j’ai assisté, « Éloges aux longueurs prolétaires du quotidien », concerne la réalité du travail (et de l’ethnicisation) du prolétariat mondial. Il est composé de deux œuvres, la première (Le coin d’une sphère de Théo Zesiger, 2022) relatant les us quotidiens des tenancier·ère·s du marché asiatique Tam-Ky dans le quartier Noailles de Marseille, et la seconde (Astronauts of Feuerbach de Johann Schilling, 2022) proposant une incursion parmi les travailleurs immigrants d’un lave-auto huppé et hyper achalandé de Stuttgart.
Pour moi, ce sont avant tout des considérations techniques qui distinguent l’œuvre de Zesiger, dont l’art du cadrage permet de maximiser l’utilisation d’un espace de tournage restreint, qu’il découpe en une manne de vignettes superbes, évocatrices tour à tour de l’empressement et de la langueur qui caractérise le travail des employé·e·s du marché. L’empaquetage machinal des aliments dans des sacs de plastique pesés et étiquetés avec diligence succède ainsi au spectacle de l’attente, emblématisé par l’image d’un chat qui se prélasse sur les tablettes, le corps décontracté mais l’œil aux aguets. Or, ce que le film portraiture, c’est aussi un microcosme encapsulé, un monde presque entièrement immigrant, où se côtoient travailleurs vietnamiens et clientèle noire. C’est la réalité du travail de l’Autre, devenu maintenant l’apanage de toutes les grandes villes occidentales, des comptoirs de dürüms de la place Madou aux fast food libanais de la plaza St-Hubert, des marchés Tam-Ky du sud de la France aux marchés Kim Phat de Côte-des-Neiges.

:: Le coin d'une sphère [Théo Zesiger]
Cette idée de prolétariat étranger est encore plus prégnante dans Astronauts of Feuerbach, ce documentaire tourné dans un noir et blanc parfaitement exsangue, ingénieusement impressionniste, produit par nos ami·e·s de l’académie du film de Bade-Wurtemberg (The Trouble with Being Born [Wollner, 2020], Time of Moulting [Mertens, 2020]). Et si le film aborde de façon directe la définition même de domicile — un employé portugais regrette le littoral majestueux de son pays natal tandis qu’un immigrant roumain nous rappelle qu’il n’existe plus désormais pour lui de « chez soi » —, c’est surtout l’asservissement de l’ouvrier immigrant à la machine, noyau contemporain du rapport des classes, que vient décrire le film.
S'apparentant parfois au film symphonique vertovien grâce à ses élégants ballets machiniques, le film analyse l’érosion du rapport interpersonnel au profit d’un rapport de classes par objets interposés. On note ainsi que la caméra s’attarde très peu aux conducteur·rice·s des véhicules, mais à ces véhicules eux-mêmes, qui en viennent à les substituer entièrement dans une économie interpersonnelle axée sur l’exhibition matérielle du prestige. Comme le faisait Spielberg dans Duel (1971), en refusant de montrer la personne au volant du camion antagoniste, lequel vient même saigner à sa place dans les derniers instants du film, c’est donc moins le rapport de force pourvu par la machine auquel on s’intéresse ici qu’à la déshumanisation des rapports qu’elle engendre. À ce titre, on constate que les ouvriers, nonobstant leurs histoires personnelles, se présentent à l’écran comme des extensions cybernétiques du lave-auto, des hommes-fontaine et des hommes-cireuses, bref de simples engrenages dans la longue chaîne automatisée se déployant entre son entrée et sa sortie.

:: Astronauts of Feuerbach [Filmakademie Bade-Wurttemberg GMBH]
Étrangement, si l’on peut dire que le programme « Voyage affectifs » proposait une remise en question du film ethnographique en tant que manifestation d’une perspective coloniale, qu’il disloquait la hiérarchisation du regard qu’implique le cinéma ethnographique « classique », on pourrait dire que le programme « Éloges aux longueurs prolétaires du quotidien » la réitère en quelque sorte. En effet, le cinéma qu’il présente n'inclut pas la participation active des sujets ni ne s'adresse à eux. Ceux-ci sont filmés par des observateur·rice·s extérieur·e·s pour des observateur·rice·s extérieur·e·s, pour une intelligentsia cinéphile qui, aussi sincère soit-elle, demeure étrangère au monde ouvrier, dont les enjeux constituent pour elle des considérations presque exotiques, au même titre que les artéfacts congolais pour les colons belges. Dans les circonstances, on pourrait même dire que le privilège de voir les ouvriers à l'ouvrage est indissociable ici d’une forme de hiérarchisation des individus en fonction du travail.
Qu’à cela ne tienne, le festival m’a aussi délecté du long métrage Prisme (2021) de Rosine Mbakam, réalisatrice belgo-camerounaise dont j’avais autant adoré le Deux Visages d’une femme Bamiléké (2016) que j’avais détesté Les Prières de Delphine (2020). Mbakam nous revient ici flanquée des autrices An Van Dienderen et Eléonore Yaméogo, qui à trois créent un triptyque fascinant, lumineux, ludique sur le problème du rendu de la peau noire au cinéma. Rappelant les préoccupations du directeur-photo Bradford Young que j’avais examinées dans un essai à son sujet, le film évoque en outre la fougue anticolonialiste des Porteurs de Sarah Vanagt, mais avec deux femmes noires à la barre.
Déambulant parmi les écoles de cinéma belges (l’INSAS et l’école des arts de Gent), à la rencontre de professeur·e·s, de photographes, de cinéastes, d’acteur·ice·s et de maquilleuses, le film aborde la question de plusieurs angles complémentaires. S’intéressant d’abord aux « China girls » blanches, il évoque initialement le biais de l’appareil de prise de vue argentique lui-même, dont les émulsions et la balance des couleurs seraient adaptées avant tout aux visages blancs. On se penche ensuite graduellement sur les différentes facettes du prisme via lequel la peau noire est considérée, notamment en ce qui a trait à l’éclairage et au maquillage. À travers une série de mises en scène gigognes, on s’attelle finalement à déconstruire le mythe selon lequel la peau noire serait intrinsèquement « dure à filmer » ou qu’elle « sort mal à l’écran ». « Le cinéma, c’est toujours un rapport », nous rappelle d’ailleurs l’un des professeurs invités, concrétisant ainsi tout le discours de l’œuvre, mais plus largement, toute la mission du festival, qui encadre la projection des films pour mieux mettre en lumière leurs contextes de production et les rapports de domination/libération qui sous-tendent leur existence.

:: Deux visages d'une femme Bamiléké [Icarus Films]
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
