

prod. Metafilms
LA CONTEMPLATION DU MYSTÈRE
Albéric Aurtenèche | 2020 | Québec | 101 minutes | Compétition nationale
Albéric Aurtenèche, réalisateur québécois né à Paris, propose ici un premier long métrage décalé, aux accents burlesques qui s’éloigne radicalement du film québécois « traditionnel » et sa fable réaliste qu’on a l’habitude de voir sur nos écrans – cet aspect décalé est perceptible dès la lecture du synopsis, un peu compliqué, où un trentenaire anxieux et désillusionné, Éloi (Emmanuel Schwartz), retourne sur les terres dont il a hérité pour un hommage insolite rendu à son père par des chasseurs locaux.
Soulignons d’entrée de jeu l’ambition d’Albéric Aurtenèche, qui a fait le choix de mélanger divers genres (le drame, la comédie, le thriller, le fantastique), comme le souligne le cinéaste dans une entrevue accordée à La Presse en 2019[1]. Si l’œuvre est une sorte d’ovni du fait de cette hybridation, le cinéaste se ressaisit toutefois d’un thème central de l’imaginaire cinématographique québécois depuis Pierre Perrault : la chasse. Sans vouloir dépeindre réalistement cet univers, le film réussit à fasciner par sa façon de représenter la cohésion d’un groupe de chasseurs et les codes sociaux implicites qui sous-tendent leur organisation.
La première séquence, qui met en scène un cauchemar en forêt, est filmée à travers une lentille imitant l’œil d’une caméra de chasse. Le réalisateur reprend plusieurs fois cette perspective originale (la caméra de chasse devenant un allié privilégié d’Éloi, qui retrouve grâce à elle des images de la mort de son père); celle-ci est toutefois un peu ingrate esthétiquement. L’ouverture onirique initiale est suivie par l’une des scènes les plus mémorables du film, la cérémonie de l’Ordre des chevaliers de Saint-Hubert qui a été tournée dans l’Église de la Visitation à Ahuntsic – scène qui n’est pas sans faire penser à l’esthétique surréaliste de Denis Côté – et dans laquelle on rend hommage au père d’Éloi.
Si le synopsis annonçait une œuvre à la fois contemplative et énigmatique, le passage des idées à leur actualisation déçoit par contre, la narration souffrant d’un manque de maîtrise. D’entrée de jeu, le récit nous propose une piste, celle du fils à la recherche de ses origines paternelles. Or, le film hésite, puis bifurque avant de nous lancer sur une seconde piste, qui flirte avec le thriller sans y adhérer vraiment. Le film accumule ensuite les quêtes, si bien qu’on ne sait plus quel est le désir du protagoniste, ni le désir du film lui-même…
Bien qu’il ne manque pas d’originalité, La contemplation du mystère ne parvient pas à renouveler les codes du thriller, ni à vraiment atteindre le spectateur dans l’une ou l’autre de ses trames narratives. D’ailleurs, ces différentes trames (expériences hallucinogènes, décryptage de manuscrits, fabulations forestières, violence intestine chez les chasseurs, quête identitaire et mémorielle) parviennent difficilement à s’articuler, de sorte qu’elles n’inspirent pas un sentiment de l’étrange, mais donnent plutôt l’impression d’une kyrielle d’idées inabouties.
L’absence de dimension contemplative dans le film semble également attribuable au montage saccadé, peu fluide, qui enchaine les plans très courts. Les scènes oniriques – de fantasme, de rêve, de réminiscences, d’ivresse – dégagent peu de poésie, voire de « mystère » à proprement parler. Il aurait été intéressant que la réalisation insiste davantage sur les chocs entre les tons, entre le vertical et l’horizontal; que le hiatus soit surligné entre les scènes mystiques et les scènes prosaïques.
Finalement, si le cinéaste a su s’entourer d’une distribution talentueuse (Sarah-Jeanne Labrosse, Emmanuel Schwartz, Gilles Renaud, Martin Dubreuil, François Papineau), aucun de ses membres n’est au sommet de sa forme. Emmanuel Schwartz, pour qui était écrit le rôle d’Éloi, n’a rien de « mystifiant » ni d’attachant. Son personnage manque d’épaisseur, tout comme la plupart des autres, à l’exception peut-être de Diane (le seul personnage féminin, incarné par Sarah-Jeanne Labrosse), plus intrigante que ses contreparties, et avec qui Éloi développe une relation plus significative.
Enfin, le film ne manque pas d’idées, et c’est peut-être ça son défaut. (Sarah-Louise Pelletier-Morin)

prod. Metafilms
DAMASCUS DREAMS
Émilie Serri | Québec | 2021 | 84 minutes | Compétition nationale
Sur l’album de famille, deux mains se disputent des photographies. L’une est parcourue par quelques marques légères laissées là par les années, comme ces phalanges délicatement ridées. Elle entre et sort du cadre, pointe successivement un vase puis une robe, des enfants jouant dans la cour, un père et une maison. L’autre est lisse et reste là sagement : plus petite, elle attend qu’on lui donne des indications pour ensuite reproduire les mouvements de son ainée entre les souvenirs de Damas. À la parole de la mère, qui montre et explique en arabe, répond immédiatement la voix de la fille, qui traduit en français les mots et la mémoire qu’on lui transmet. Émilie Serri capture ici un moment au confluant de la mémoire familiale, de la langue et des images, et il serait vain de tenter de déplier en mots les émotions en jeu dans cette scène. À l’image de celle-ci, Damascus Dreams regorge d’instants dont la beauté parvient à transcender la douleur qui habite les paroles de ces réfugiés qui se remémorent, presque à contrecœur, les violences faites à leur pays. Tissée de mots et de visages tiraillés entre le souvenir de cet ailleurs dont on aperçoit les ruines et d’un ici à la fois chaleur de l’asile et froid glacial qui fige jusque l’eau du fleuve, une mémoire collective se régénère pour exorciser les démons de la guerre.
Partant d’un questionnement personnel, adressé à son père syrien qui incarne les récits de l’ailleurs et à elle-même, dont l’oubli de l’arabe caractérise une expérience transformative de l’ici, Émilie Serri propose un documentaire foisonnant d’idées, qui multiplie les propositions visuelles et dont la richesse réside dans sa dimension hétéroclite. Mais cet éclatement des récits est également le principal défaut d’un film qui ne parvient pas toujours à trouver une véritable synergie entre ses différentes parties. Les témoignages en constituent ainsi le cœur battant, mais se percutent aux mises en scène plus théâtrales qui brisent la continuité émotionnelle du film. Parmi ces séquences, on trouve, par exemple, une reconstitution onirique du départ des réfugiés devant un navire figé dans la glace ainsi qu’une danse cathartique de trois corps féminins portant sur leurs visages des tatouages orientaux comme des stigmates. Isolés, ces éléments sont d’une grande beauté esthétique et symbolique mais leur accumulation est bancale à cause d’un montage qui se débat avec un trop-plein de signifiants. C’est ce qui se passe également avec la voix off qui accompagne les archives personnelles et redouble le propos, diminuant ainsi la portée évocatrice et énigmatique des images.
On sent ainsi une volonté d’explicitation dispensable à cet essai qui aurait gagné à laisser des zones d’ombre. Les images si fortes et chargées de sens se heurtent ainsi à une dialectique trop rigide, là où l’on aurait souhaité plus de simplicité et une économie de moyens et de mots. Cependant, si ces écueils esthétiques agacent, parce qu’ils entravent un film dont on ressent à chaque instant le potentiel poétique, ils n’enlèvent rien à la sincérité pénétrante qui hante l’ensemble du documentaire. D’autre part, en le prenant comme un collage et en faisant abstraction de certaines lourdeurs, Damascus Dreams est une mine d’élans politiques et sensibles dont la richesse rend son visionnement indispensable.
Lors de sa première au Festival du nouveau cinéma, cette richesse s’est incarnée, le temps d’un échange avec les spectateurs, en quelques larmes sublimes de l’une des participantes et en un monologue en arabe devant un Cinéma impérial muet. Dans cette langue étrangère, il y avait l’éclat d’une identité syrienne certes, mais aussi canadienne qui se recompose au gré des larmes et des sourires de ses citoyens. La plupart des gens dans la salle n’ont, sans doute, rien compris aux mots de cette dame, et ce malgré les efforts de l’interprète… heureusement, les émotions n’ont jamais eu besoin de traduction. (Samy Benammar)

prod. Trance Films
WOOD AND WATER
Jonas Bak | Allemagne/France | 2021 | 79 minutes | Panorama international
Une mère (Anke Bak) vient de prendre sa retraite. À Freiburg, aux abords de la picturale Forêt-Noire, elle compte les jours : ses enfants doivent rentrer pour des vacances. Mais Max, son fils, lui annonce être pris à Hong Kong : les manifestations contre l’amendement de la loi d’extradition ont paralysé l’aéroport. Considérant le vide qui se profile devant elle — visiblement insatisfaite au comble d’une vie isolée, passée à servir sa paroisse — Anke décide donc de faire le grand saut et de s’envoler pour Hong Kong. Projet de famille tourné en 16 mm chaleureux (évoquant ces « films de familles » d’un autre temps) ce premier film de Jonas Bak est une œuvre d’une douceur captivante, entre documentaire et fiction. De plus, Bak trouve, dans le tumulte des manifestations hongkongaises de 2019-2020, un arrière-plan inespéré par lequel aborder la dépression, la solitude, de même que l’horizon de possibilités que peut susciter (aussi évident cela puisse paraître) le déracinement et le choc culturel. Jurant dans le décor, son personnage arrive à Hong Kong et n’y verra pas son fils. Plutôt, elle occupera les espaces de celui-ci comme un fantôme et ira à la rencontre d’une ville et de ses habitants : une vacancière au terme de son périple, un garde de sécurité sympathique qui l’accompagne manger un bol de nouille, un activiste mélancolique dans un minibus, un diseur de bonne aventure dans un recoin typique d’un shopping arcade et ainsi de suite — jusqu’à ce que quelque chose du caractère de cette mère, initialement inscrutable et dure comme du bois, nous soit révélé. Heureusement, Bak ne fait pas qu’instrumentaliser la crise au profit d’un récit d’émancipation occidentale : il profite également des rencontres de son personnage pour communiquer quelque chose de l’unique caractère hongkongais — chaleureux, résilient, batailleur — qui est en jeu aujourd’hui. Dans la rencontre des deux sensibilités, il dessine un premier film tout simple, mais étonnant, se mouvant à un rythme particulier : entre le wanderlust allemand et le be like water des manifestants. (Ariel Esteban Cayer)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Berlinale 2021

prod. Popiul
ZERIA
Harry Cleven | Belgique | 2021 | 61 minutes | Temps Ø
Zeria est transcendant à bien des égards. C’est un film qui transcende d’abord le drame biographique rétrospectif de son narrateur, l’amalgamant à un récit d’anticipation opportun qui traite d’un exode martien lors duquel son petit-fils est né et tous les vieux ont été abandonnés sur la Terre croupissante. Il prend la forme d’un monologue imagé, adressé par l’aïeul à son descendant par-delà les astres et le temps, narrant le cours amer d’une vie sombre dont il a tout de même gardé de beaux souvenirs. Le résultat est une œuvre dure, tout en teintes de gris, où les décors pluvieux, brumeux, oppressants sont constitués de maquettes d’inspiration brutaliste et où chaque membre de la distribution porte un masque angoissant digne d’une toile d’Edvard Munch. Pour l’occasion, Cleven et son équipe minuscule d’irréductibles artisans déploient un tel éventail de techniques expressives qu’ils transcendent même le pouvoir d’évocation douloureux de la réalité ouvrière wallonne, recouvrant celle-ci d’un vernis funèbre qui apparente l’œuvre à un cauchemar expressionniste teinté d’une mince lueur d’espoir, vectrice d’une ouverture particulièrement salutaire dans les circonstances. L’humilité de la production, finalement, transcende le caractère colonialiste d’un certain cinéma de genre contemporain (celui du remâché surtout, des It [2019], Spiral [2021] et autres Halloween Kills [2021]), produit à grands frais et à grand renfort publicitaire, mais exempt de la charge affective ici présente.
Ce qui nous frappe le plus lors du visionnage, c’est l’étrange pouvoir d’immersion des tableaux et des ambiances propres au récit lugubre du narrateur, qui relate son enfance trouble auprès d’un père violent, puis sa relation douloureuse avec une femme, Madeleine, mère du garçon titulaire dont il partageait l’amour avec un autre homme. Ce pouvoir d’immersion provient du concours de plusieurs éléments : une caméra curieuse, avare de détails pittoresques, un travail sonore rigoureux, la prégnance des éclairages atmosphériques, une voix off qui jamais ne nous quitte et confère une valeur intime à chaque vignette, un florilège d’images oniriques envoûtantes, de même qu’une direction artistique inventive et minutieuse, qui permet à chaque environnement de contribuer sa propre puissance émotionnelle à l’ensemble. Qu’il s’agisse des rues détrempées du quartier ouvrier carcéral où grandit le héros, de l’appartement « trop petit » où il échoue avec ses parents (représenté par un studio carré saturé de meubles), des rêves érotiques de son enfance, où des langues démesurées remplacent les tentacules de la pornographie céphalopode, même de l’espace intersidéral où il s’imagine voir progresser la nef transportant Zeria (rendu à l’aide de cristaux scintillants et d’exhalaisons brumeuses), tous les lieux diégétiques distillent une sensibilité crue et un imaginaire foisonnant, garants d’un réalisme émotionnel modulé par le recours variable à la caricature. On pourrait presque dire qu’il s’agit ici d’un film de lieux avant d’être un film d’humains tant l’attention accordée à leur conception est impressionnante, mais ce serait sans compter sur le fait que les lieux constituent aussi les gens, envisagés comme la somme totale des souvenirs qu’ils y ont développés. (Olivier Thibodeau)
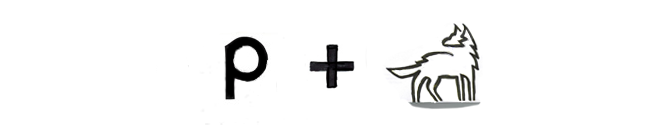
PARTIE 1
(Introduction, Les oiseaux ivres, The Power of the Dog, Sycorax)
PARTIE 2
(Celts, Extraneous Matter, North Shinjuku 2055, Wheel of Fortune and Fantasy)
PARTIE 3
(La contemplation du mystère, Damascus Dreams, Wood and Water, Zeria)
PARTIE 4
(Earwig, Saloum, What Do We See When We Look at the Sky?,
The Worst Person in the World)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
