
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. JP Production
NO BEARS
Jafar Panahi | Iran | 2022 | 107 minutes | Les incontournables
On s’en fait pour Jafar Panahi dès les premiers instants du film, qui débute sur une scène tournée dans une rue commerciale d’une grande ville. Sachant que le réalisateur pâtit d’une interdiction de tourner depuis 2010 (étant même présentement emprisonné), on aimerait lui dire qu’il n’est pas conseillé de travailler dans un lieu public très fréquenté. La scène se poursuit, détaillant l’histoire d’un couple décidé à fuir l’Iran avec de faux passeports… jusqu’à ce que la caméra se rétracte et dévoile le réalisateur devant son ordinateur dans une cambuse villageoise, donnant des indications à son cadreur à travers une oreillette. C’est bon ! Il est sauf ! Panahi est bien plus intelligent que nous après tout. Mais il semble surtout très lucide ici, tristement lucide, dépouillé de sa fougue et de son optimisme habituels, un homme qui semble soudain prendre conscience que ses bravades répétées — les quatre films tournés clandestinement depuis 2010 — risquent de le rattraper. En cela, No Bears apparaît comme un film crépusculaire, un film qui porte tout autant sur le désir de s’insurger contre la répression artistique, grâce à l’acte magique de mettre en scène la mise en scène, que sur la peur que peut ressentir son auteur se faisant.
En effet, malgré l’humour attendu qui caractérise la première partie, durant laquelle les villageois de Jabar, où le réalisateur est caché, révèlent leurs idiosyncrasies, le film devient vite tragique, alors que la comédie prend une tournure de plus en plus dramatique, évoquant l’absurdité d’une chasse aux sorcières aux conséquences très tangibles. Jabar se situe tout près de la frontière turkmène, et on croit d’abord qu’il s’agit là de l’ultime pied-de-nez au gouvernement iranien de la part de Panahi : se mettre en scène sur la frontière en tissant un récit de personnages qui fuient le pays. Or, c’est sa propre peur qu’il immortalise en fait, à l’occasion d’une scène nocturne où il hésite longuement à emprunter le chemin des passeurs vers un lieu de tournage dont lui parle son cadreur, se retrouvant finalement pile sur la frontière, dont il détalle anxieusement dès qu’il s’en rend compte. Ceci marque d’ailleurs le début de la fin pour lui, puisqu’il se retrouve ensuite mêlé à un litige qui mobilise tout le village, après avoir supposément pris une photo d’un couple d’amoureux interdit. L’histoire dégénère rapidement, dû aux traditions dogmatiques de l’endroit, et se déploie inexorablement vers un dénouement tragique, qui vient entacher d’une façon notoire l’impeccable humanisme de l’auteur. Pas par mesquinerie bien sûr, mais par une sorte de fatalisme qui vient nous crever le cœur. De même, les mises en abyme ne revêtent plus seulement ici une valeur ludique, mais servent à montrer un réalisateur qui perd contrôle de son cinéma, un réalisateur dont le cinéma se retourne contre lui et l’accable. Lorsque le film se termine, sur un plan de lui qui endure les signaux sonores incessants qu’émettent le tableau de bord de son camion avant d’activer le frein à main pour s’arrêter, c’est une tragédie absolue. On verse une larme en espérant qu’il ne s’agisse pas là d’un adieu. (Olivier Thibodeau)

prod. Dongyu Club, Fusee, Happinet Phantom Studios, Loaded Films, Urban Factory, W
PLAN 75
Chie Hayakawa | Japon/Philippines/France/Qatar | 2022 | 112 minutes | Panorama international
C’est avec une exquise subtilité que Chie Hayakawa met en scène ce récit d’anticipation troublant, caustique et opportun, adapté du segment éponyme qu’elle avait conçu pour Jû-nen : Ten Years Japan (2018). Faisant le pari de la sobriété, observant avec un détachement presque documentaire la chorale de ses personnages, elle ne tombe jamais dans le mélodrame, laissant l’horreur s’inscrire dans l’extrême vraisemblance de sa diégèse et le déroulement anodin des péripéties, profitant d’un clair-obscur étudié pour suggérer un monde crépusculaire où les soins gériatriques se résument désormais au suicide assisté. Face au phénomène du vieillissement de la population, le gouvernement japonais introduit le plan 75, visant à accompagner vers la mort toutes les personnes volontaires âgées de 75 ans et plus, encouragées à mettre fin à leurs jours pour mieux bénéficier la société. Suivant trois personnages révélateurs (une vieille dame solitaire, un jeune fonctionnaire qu’on croirait vendeur de chars et une aide-soignante philippine qui devient bourreau des aîné.e.s), le film aborde la question de trois angles distincts, complémentaires dans la mise en contexte d’un problème protéiforme, lié surtout à l’atrocité d’un système économique anthropophage. Or, c’est dans le déroulement de leurs existences banales, plus que dans tout discours déclamatoire que la critique sociale prend forme, dans un humanisme entier, antithétique de l’humanisme factice des pouvoirs à l’écran, aidé par une caméra qui s’attarde longtemps sur les personnages et les lieux, question d’inviter le spectateur à la réflexion à savoir s’il s’agit vraiment là du monde qui nous attend dans nos propres sociétés vieillissantes…
« Le Japon possède une fière tradition de sacrifice de soi », écrit dans sa lettre d’adieu le meurtrier d’un groupe d’aînés dans les tout premiers instants du film. C’est la clé de voûte du discours diégétique que nous livre dès lors Hayakawa. Dans l’art du phrasé, dans le fait que le sacrifice réfère autant ici à l’abnégation qu’exige le jeune homme de la vieille génération qu’à son propre suicide pour la cause de leur extermination. Dans la confusion entre l’idée de se sacrifier et de se donner en sacrifice, ambiguïté sur laquelle jouent les pouvoirs japonais depuis la nuit des temps, et dont profitent aujourd’hui les puissances économiques mondiales. Or, c’est l’envers du concept de sacrifice que la réalisatrice œuvre ici à démontrer, dans des allusions plus ou moins subtiles, mais toujours sournoisement réalistes à une sorte d’holocauste capitaliste. Lorsque, par exemple, le jeune fonctionnaire, aussi testeur de mobilier urbain anti-SDF, réalise où sont acheminés les restes des défunts, ou lorsque les employés de l’hôpital trient les objets de valeur des individus euthanasiés, dans des scènes qui rappellent Auschwitz, mais de cette façon aseptisée et acceptable qui est désormais la voie d’une entreprise privée de laquelle les gouvernements sont devenus subalternes. On pourrait aussi bien rire de la proposition dramatique de Hayakawa, si seulement on parvenait à s’imaginer qu’elle était farfelue… (Olivier Thibodeau)

prod. Loud Whisper Productions, Outside Line Studio
BEFORE I CHANGE MY MIND
Trevor Anderson | Canada | 2022 | 89 minutes | Compétition nationale
Faîte incontestable de la filmographie d’Anderson (malgré le charme unique de The Man That Got Away, 2012), Before I Change My Mind se profile à la fois comme une intraveineuse de pure nostalgie et une irrésistible variante queer sur le conte initiatique traditionnel. On pourrait même dire qu’il s’agit d’un film-somme pour cet auteur atypique, qui s’en donne ici à cœur joie, poursuivant avec panache la mise en scène uchronique de sa propre enfance, ainsi que ses délirantes expérimentations musicales. Dans son admirable fougue, il va même jusqu’à se donner le rôle d’un flamboyant metteur en scène diégétique, auteur d’une comédie musicale intitulée Mary Magdalene Video Star, parodie féministe de l’opéra-rock d’Andrew Lloyd Webber. Débordante de musique rappelant les années 1980, dont de nombreuses pistes où résonnent glorieusement les synthétiseurs et les keytars sur fond de bruitages vidéo, lustrée de couleurs chatoyantes et peuplée d’extraordinaires acteurs adolescents (comme des poupées de faïence géniales), la production du film est aussi particulièrement invitante, voilant de sa beauté envoutante le courant de tragédie larvé qu’on retrouve au cœur du récit.
Fraîchement arrivé.e de Spokane, dans l’état de Washington, Robin (charismatique Vaughan Murrae), débarque dans sa nouvelle école secondaire en banlieue d’Edmonton au beau milieu d’un cours d’éducation sexuelle. Invité.e à s’asseoir parmi les élèves sur le sol du gymnase, Robin se place pile entre le groupe des filles et celui des garçons, assumant ainsi fièrement la non-binarité que laisse présager son look androgyne. De là, iel remarque le fougueux Carter (complexe Dominic Lippa), un dur au cœur tendre qui deviendra dès lors l’objet de son affection, au sein d’une relation bourgeonnante que viendra complexifier l’arrivée soudaine de l’attachante Izzy (impressionnante Lacey Oake). Les péripéties amoureuses de son père (un Matthew Rankin étonnamment sobre) viendront quant à elle révéler le pan adulte de l’ennui local, où solitude rime avec alcoolisme. La relative douceur du regard infantile se heurte ainsi à la dure réalité d’un milieu sociale oppressant, recréé avec moult détails pittoresques, caractérisé par l’abandon parental, l’abus d’alcool et l’impératif de mesquinerie interpersonnelle lié au désir d’appartenance. Ne perdant jamais de vue le réalisme social, Anderson refuse pourtant d’y voir une prison, comme c’est le cas pour l’identité de genre, qu’il œuvre depuis toujours à déconstruire (voir à ce sujet l’excellent The Little Deputy de 2015). Fréquemment humoristique, son exploration des mœurs adolescentes bénéficie pour ce faire d’une mise en scène impressionniste qui participe à la fois d’un jeu fantaisiste à l’intention du spectateur et d’une façon de cristalliser sa propre perspective intime sur un récit apparemment autobiographique (si l’on en croit les références réitérées à quelques traumatismes abordés dans ses films précédents). On note ainsi la présence d’inserts tournés en VHS qui semblent toucher à la fois à une sorte de mémoire personnelle (dans les souvenirs de la mère), mais aussi à des fragments de mémoire collective (dans les souvenirs de cette fantastique institution locale dont on susurre le nom à travers toute sa filmographie, le West Edmonton Mall). Fort d’une carrière de 15 ans cruellement méconnue (mais que le Festival déterrera cette année), Trevor Anderson vient peut-être de trouver son billet hors de l’anonymat avec ce film remarquable, pour moi l’un des meilleurs de l’année. (Olivier Thibodeau)

prod. France 3 Paris Île-de-France, La Compagnie des Indes
JERK
Gisèle Vienne | France | 2021 | 60 minutes | Temps Ø
Fruit d’une collaboration de longue date entre la dramaturge et chorégraphe Gisèle Vienne et l’auteur Dennis Cooper, Jerk reproduit au cinéma la pièce composée par le duo en 2008, solo de ventriloquie horrifique et captivant. Vienne s’attarde ici avec attention sur la performance magistrale de Jonathan Capdevielle en David Brooks, jeune tueur qui, avec ses complices, a séquestré, mutilé et agressé une vingtaine de jeunes garçons au cours des années 1970. C’est par un dispositif visuel d’une franche sobriété que se meut l’adaptation filmique, reproduisant à première vue la structure d’une captation théâtrale. Alors que Capdevielle, filmé en un long plan-séquence au centre d’une scène obscure, sort de son sac quatre marionnettes délabrées, la caméra d’emblée semble intruse : dès que l’acteur débute son adresse, son regard ne se braque pas sur l’objectif mais l’évite, traquant un public hors-champ dont les chuchotements apparaissent tour à tour rieurs ou effarés.
Si le texte de Cooper, qui se déplie en une suite de scènes meurtrières, ne porte aucun intérêt à la moralité de ses sujet violents, il ne se situe pas pour autant dans un désir de pure provocation. Vienne s’attarde davantage aux jeux de transvasement des rôles fantasmés, à l’accumulation de dispositifs de captation des tueries, sous la caméra Super 8 que pointe Brooks sur les corps mutilés. Les cadavres prennent vie sous le contrôle des meurtriers, se muant eux-mêmes en figures de marionnettes, corps inertes disponibles à la transformation chimérique.
L’inquiétude initiale quant à la pertinence au cinéma d’une œuvre dont l’intérêt premier se situe dans l’incrédulité que génère la performance physique de son acteur principal s’efface ici rapidement, tant le plan rapproché sur le visage de Capdevielle génère successivement la fascination et l’impression d’une proximité obscène. C’est avant tout ce corps acharné qui subjugue, ce visage transi, quasi-immobile durant les séquences de ventriloquie alors que sa bouche évacue des coulées de bave ou des borborygmes incessants qui ponctuent la violence du récit. Si de Jerk, mon instinct premier était de ne révéler que le strict nécessaire, de conserver comme intouchées ses secousses affectives, c’est finalement que Vienne doit bien avoir réussi quelque chose dans ce déplacement transversal de l’intimité théâtrale, en composant au cinéma l’impression d’une véritable présence de corps. (Thomas Filteau)
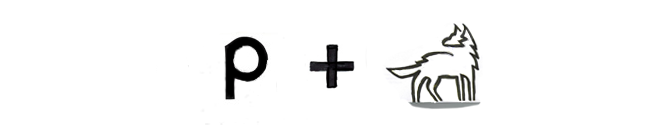
PARTIE 1
(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)
PARTIE 2
(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,
Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)
PARTIE 3
(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)
PARTIE 4
(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)
PARTIE 5
(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)
PARTIE 6
(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,
Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)
PARTIE 7
(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)
PARTIE 8
(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)
PARTIE 9
(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
