

prod. EED// Productions
CELTS (KELTI)
Milica Tomović | Serbie | 2021 | 106 minutes | Panorama international
La puissance d’évocation de Celts réside avant tout dans la vraisemblance absolue de son récit domestique, falot face au drame humanitaire qui lui sert de trame historique. Se déroulant presque en temps réel, dans la Belgrade de l’été 1993, le film fait la chronique d’une fête pour enfants durant laquelle les adultes discutent et cèdent à moult plaisirs désespérés (éthyliques, sexuels, narcotiques et nicotiniques), jusqu’à bousiller le gâteau d’anniversaire de la jeune Minja, fanatique des Tortues Ninja. La mise en scène, intime jusqu’aux inserts d’organes génitaux, proche du kitchen sink realism dans sa proximité des personnages, l’exiguïté de ses décors ouvriers, de même que sa représentation de la désillusion politique et du désir de liberté sexuelle, combinée à l’interprétation parfaitement naturelle des acteurs et au caractère banal des péripéties, contribuent ici à nous convier précisément là où le film propose de nous convier : une fête pour enfants dans la Serbie de Milošević. Au cœur d’une réalité qui pourrait bien être la nôtre, celle d’enfants épris de superhéros mutants et d’adultes tracassés par des problèmes sentimentaux, obscurcie par l’avancée de ténèbres génocidaires qui ne se profilent qu’en filigrane. L’œuvre revêt donc un caractère universel plutôt que spécifique, et c’est pour cela également qu’elle est si précieuse : pour sa représentation d’une humanité animée par un désir de bonheur immédiatement reconnaissable, qui menace de se muer en désir d’évasion devant l’expansion inexorable d’un pandémonium dont elle habite tant bien que mal les interstices.
La main de Majka glisse sensuellement sur les draps défaits du lit matinal, sous leur surface jusqu’à son entrejambe, qu’elle caresse ardemment alors que son mari taximan passe subrepticement à travers la pièce. Avant d’être un drame sur l’inflation écrasante qui sévit dans la nation serbe après les sanctions imposées par l’Union européenne, Celts est surtout une histoire de désirs prosaïques et d’impressions passagères, aussitôt palpables au cœur d’une diégèse qui partage presque tous les aspects du réel, gracieuseté d’une finesse d’observation scénique et psychologique hors pair, doublée d’un talent incroyable pour l’élaboration de déconvenues familières. Sous le drame macroscopique yougoslave se déroule donc une série de drames microscopiques (celui du jeune garçon au cardigan souillé de crémage, de la jeune femme aux prises avec ses règles, de l’épouse insatisfaite au lit, de l’enseignante frustrée par la nouvelle fréquentation de son ex-copine). Chaque détail scénique, chaque pièce bondée, chaque élan irrésistible qui anime les personnages (en quête de cigarettes, de whiskey, de gâteau, du cou gracile de la femme aimée ou de la porte arrière pour aller fumer du haschisch dans la cour), tout s’impose ici à notre conscience d’une façon éminemment tangible, nous rappelant que, derrière l’exercice vertical illégitime de pouvoirs politiques funestes partout à travers le monde, se cachent des êtres qui nous ressemblent en tous points. (Olivier Thibodeau)

prod. Vandalism
EXTRANEOUS MATTER - COMPLETE EDITION
Ken’ichi Ugana | Japon | 2021 | 61 minutes | Temps Ø
Comment réconcilier l’érotisme grotesque de la pornographie céphalopode avec les bons sentiments de la science-fiction spielbergienne ? La réponse est beaucoup plus simple, et plus banale, qu’elle ne paraît : il suffit de faire un film à sketches. Il suffit de mélanger plusieurs idées sous le thème générique d’une invasion extraterrestre, pourvoyant ainsi une apparence de complexité à un récit éclaté de petites bestioles tentaculaires en papier mâché. Ajoutons à cela l’élégance éthérée de la photographie en noir et blanc et la langueur contemplative d’un certain cinéma d’auteur, et la série B de Ken'ichi Ugana, auteur de Ganguro Gals Riot (2016) et de Wild Virgins (2019), atteint presque le seuil de la respectabilité. C’est du moins l’impression que nous inspire l’œuvre de prime abord, se révélant finalement comme une variation légèrement polissonne et insolite sur quelques thèmes connus du cinéma de genre contemporain.
Les scènes de tentacules érotiques, limitées ici au premier segment, sont de facture extrêmement banale, requérant pour fonctionner le concours traditionnel d’une bande sonore bourrée de sonorités visqueuses et le jeu volontaire d’actrices enclines à faire gigoter de manière erratique les excroissances inertes des bestioles. Un peu comme à l’époque d’Ed Wood. L’entichement romantique que vivent les personnages pour les créatures, venues remplacer dans leur vie quelque amant.e inepte, s’inscrit quant à elle dans le sillon de d’autres drames de mœurs horrifiques comme Possession (1981) d’Andrzej Zulawski ou le quasi-remake d’Amat Escalante, La région sauvage (2016). Le second segment évoque quant à lui la comédie de bestiole gloutonne, façon Gremlins (1984), mais avec une plastique à mi-chemin entre celle d’Alien (1979) et d'Eraserhead (1977). Le troisième segment, lui, s’apparente plus spécifiquement au cinéma des Golden Boys, proposant même au spectateur une référence directe à E.T. (1982), alors que c’est d’un tentacule dressé plutôt que d’un doigt ridé que jaillit l’étincelle d’adieu des visiteurs à l’endroit des hommes, leurs amis serviables.
S’il ne réinvente pas la roue, Extraneous Matter demeure un film amusant, particulièrement pour les aventuriers découvreurs d’un certain cinéma bis, dont il exemplifie plusieurs facettes de façon ludique. En cela, c’est un film de son temps, une engeance postmoderne qui se vautre avec joie dans la référentialité et le mélange des styles, des esthétiques, des tons, revêtant une profondeur d’emprunt bien supérieure à celle de son récit, de même qu’un esthétisme plus prononcé que son pouvoir d’affect. Qu’à cela ne tienne, le spectacle vaut le coup pour les quelques soixante minutes qu’il dure, demeurant surtout très accessible, puisque doté d’une esthétique léchée, sans trop d’aspérités, reposant sur une imagerie ni trop proprette pour les amateurs du grotesque, ni trop dépravée pour les amateurs de cinéma mainstream. Le pont entre Mac and Me (1988) et Urotsukidôji (1989) peut-être ? Pourquoi pas… (Olivier Thibodeau)

prod. Deep End Pictures
NORTH SHINJUKU 2055 (KITA SHINJUKU 2055)
Daisuke Miyazaki | Japon | 2021 | 35 minutes | Temps Ø
Cinéaste que nous suivons avec intérêt depuis ses débuts, Daisuke Miyazaki détourne constamment les attentes. Chaque nouveau film qu’il réalise s’appuie sur un concept différent et arbore un style à l’opposé du film précédent. Yamato (California) (2016) présentait un récit identitaire sensible et moderne, Tourism (2017) se tournait vers l’esthétique du carnet de route au récit improvisé, puis Videophobia (2019) privilégiait une esthétique visuelle et narrative lorgnant vers une forme d’inquiétante étrangeté technologique. Avec North Shinjuku 2055, il fait un clin d'oeil à La Jetée (1962) de Chris Marker en proposant un film de science-fiction constitué d’images photographiques fixes dont le récit est raconté en voix off par les protagonistes.
Nous sommes dans le quartier de North Shinjuku en 2055. On nous présente d’abord deux personnages dans un lieu fermé qui se lancent dans une entrevue. L’un est journaliste et l’autre un habitant de longue date de North Shinjuku, l'un des seuls quartiers de Tokyo qui semble complètement autogéré par un comité mis en place par la communauté. Puisque celui-ci fonctionne en dehors des lois du pays et semble avoir peu d’écho médiatique, le journaliste investigue l’homme pour comprendre les particularités de ce lieu fermé qui ne semble pas suivre les évolutions du reste de la ville et découvrir ce qui se cache réellement sous l’apparence d’une autogestion de longue date. L’habitant du quartier se fait de plus en plus bavard au fil de la conversation, et il révèle que l’harmonie communautaire dissimule en fait un contrôle immémorial effectué par le crime organisé avec la bénédiction de policiers corrompus.
Le cinéaste se sert de nombreuses photographies du quartier et de ses habitants pour rendre ce lieu « fictif » bien réel. On y voit entre autre l’interlocuteur principal, qui y habite depuis des décennies et qui côtoie le milieu hip hop qui s’y est développé (c’est Han a.k.a. GAMI qui incarne ici le protagoniste et plusieurs autres artistes de la scène hip hop japonaise y apparaissent). Le montage des photos, la narration et le récit sous forme de questions-réponses apporte au film un certain suspense qui garde l’intérêt quant à l’auscultation de ce quartier futuriste à propos duquel Miyazaki propose moult réflexions sociales et politiques perspicaces. Avec son noir et blanc contrasté et son approche conceptuelle de photo-roman, North Shinjuku 2055 constitue à la fois un hommage astucieux au cinéma de Marker, lui-même à cheval entre le documentaire social et l’anticipation, de même qu’une utilisation habile du médium afin de prophétiser l’avenir possible d’un quartier déjà sclérosé par le crime organisé. (David Fortin)

prod. Neopa / Fictive
WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY (GÛZEN TO SÔZÔ)
Ryûsuke Hamaguchi | Japon | 2021 | 121 minutes | Les incontournables
Une roue de fortune et de fantaisie qui tournoie sur l’axe secret d’Hamaguchi l’élégant croupier : trois films-épisodes en un seul, huit personnages, trois couples sur le fil de la séparation et trois couples en dormance, faits d’anciennes amours, de fantômes perdus de vue, d’hallucinations nostalgiques qui guettent le bonheur tranquille ; les jeux sont faits sur le long de sa mise en scène stable où chaque zoom-in rapide, chaque travelling, toute emphase de la caméra a l’effet d’une secousse, d’une arête qui bouscule çà et là le hasard dans sa chute vers la certitude, point d’arrêt des trois nouvelles.
Avec cet ensemble de trois moyens métrages tenus ensemble, Hamaguchi poursuit son exploration du désir croisé de hasard, de rencontres entremêlées d’imaginaire, car la relation a chez lui ce pouvoir parfois transcendant, sinon magique, d’aborder par les creux du réalisme ce qu’on attend seulement des amours secrètes — des retrouvailles impossibles, des relations interdites, des conclusions inespérées —, toutes ces parts qui forment l’imaginaire de la rencontre sans nécessairement pouvoir rejoindre la réalité, au contraire même, car les trois récits semblent dire ici que l’impossibilité de la relation diffuse le désir plutôt qu’il ne le fait disparaître, comme une traînée de comète qui se désagrège, mourant dans sa visibilité. En retour, c’est pourquoi l’ennui de la conversation est chez Hamaguchi le fertile terrain d’une caractérisation détournant les stéréotypes, une platitude de façade où l’enquête émotive se mène en douce, pour mieux sonder les profondeurs sentimentales au risque d’approfondir les cratères du cœur, une approche qui n’a rien d’une complaisance, puisque le hasard, comme le désir, s’étirent ici à travers le temps, s’enfonçant dans des prémisses sentimentales que le cinéaste nous laisse découvrir au fil des indices qu’il dissémine et que son scénario parvient à boucler thématiquement d’un récit à l’autre.
Le premier épisode, « Magic (or Something Less Assuring) », débute dans l’anodin, par une conversation qui n’a d’autre fonction que d’établir les barrières qui séparent les personnages de leur rêve de rencontre « magique ». Le second épisode, « Door Wide Open », procède à l’inverse, en donnant l’heure juste dans sa première partie avant de se dissimuler dans la seconde pour mieux surprendre sous couvert d’un parfait scandale de l’ère #MeToo et d’un puissant geste symbolique (celui pour un professeur de vouloir garder la « porte ouverte » coûte que coûte). Le troisième, « Once Again », plus doux, épargné d’hommes, montre une platitude à deux, recouverte d’une découverte à deux, puis finalement un échange entre hasards singuliers, une manière pour Hamaguchi de conclure son récit amoureux en disant que le couple répond d’une économie de la rencontre qui est aujourd’hui mise à mal, à tort comme à raison, par des économies concurrentes (de relations de pouvoir ou de systèmes de communication) qui ne cessent d’empoisonner cette « magie » dont on rêve encore au début du film comme de la vie. Heureusement pour ces conclusions douces-amères, ce Wheel of Fortune and Fantasy si court, avec son jeu de relais si fluide, s’offrira facilement aux seconds visionnages, aux roues de fortune rembobinées et aux hasards suspendus de nouveau dans l’hésitation de la rencontre. (Mathieu Li-Goyette)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Berlinale 2021
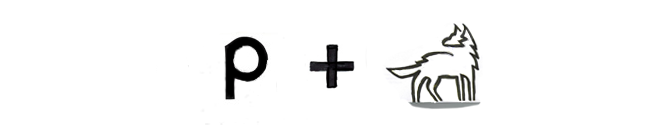
PARTIE 1
(Introduction, Les oiseaux ivres, The Power of the Dog, Sycorax)
PARTIE 2
(Celts, Extraneous Matter, North Shinjuku 2055, Wheel of Fortune and Fantasy)
PARTIE 3
(La contemplation du mystère, Damascus Dreams, Wood and Water, Zeria)
PARTIE 4
(Earwig, Saloum, What Do We See When We Look at the Sky?,
The Worst Person in the World)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
