
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. Hype Film, Logical Pictures, Bord Cadre Films, Arte France Cinéma, Charades, Razor Film Produktion GmbH, Sovereign Films
LA FIÈVRE DE PETROV [PETROVY V GRIPPE]
Kirill Serebrennikov | Russie | 2021 | 145 minutes | Les incontournables
Dans une tourmente pittoresque, faite d’incidents réels et hallucinatoires, La Fièvre de Petrov se manifeste comme une extravagante nuit de pérégrinations alcoolisées, préambule d’une longue virée déraisonnable, dans laquelle vapeurs d’eau de vie, toux grasse et froid sibérien givrent l’image et se confondent dans la grisaille ambiante. Passé, présent, et futur hypothétique fusionnent dès lors que quelque part en Russie post-soviétique, un dénommé Petrov, frappé par une épidémie de grippe foudroyante, monte à bord d’un bus bondé avec une forte fièvre. Il compte bien aller chercher son fils chez son ex-femme, pour l’accompagner à la fête costumée du Nouvel An, qui avait naguère fait la joie de son enfance. Précipité par son ami Igor (Yuri Andreyevich Kolokolnikov), croque-mort sosie de Walter White qui l'entraîne dans un corbillard, il se retrouve dans un enchevêtrement embrouillé, fait de longs plans séquences jouant machinalement avec l’espace-temps, même au-delà de son lointain et imprédictible retour au bercail, où la mère (Chulpan Khamatova), comme l’enfant, Petrov Jr. (Vladislav Semiletkov), ont aussi contracté le terrassant virus et délirent distinctement.
Adapté du roman Les Petrov, la grippe, etc. d’Alexeï Salnikov (Éditions des Syrtes, 2020), le film n’a cure du coronavirus actuel à l'issue incertaine. Le récit fut écrit antérieurement à cet épisode morose de notre histoire récente. Le mal qui court et gagne peu à peu toutes les strates de la société est une allusion directe à la corruption généralisée de la Fédération. On peut compter sur l’humour caustique et l’horreur gore pour supporter la brutalité ambiante, faite d’une violence crue et omniprésente, qui a mainmise sur les derniers élans d’une tendresse nostalgique, et n'épargne pas les enfants. C’est un voyage-délirium, dans les limbes d’un empire brisé où s'assombrissent les destins de chacun, en générant une frustration de chaque jour et de chaque instant. Ne reste que le fantasme brut et les mécanismes de répression et d'obsession pour se décompenser, venant élire la pulsion comme enfant roi de la nation.
Noun nous trouvons ainsi conviés à une déambulation empirique, entre rêve et réalité, faite tout autant, sinon plus, de dimensions folkloriques et lyriques, dans une profusion chaotique de tableaux étonnants qui n’est pas sans rappeler le Holy Motors (2012) de Carax. Ces dimensions permettent, du même fait, au dissemblable « réalisme magique » de Gomes de consentir à devenir un vague cousin du « fabuleux réalisme » de Serebrennikov, en puisant non pas dans une facture documentaire absente, mais dans une fiction inspirée du misérabilisme de la réalité. C’est l’écho de la critique sociale d’un peuple désarçonné se payant le luxe d’allégories ou de cadavres exquis surréalistes (Les Mille et Une Nuits, 2015), c’est le rappel du moment où la poésie narrative et les rapports humains s’enjoignent dans un amas de souvenirs teintés de fantastique, dans des plans en couleurs et en noir et blanc transcendant les époques et magnifiant les femmes (Tabou, 2012). Dont, ici, la présence éthérée de Marina (Yuliya Peresild) en « Snégourotchka », (la fille de neige), figure récurrente du film, qui évoque une Russie d'antan jadis féconde — berceau de l’enfance du protagoniste — aujourd’hui moribonde sous Poutine, dans une société conservatrice dont la folie et la déraison persistent et signent. Cinéaste dissident, Kirill Serebrennikov, en procès au moment du tournage, puis assigné à domicile, nous propose ironiquement un film « absurde et schizophrénique », au même titre qu’il qualifiait les accusations du gouvernement russe à son intention. (Anne Marie Piette)

prod. El Pampero Cine
LA EDAD MEDIA
Alejo Moguillansky et Luciana Acuña | Argentine | 2022 | 90 minutes | Panorama international
Si Coma (Bertrand Bonello, 2022), présenté lui aussi cette année au FNC, était conçu comme un film sur l’isolement pandémique solitaire, générateur d’inquiétantes rêveries, La edad media se compose comme son pendant communautaire, s’intéressant davantage à l’espace domiciliaire partagé et aux conflits occasionnés par la contiguïté des corps confinés. Semi-autobiographique et pleinement autodérisoire, le film met en scène Moguillansky et Acuña en versions décalées d’eux-mêmes, couple d’artistes (lui réalisateur, elle danseuse et actrice) tentant tant bien que mal de poursuivre leurs projets en cours malgré l’injonction à l’immobilité. Au centre du récit (et de la maison, toujours installée à la table de la cuisine) réside toutefois Cleo, leur jeune fille qui se pose en observatrice de ce désir parental de productivité absurde et angoissé.
Le contexte de la quarantaine se prête instinctivement aux questionnements usuels de Moguillansky, soit le rôle ambivalent du geste créatif dans un contexte capitaliste.« Nous sommes une usine, et si l’usine ne produit plus, elle fera faillite » déclare Acuña. Surtout, c’est par l’impulsion de Cleo d’obtenir coûte que coûte un télescope, afin d’observer la lune à partir de la terrasse de la maison, que se joue l’absurdité du fossé entre usage et valeur qu’explore le film. Progressivement et à l’insu de ses parents, elle débarrasse la demeure de tous ses objets de valeur en espérant amasser le pécule nécessaire à l’achat. On retrouve dans le formalisme narratif de l’œuvre plusieurs marqueurs du cinéma de Mariano Llinás (La flor, 2018), pour lequel Moguillansky est le monteur, dans l’importance accordée à la narration et dans la structure divisée en chapitres par des intertitres. Honnêtement comique, La edad media s’assoit sur un cabotinage slapstick mené par la co-présence des corps dans l’espace restreint. Les parents poursuivent leur fille dans la maison devenue labyrinthique alors que s’y dessinent des passages obliques, dans les mouvements de Cléo qui saute à travers les fenêtres, qui circule ou sommeille dans la cour intérieure. Tout le projet semble ainsi s’axer autour d’une transmutation de l’ennui (« toujours pire lorsqu’il est partagé », dira Cléo), une reconfiguration de la topographie stricte de l’espace quotidien en un lieu de plaisir et de création. (Thomas Filteau)

prod. Eagle Vision
DIASPORA
Deco Dawson | Canada | 2022 | 140 minutes | Compétition nationale
Comme nombre de ses collègues passés par le Winnipeg Film Group, Deco Dawson a débuté sa carrière par l’expérimentation, faisant parfois de l’animation avec ce grain de folie que l’on connaît bien des artistes winnipegois. Entre 1998 et 2014, il signe une dizaine de courts et un projet photographique sur la ville de Detroit qui témoignent notamment de son intérêt pour l’histoire culturelle canadienne et pour l’architecture urbaine. Après dix ans d’absence en fiction, Dawson reprend ces thèmes pour son premier long métrage, une œuvre somme toute ambitieuse, malgré sa sobriété formelle, qui impressionne d’emblée par le fait d’être un film multilingue tourné en vingt-cinq langues (!), de l’afrikaans au vietnamien, et dont seul l’ukrainien est sous-titré. C’est dans ce pari (un peu fou pour sa durée) que se loge l’intelligence du film, qui sans recourir à beaucoup plus qu’à ce déroutant dispositif langagier — où chacun affiche et parle sa langue sans complexe, c’est-à-dire sans se faire comprendre ni du personnage principal ni du spectateur moyen — traduit la solitude et l’isolement de l’immigration moderne au Canada.
Dans son très beau documentaire Jean Giguère : la mesure d’un endroit (2014), la bénévole Jean, filmée par Dawson, répond à sa propre question à propos de Winnipeg : « Qu’est-ce qui définit une grande ville ? Elle doit avoir un milieu culturel et artistique très fort, sinon elle n’a pas d’âme, pas de pouls. » Mais qu’est concrètement cette culture en-dehors du foisonnement artistique que l’on connaît de Winnipeg ? En apparence, des enfilades d’échoppes aux enseignes défraîchies qui témoignent autant du délabrement d’une ville pourtant active que de la diversité des communautés qui l’ont fondée (en créant ses industries manufacturières, ses commerces de détails, etc.). Dawson prend donc le pouls d’une ville en quasi ruines en observant ses murs au travers des déplacements solitaires d’Eva, débarquée d’Ukraine dans le North End — quartier historique de la diaspora ukrainienne où vivent aujourd’hui retranchées toute sorte de communautés sujettes à toute forme d’hostilité. On ne connait pas la raison de son immigration. Le seul appel avec sa mère restée au pays, qui ne s’enquiert de rien, car rien n’importe plus que des considérations matérielles (avoir un toit, de la nourriture et un emploi), ne console pas la solitude d’Eva. Alors la quête de la familiarité, décevante au bout du fil, elle la poursuit dans des objets inanimés comme ces VHS de films ukrainiens (qu’elle tente vainement d’acheter avant d’en voler plus tard), tel ce bibelot, acheté aux puces, identique à celui qu’avait sa grand-mère, et ces bâtiments aux portes désespérément closes comme ce magasin de bric-à-brac importé d’Ukraine et cette église orthodoxe aux clochers bulbeux rassurants qui finalement abritera un prêtre philippin et sa communauté. Dans ce couloir multiethnique de l’actuel North End, Eva suit les traces d’une diaspora ukrainienne en absence d’elle-même. La fin douce-amère, que certains trouveront énigmatique, nous renseigne toutefois sur la posture de Dawson, lui-même issu de l’immigration ukrainienne mais élevé à l’abri de celle-ci. C’est le double intérêt du film que de nous renseigner modestement, par l’observation (façon slow cinema, comme certains l’appellent), autant sur l’économie architecturale que sur l’économie humaine de Winnipeg : les deux étant sujettes à l’effritement de l’autre. (Élodie François)

prod. AZ Celtic Films, BBC Film, PASTEL, Screen Scotland, Tango Entertainment, Unified Theory
AFTERSUN
Charlotte Wells | Royaume-Uni | 2022 | 98 minutes | Compétition internationale
Impressionnant premier long métrage pour l’Écossaise Charlotte Wells, cette chronique de voyage ensoleillée cache une belle complexité dramatique derrière sa facture anodine, comme elle cache une lancinante amertume derrière la gaieté du duo père-fille qu’elle nous montre lors de ses vacances dans un tout-inclus en Turquie. Et si Aftersun semble si proprement cinématographique, ce n’est pas simplement grâce aux quelques élans réflexifs où Wells met en scène la jeune Sophie (mémorable Frankie Corio) en train de filmer son voyage avec sa caméra numérique, mais dans sa fonction mémorielle analogue de cristalliser l’essence-même d’un souvenir évanescent. À ce titre, la réalisatrice fait preuve d’une intelligence surprenante dans la mise en scène, démontrant une sorte de maîtrise désinvolte dans ses cadrages, qui semblent à la fois approximatifs et soigneusement composés, parfaitement évocateurs d’une sorte de moment vécu dont la texture nous est toujours immédiatement intelligible. Même les fulgurances conceptuelles, les travellings révélant quelque détail pittoresque sur une surface réfléchissante par exemple, possèdent cette aisance aérienne d’une cinéaste amateure particulièrement inspirée.
Le scénario qu’elle signe est tout aussi vraisemblable, rendant l’humanité des personnages dans toute son indicible complexité, multipliant les zones d’ombres mystérieuses quant aux humeurs que cachent ceux-ci derrière leur bonne humeur circonstancielle. La figure du père (touchant Paul Mescal) est exemplaire à cet égard, lui qui semble plombé par une mélancolie dont les contours restent suggérés, enfouis sous le voile de la joie forcée essentiel à l’exercice de la paternité. En somme, c’est l’essence même de la vie qui se profile ici sous nos yeux, tissée de beaux moments ordinaires (du plaisir de la nage, des rencontres fortuites ou de pitreries spontanées), mais aussi de toutes ces douleurs secrètes qu’il faut taire pour faire croire qu’on est heureux aux gens qui y tiennent. C’est la beauté de quelque impression passagère (d’un reflet boueux ou aqueux), de quelque geste (la confection d’une tresse ou l’application de la crème solaire), mais aussi l’horreur innommable de quelque blessure profonde, que la caméra nous permet d’entrevoir au sein d’une exploration savante de ce qu’on pourrait optimalement décrire comme l’intimité perceptuelle.
Aftersun est beaucoup plus qu’un simple film de voyage ; c’est un texte hyper complexe qui est sûr de générer de stimulantes discussions entre spectateurs quant au sens profond qu’il revêt, sens que l’on devine tout au long du récit, mais sans jamais pouvoir le cerner totalement. C’est un film qui respecte l’intelligence de son public en lui fournissant des indices sans pourtant lui offrir de clefs de lecture sur un plateau d’argent, multipliant les séquences symboliques passagères à la manière des pièces d’un puzzle qu’il incombera aux curieux de rapiécer ensuite. S’agit-il d’un moment de félicité perdu, d’un souvenir tragique ou cathartique, de la chronique d’un rapprochement, voire celle d’un adieu que Wells consigne à l’écran ? Il semble que toutes ces réponses soient valides tant la générosité discursive est grande dans ce petit film. (Olivier Thibodeau)
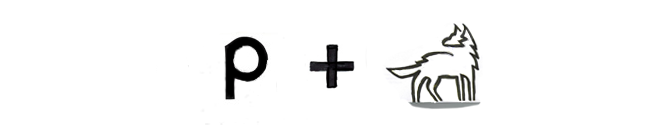
PARTIE 1
(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)
PARTIE 2
(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,
Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)
PARTIE 3
(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)
PARTIE 4
(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)
PARTIE 5
(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)
PARTIE 6
(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,
Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)
PARTIE 7
(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)
PARTIE 8
(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)
PARTIE 9
(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
