

prod. Películas María S.L.
HISTORIA DE PASTORES
Jaime Puertas Castillo | Espagne | 2024 | 80 minutes | Les nouveaux alchimistes
Proposant une heureuse rencontre entre le conte pastoral et la période désolée de l’Anthropocène, Historia de pastores, premier long métrage de l’Espagnol Jaime Puertas Castillo présenté en première mondiale au Festival international du film de Rotterdam en février dernier, ravit par son maniement poétique de l’anachronisme et sa capacité à offrir, par le biais d’une réflexion sur la présence des ruines dans la chair vivante du présent, une lecture critique de notre époque.
Le film nous plonge in medias res dans le quotidien de Mari, géologue en stage au Musée d’archéologie et d’ethnographie du village de Don Fadrique (lieu de naissance du réalisateur), dans la province de Grenade, au moment où sa collègue lui apprend que l’un de leurs internes a découvert une roche à la composition mystérieuse sur l’un de leurs sites de recherches archéologiques, découverte qui suscite l’émoi des médias locaux. Préférant se concentrer sur ses recherches doctorales que d’accueillir une horde de journalistes venus couvrir la nouvelle, Mari se met en route vers les vestiges des fermes du village sur lesquelles porte sa thèse. Alors que la géologue sillonne le paysage désertique des environs, elle découvre, au milieu d’un troupeau de moutons, José, un berger dont le bras droit est couvert d’étranges plaies à la cause inconnue, qu’elle transporte prestement à l’hôpital. Lorsqu’à sa sortie des urgences, Mari s’enquiert de la nature des blessures du berger, il lui répond sans ironie aucune — clin d’œil à David Lynch ? — que selon le médecin, l’internet en serait la cause. À partir de cette scène, les éléments fantastiques (dont certains empruntent également à la science-fiction) se succéderont sans pour autant rentrer en dissonance avec l’esthétique hyperréaliste qui primait jusqu’alors, rappelant là le cinéma d’Alice Rohrwacher.
Comme les films de la réalisatrice italienne, mais plus radicalement encore, le conte futuriste de Puertas Castillo accorde au lieu un rôle qui va bien au-delà de celui de simple décor. Véritable allégorie de notre rapport schizophrénique au temps, le paysage désertique parsemé de ruines dans lequel gravitent Mari, José, sa fille, sa mère et son ami Jonás, rappelle que le présent n’est jamais pur, hanté qu’il est par le passé et le futur. Le réalisateur instaure en ce sens une dialectique du temps qu’un certain espace contemporain hypermédiatique et hyperconnecté tend parfois à éluder au détriment d’une consolidation de la mémoire collective désireuse de combattre l’oubli. Ce souci de mémoire, d’héritage est notamment représenté par la transmission orale de récits, comme celui de la mystérieuse disparition de l’arrière-grand-père de Jonás, lui aussi berger, qui — on ne l’apprend qu’à la fin du film — portait, comme José, la « marque du feu » au cou (ces plaies attribuées à l’internet) peu de temps avant de disparaître.
Historia de pastores nous présente non seulement les ruines matérielles témoignant du passage des civilisations passées, mais questionne notre rapport aux ruines de l’Histoire, plus conceptuelles celles-là, que nous décidons (ou pas) de prendre en compte pour informer et guider notre façon d’habiter le monde. (Frédérique Lamoureux)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 13 octobre à 13h30 (Cinémathèque québécoise)

prod. Urth Productions / Hopscotch Films / et al.
BOGANCLOCH
Ben Rivers | Royaume-Uni / Allemagne / Islande | 2024 | 86 minutes | Les nouveaux alchimistes
Bogancloch de Ben Rivers est une énigme humaine autour de laquelle se déploie un milieu naturel indompté surchargé d’artéfacts. Au centre de ce portrait clair-obscur se trouve Jake Williams. Chevelure blanche éparse, barbe longue et étincelle dans le regard, le septuagénaire ressemble étrangement à Hubert Reeves. Williams enseigne l’astrologie. Ses méthodes pédagogiques marginales, son allure excentrique et sa roulotte bariolée indiquent un esprit libre. Son imagination est sans bornes. Il récupère tout : un parasol usé devient un mobile pour illustrer la révolution orbitale et les animaux accidentés s'incorporent à ses repas. Ce qui semble improvisé est pourtant profondément pensé. Comme Reeves, sa philosophie de vie est poétique et respectueuse de l’environnement. L’homme entretient seul son vaste domaine où il pratique la permaculture. Ce lieu, qu’il a baptisé « tourbière pierreuse » (bogancloch en gaélique), reflète son propre caractère : insoumis et empreint d’une vitalité indéniable.
Rivers se désintéresse aussi des conventions. Tourné en 16 mm Cinemascope et développé à la main, le résultat du processus artisanal de l’auteur s’accorde avec son sujet atypique. Un support numérique trahirait l'essence de sa proposition délicate qui invite à la rêverie. Bogancloch n’est pas qu’un simple documentaire, mais une œuvre plastique qui déjoue le réel. Ses paysages sont des gravures de J. M. W. Turner, les atmosphères des tableaux d’Hercules Seghers ou encore les natures mortes de Frans Snyders. L’immensité des forêts et des landes écossaises évoque les errances romantiques de Caspar David Friedrich. Le montage est ponctué de photographies argentiques prises en Inde et au Moyen-Orient dans les années 70. Ces clichés détériorés par l’eau de mer découpent le film en chapitres et nous informent sur un passé de navigateur. Leur texture est expérimentale, rappelant Stan Brakhage, qui explore la pellicule à travers des explosions lyriques de lumières et de couleurs, ou Louise Bourque, qui s'intéresse aux images inutilisées et oubliées.
Williams est une énigme. Les nuances mélancoliques qu’on retrouve dans son regard trahissent sa bonhommie. Choisit-il réellement la solitude ou en est-il victime ? Sommes-nous devant un exemple d’autosuffisance ou le triste témoignage d’un accumulateur compulsif ? Tenter d’y répondre ne rendrait pas justice à cet être qui se définit par sa plénitude. La fascination du réalisateur pour l’interprète autodidacte remonte au court métrage This is My Land (2007), et l’amitié qui les unit depuis cette rencontre confère une proximité authentique à ce long métrage présenté en première canadienne. Une projection qui vaut le détour. (Mariane Laporte)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 13 octobre à 20h45 (Cinémathèque québécoise)

prod. a/political
THE VISITOR
Bruce La Bruce | Angleterre | 2024 | 101 minutes | Panorama
Avec The Visitor, Bruce La Bruce démontre à son audience qu’il ne s’était assagi qu’en apparence dans Saint-Narcisse (2020). Son plus récent film, qui raconte la perturbation du modèle familial blanc hétéro et bourgeois par l’arrivée d’un alien (à entendre aussi bien au sens d’étranger, de résident illégal, que d’extra-terrestre venu de l’espace) sur les berges britanniques, renoue de manière exubérante avec sa pratique de la pornographie irrévérencieuse et politiquement chargée. Comme dans Raspberry Reich il y a dix ans, on retrouve notamment les intempestifs slogans qui font irruption sur l’écran (« EAT OUT THE RICH »/« MAKE (REVOLUTIONARY) LOVE NOT (COLONIAL) WAR »/« OPEN BORDERS OPEN LEGS »), colonisant l’image et les esprits comme la publicité — à ceci près qu’ils décalent avec humour et salacité son office traditionnel pour proposer des commentaires sur la marchandisation néolibérale des identités subalternes.
Soyons honnêtes : la structure du film — construit en chapitres consacrés à chacun·e des membres de la famille (la mère, le père, le frère, la sœur, la bonne) que le visiteur va tour à tour corrompre par l’exercice d’une sexualité débridée — rate parfois sa cible, et le principe de redondance stylistique devient alors redite maladroite. Contrairement à ce qui est attendu des acteur·ice·s porno, l’attention et l’imaginaire des spectateur·ice·s ne bande pas sur commande et n’éjacule pas à répétition. On fatigue. Mais cette orgie cinématographique un peu trop longue qu’est The Visitor a l’avantage d’offrir un autre spectacle, cette fois-ci non pas à l’écran mais devant lui ; celui de specateur·ice·s berlinois·e·s peu familier·ère·s avec l’œuvre du Canadien qui quittent la salle, choqué·e·s par la présence de plans rapprochés de pénétrations anales sur la scène d’un grand festival. Ce n’est alors pas seulement l’hypocrisie xénophobe des familles anglaises aisées que permet de percevoir La Bruce, mais aussi celle des publics venus acheter à peu de frais leur capital culturel dans le cadre d’un festival. (Laurence Perron)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024
Prochaine projection : 15 octobre à 20h45 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. Le Bureau Films / Rectangle Productions
Avec Une famille, Christine Angot poursuit avec une fougue cathartique le travail d’exorcisme du viol paternel amorcé avec son livre L’Inceste en 1999, vilipendé à sa sortie par une critique littéraire paternaliste qui voyait en elle une pute et en son éditeur un proxénète, tel qu’en témoigne deux extraits particulièrement odieux du clownesque Tout le monde en parle. Et elle le fait avec toute la fureur revendicatrice d’une victime qui n’a jamais vraiment été vengée, usant d’une violence documentaire qui fait autant de bien que la violence de son récit peut faire mal. Âmes sensibles s’abstenir.
Violée durant de nombreuses années par son père biologique, qu’elle a retrouvé à l’âge de 13 ans, et qui, déjà à l’époque, avouait bander à entendre le son de sa voix, Angot recherche désormais réparation auprès des membres restants de sa famille (sa mère, la femme de son père et son ex-mari, témoin silencieux d’un épisode de viol tardif). Dans une séquence inspirante de bravade furieuse, elle fait irruption dans l’appartement de la belle-mère avec son équipe de tournage et la force à passer aux aveux devant la caméra. L’échange est tendu, et particulièrement révélateur de l’omerta bourgeoise en matière de dénonciation des crimes familiaux. « On ne pouvait plus rien faire », dira-t-elle, « c’est ta version », « je ne veux pas savoir »…
Ce que recherche l’autrice, par contre, à la manière d’un Claude Lanzmann du génocide sexuel des jeunes femmes, c’est de provoquer une larme révélatrice, qu’elle obtiendra finalement chez sa mère et son ex-mari, mais trop tard, alors que sa vie est déjà complètement parasitée par le souvenir du viol. À ce titre, il est déchirant de voir comment ses propres vidéos de famille sont désormais souillées à jamais par les traces des agressions. Les plans où l’objectif, manié par son ex-mari, caresse ses jambes et celles de leur bébé, les zooms qu’il effectue sur l’enfant et les jeux auxquels il se livre avec elle, prennent ainsi une perspective terrifiante. Et si la production possède un aspect inachevé, ce dernier cadre parfaitement avec l’émotion brute qui sous-tend le geste créatif héroïque d’Angot, qui rappelle à trop d’égards le Triste tigre de Neige Sinno (dans l’analyse rétrospective des photos de jeunesse notamment), pour ne pas raviver la flamme du débat entourant l’apologie de la pédophilie en France. (Olivier Thibodeau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024
Prochaine projection: 16 octobre à 20h00 (Cinéma du Musée)

prod. Somatic Films
I’M NOT EVERYTHING I WANT TO BE (JEŠTĚ NEJSEM, KÝM CHCI BÝT)
Klára Tasovská | République tchèque / Slovaquie / Autriche | 2024 | 90 minutes | Panorama Dokumente
Cette biographie photographique de la récemment célèbre Libuše Jarcovjáková, surnommée « Nan Goldin de la Prague soviétique » par le New York Times en 2019, rappelle un peu le All the Beauty and the Bloodshed (2022) de Laura Poitras, en cela qu’il s’articule autour d’un dispositif simple de photos commentées en voix off par l’artiste, qui s’adresse à nous comme à son journal intime. La différence ici, c’est la nature extrêmement dynamique et expressive du montage qui, non seulement donne vie aux images grâce à des processus d’animation séquentielle et de paysages sonores incantatoires, mais permet aussi d’exprimer par diverses manœuvres rythmiques et graphiques les différents états d’esprit de son sujet. Cette tactique s’accorde d’ailleurs parfaitement à la nature du travail photographique de Jarcovjáková, dont les imperfections, les flous et les contrejours permettent de cristalliser ses humeurs de façon impressionniste.
On assiste ainsi à un récit de soi richement étoffé par une quantité de matériau intarissable — le fait que l’artiste ait documenté sa vie avec une telle assiduité semble trouver ici une finalité inattendue, produit d’un travail de recherche héroïque. Mais c’est aussi un inestimable portrait d’époque que constitue le film, qui s’intéresse à quelques événements charnières de l’histoire européenne, incluant l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968 et la chute du Mur de Berlin en 1989. Comme dans le film de Poitras, la perspective adoptée est celle des marginaux, qui se livrent ici à la caméra sans pudeur et sans artifice, dans toute leur beauté excentrique. Il y a d’abord Jarcovjáková et ses amant·e·s, qui s’offrent volontiers à l’objectif, les travailleur·euse·s praguois·es dionysiaques de la période communiste, les Roms « étranger·ère·s dans leur propre pays », les queers flamboyant·e·s du T-Club, les exilées tchécoslovaques et les designers de mode au Japon, puis, dans un moment d’allégresse salutaire, les foules en liesse abattant le Mur de Berlin. La photographe immortalise instinctivement des merveilles éphémères, des bacchanales et des moments fugaces, mais aussi des souvenirs cruciaux de l’histoire mondiale, nous guidant généreusement à travers le parcours simultané d’une artiste et d’un monde qui se cherchent… (Olivier Thibodeau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024
Prochaines projections : Aujourd'hui, le 13 octobre à 16h30 (Cinéplex Quartier Latin)
14 octobre à 20h45 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. 3Cat /A Contracorriente Films / et al.
TARDES DE SOLEDAD [AFTERNOONS OF SOLITUDE]
Albert Serra | Espagne / France / Portugal | 2024 | 123 minutes | Les incontournables
Le grand Albert Serra, invité de marque du festival, nous lance d’entrée de jeu qu’il s’agit ici de son premier et dernier documentaire. Monsieur n’aime pas ce type de cinéma, voyez-vous, puisque les documentaristes n’ont pas le courage de faire ce qu’il y a de plus dur dans le septième art : la direction d’acteurs. On vous laissera ruminer la portée de cette affirmation, tout en vous rassurant du fait qu’il s’est déniché un acteur naturel pour l’occasion en la personne du matador Andrés Roca Rey, charismatique star de l’arène de tauromachie espagnole qui surjoue magistralement à l’écran, sous les applaudissements tonnants d’une foule invisible, toujours en marge du cadre. Roca Rey est un performeur fascinant que la caméra ne cesse presque jamais de filmer, en train de subir un rituel d’habillage incommode dans sa chambre d’hôtel, dans le camion qui l’amène vers et hors les stades où il performe, mais surtout au cœur de l’amphithéâtre, triomphal devant la bête, le faire-valoir méprisable, l’objet sacrificiel à sa gloire. Roca Rey est électrisant, il est magnifique, il est divin ; le film entretient avec lui une rare et impressionnante proximité. Et c’est exactement ça le problème. Serra a beau faire les bons choix de mise en scène, restreignant le récit au cœur de l’action, dans l’univers suffocant de l’arène, maintenant un rythme anxiogène soutenu dans des plans savamment composés au fort potentiel dramatique, faisant de son sujet une figure héroïque, il entretient ainsi la mentalité cartésienne et le christianisme orthodoxe qui nous font croire que la tauromachie est plus que le sacrifice barbare et spéciste dont il s’agit en réalité.
Ce n’est pas dire que les taureaux sont purement objectifiés à l’écran — leur drame aussi est perceptible — mais le but de l’entreprise est de démontrer tout l’art du matador, et sa grandeur transcendantale, évidente dans les assertions supposément « poétiques » des subalternes obséquieux de sa quadrille, qui applaudissent la « vérité » de son geste, mais qui encensent surtout ses vertus viriles, ses « couilles ». Roca Rey est un homme, et en cela il touche au divin ; c’est aussi ce que semble croire Serra, qui lui réserve un lexique d’une piété troublante, évoquant sa photogénie « spirituelle » et ses « moments de grâce » dans l’arène. À la question à savoir si la tauromachie est une façon pour ce fervent catholique d’affronter sa propre bestialité, le réalisateur répond que sa pratique s’apparente en fait à une lutte entre la civilisation et la nature sauvage, révélant une posture philosophique et théologique anachronique qui semblera intenable à bien des observateur·ice·s contemporain·e·s. On comprend dès lors que le processus de mythification du rituel de mise à mort à l’écran est le produit d’une perspective cartésienne issue des Lumières, pour qui l’anthropocentrisme (voire le droit divin de la Genèse) justifie encore obstinément, même cavalièrement, l’holocauste environnemental à la gloire de l’Homme et de son Art. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 18 octobre à 19h00 (Cinéplex Quartier Latin)
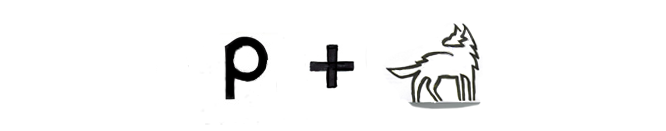
PARTIE 1
(Rumours, The Hyperboreans,
Pepe, The Box Man)
PARTIE 2
(Historias de pastores, Bogancloch,
The Visitor, Une famille,
I'm Not Everything I Want to Be,
Tardes de soledad)
PARTIE 3
(Bluish, Matt and Mara,
A Traveler's Needs, Reas,
By the Stream)
PARTIE 4
(Lázaro de noche,
All the Long Nights, Patient #1,
Favoriten, The Real Superstar)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
