

prod. Buffalo Gal Pictures / Laokoon Filmgroup / et al.
RUMOURS
Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson | Canada / Allemagne | 2024 | 109 minutes | Les incontournables
La prémisse du dernier film de Guy Maddin, co-réalisé avec Evan et Galen Johnson, est particulièrement délicieuse : lors d’une réunion du G7 dans une campagne luxueuse et isolée, les dirigeant·e·s des pays membres sont confronté·e·s à des forces mystérieuses qui les empêchent de rédiger une déclaration conjointe sur une quelconque crise mondiale. Impossible de déterminer de quoi les personnages parlent exactement tant iels semblent vouloir adresser tous les problèmes sociaux dans des termes aussi vagues qu’ampoulés qui ne font que vanter l’importance de leur mission soi-disant humaniste, leur volonté de trouver des solutions, sans jamais rien proposer de concret. La satire est peut-être un peu facile, mais demeure toujours très drôle, en soulignant l’inefficacité totale d’une élite enfermée dans une bulle sans lien avec la réalité, qu’elle maintient par ce langage vide de sens. Quand la peur les étreint, les personnages entonnent en chœur le texte de la première déclaration conjointe du G7, « la meilleure de toutes », comme si la seule chose qui nous protégeait du chaos était ces mots évidemment insignifiants, une logique que le film pousse à son extrême dans sa finale jouissive.
L’affirmation peut sembler étrange, devant un film comportant des zombies masturbatoires, un cerveau géant et une intelligence artificielle visant à déceler les prédateurs sexuels, mais Rumours apparaît toutefois trop sage. C’est que Maddin nous a habitué·e·s à un travail expérimental sur l’image, à une réutilisation enjouée du cinéma muet, et cette fois le surréalisme du récit demeure contenue dans une image assez peu expressive. C’est sans doute l’intention, épouser la pauvreté de l’imagination des personnages par un visuel tout autant lisse que leur langage, les cinéastes restant la plupart du temps dans l’esthétique d’un mélodrame télévisé de fin d’après-midi, accompagnée d’une musique parfaitement sirupeuse. L’effet est plutôt drôle, surtout dans la première partie, se concentrant sur les amours du pauvre Maxime, notre premier ministre du Canada charmant toutes les femmes (interprété comme il se doit par Roy Dupuis), mais cela finit par décevoir quand l’horreur et le délire s’infiltrent. Le pastiche devient monotone, et nous nous ennuyons de la diversité stylistique d’un Forbidden Room (2015), par exemple.
Les réalisateurs se reposent plutôt sur leurs acteur·rice·s, jouant des stéréotypes nationaux et des clichés de fonctionnaires en position de pouvoir. Iels sont tou·te·s superbes, à commencer par Cate Blanchett, dans le rôle de la chancelière d’Allemagne, que nous découvrons dans un registre caricatural plutôt inédit pour elle, et qu’elle maîtrise avec son élégance habituelle. Mais c’est surtout Roy Dupuis qui se démarque, sans doute parce que nos cinéastes winnipegois aiment toujours autant se moquer du patriotisme canadien, en même temps qu’ils s’amusent affectueusement avec l’image de leur acteur (sa force virile, ses tourments intériorisés), d’une manière qui fait plaisir à voir, surtout vu du Québec. Rumours se résume ainsi à une bonne blague, et même si la folie visuelle de Maddin et des Johnson nous manque, on ne saurait trop se plaindre devant une si belle occasion de se réjouir aux dépens de nos dirigeant·e·s. (Sylvain Lavallée)

prod. León & Cociña Films / Globo Rojo Films
THE HYPERBOREANS
Cristóbal León, Joaquín Cociña | Chili | 2024 | 71 minutes | Les nouveaux alchimistes
Avec le chèque empoché pour leur travail sur Beau Is Afraid (2023), León et Cociña, le duo de cinéastes derrière le film d’animation en volume The Wolf House (2018), reviennent avec une suite spirituelle qui, malgré le recours au live action, reprend certains de ses éléments génétiques, offrant au public une version cartoonesque de la mise en abîme fellinienne. Constituant une plongée bordélique dans l’imaginaire de ses créateurs, une exploration critique de l’inconscient chilien et une métaréflexion cinématographique, le film se fait un malin plaisir à tout mélanger, multipliant les alter ego diégétiques et les emboîtements narratifs, sacrifiant la logique dramatique sur l’autel d’un amusant ludisme technique et politique. « Bonjour et bienvenue sur le plateau de Hyperboreans », nous annonce d’entrée de jeu l’actrice et narratrice Antonia Giesen, s’adressant à nous dans une posture de bonimenteuse, auréolée de la lumière des projecteurs. Du cœur du studio où se déroulera l’action, et d’où se déploiera mécaniquement l’univers fantaisiste en papier mâché des Hyperboréens, elle nous raconte l’histoire d’un film volé, dont il s’agirait ici d’une reconstitution de mémoire. On s’embarque dès lors dans une chevauchée fantastique où elle interprète tour à tour une psychologue désireuse d’adapter au cinéma le récit d’un de ses patients métalleux et la policière dudit récit, dépêchée par l’ex-sénateur Jaime Guzmán, proche de Pinochet, pour retrouver le métalleux en question. Les choses finissent par s’emberlificoter encore davantage lorsqu’elle doit se mesurer aux créateurs démiurgiques León et Cociña, incarnés par des marionnettes semi-articulées, qui la forceront à faire l’hagiographie de l’écrivain et diplomate néonazi Miguel Serrano, adepte d’un « Hitlérisme ésotérique ».
C’est avec un égayant didactisme que le film traite de politique, caricaturant les mécanismes de la manipulation étatique et du révisionnisme historique, combattant le spectre de l’oubli (inhérent à l’idée de film volé) en illuminant les recoins sombres du mysticisme fasciste et de l’idéologie chrétienne néolibérale qui ont souillé l’histoire chilienne. Il s’interroge en outre sur le potentiel aliénant et libérateur de l’art, faisant de ses deux réalisateurs les maîtres d’œuvre d’une vaste supercherie visant à réhabiliter l’une des figures de proue de l’intellectualisme néonazi, récipiendaire d’un prix pour l’ensemble de sa carrière remis par l’Université Mayor de Santiago en 2008. Or, il dénude ce faisant les nombreux rouages impliquées dans le processus, effectuant une sorte de déconstruction de l’appareil propagandiste tout en perpétuant les lubies du cinéma d’animation pour l’auto-archéologie de ses procédés de fabrication. Les traces de la production sont partout, dans les éléments de décor que Giesen manipule avec des cordes et des poulies, dans les tours de passe-passe (escamotages et faux travellings) que permet le montage et dans la présence des ficelles qui animent les marionnettes et autres accessoires de carton, évoquant une célébration candide de la thaumaturgie cinématographique à la Méliès. Plus intrinsèquement, on interroge ici la nature même de la réalité, ainsi que la nature du soi, perdu dans le flot constant des avatars, qui renvoient à la fois aux jeux vidéo et au mysticisme hitlérien, dans un monde où la mise en scène euripidienne est tout aussi malmenée que l’espace-temps aristotélicien. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 12 octobre à 18h15 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. Monte & Culebra
PEPE
Nelson Carlos De Los Santos Arias | République Dominicaine, Namibie, Allemagne, France | 2024 | 122 minutes | Competition
À quoi rêvent les hippopotames ? Comment décriraient-ils l’océan (« quelle sorte de rivière n’a pas de rives ? »). Que feraient-il d’un soudain accès de conscience depuis l’au-delà ? Le dispositif de Pepe peut paraître loufoque, mais il mène à une des expériences de cinéma les plus réjouissantes de cette jeune année (d’autant plus positionnée ainsi, dans la compétition officielle de la Berlinale). Prenant comme point de départ l’importation de quatre hippopotames en Colombie par Pablo Escobar (ce qui introduisit l’animal à l’écosystème local suite à la mort du narcotrafiquant en 1993), De Los Santos Arias tire de l’anecdote une captivante fable postcoloniale où l’hippopotame devient symbole de déracinement, de violences où se reconnaitront afro-descendants et Latino-Américains (le film est une production dominicaine). Le narrateur Pepe (descendant des quatre premiers hippopotames arrachés à leurs terres et leurs coutumes), s’interroge sur ce qu’il est, sur la langue qu’il doit parler, sur ce qu’il doit léguer. De l’Afrique de l’Ouest aux rives du fleuve Magdalena, sa voix off nous berce d’un élan expérimental à l’autre, de la tradition du flicker film à celle du documentaire animalier ou de l’animation pour enfant, en passant par d’époustouflants jeux d’échelles (des scènes de drones, ou encore des travellings glissants capturés à même la proue des bateaux de pêche), où se précise un drame conjugal savoureux en filigrane. Pepe est un film immensément généreux et conceptuellement riche, conçu selon une logique à la fois édifiante et spectaculaire. Il s’agit également d’un film sur le langage et la culture : ses plaisirs se déployant au fil d’une narration mystique et mythologique, au fil d’une langue gutturale où se chevauchent l’espagnol, l’afrikaans et le mbukushu (quel polyglotte ce Pepe !), ses pensées judicieusement écrites pour s’éloigner de l’anthropomorphisme et plutôt privilégier un hippopocentrisme, voire un hippopocène — une culture animale qui, elle aussi, doit composer avec ses dictateurs et ses malédictions. Rigoureux, mais ludique — le troisième acte se dévoile tel un hommage à Jaws ! — sous-titré qui plus est « Étude de l’imagination — Partie 1 » en nous promettant une suite, Pepe est un grand coup de cœur, sans doute notre mascotte festivalière. (Ariel Esteban Cayer)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024
Prochaine projection : 15 octobre à 20h45 (Cinéplex Quartier Latin)

prod. Happinet Phantom Studios / cogitoworks
THE BOX MAN (HAKO OTOKO)
Gakuryu Ishii | Japon | 2024 | 120 minutes | Berlinale Special
Caché dans sa boîte de carton, un homme sillonne les rues de Tokyo à l'abri des regards indiscrets. Prenant des photos des passantes et griffonnant dans son carnet ses réflexions tourmentées, il existe en retrait d'un monde par lequel il semble tout autant fasciné que terrifié. C'est là la prémisse de L'homme-boîte, roman de Kōbō Abe paru en 1973 auquel s'attaque ici le cinéaste Gakuryu Ishii. D'emblée, l'idée d'une rencontre entre l'auteur de La femme des dunes et le réalisateur de Crazy Thunder Road (1980) a de quoi exciter. Il fallait en effet un metteur en scène complètement cinglé pour oser faire un film de ce récit réputé inadaptable, et Ishii s'attelle à la tâche avec l'énergie déjantée qu'on lui connaît. Le réalisateur nous prouve ainsi qu'il n'a rien perdu de la radicalité punk de ses débuts. Il plonge tête première, sans faire de compromis, osant à la fois le ridicule consommé et la perversion assumée. Évidemment, son homme-boîte est une métaphore du voyeurisme propre à la position de spectateur. Mais c'est aussi une figure comique hilarante, à la démarche titubante et ridicule, qui gagne une qualité presque burlesque dans son passage de la page à l'écran. Ishii approche Abe sans faire preuve d'un excès de révérence, s'engouffrant dans les angoisses et les obsessions de l'œuvre originale avec une sorte de plaisir maniaque. La sexualité dépravée sur fond de projections cosmiques côtoie les violents combats d'hommes-boîtes sans que ces glissements stylistiques passent pour des ruptures de ton. Chez Ishii, tout ça est du pareil au même. La gravité poétique des monologues de Abe va de pair avec la bouffonnerie criarde et l'érotisme torturé. L'aspect le plus subversif de ce Hako Otoko, par-delà ses méditations sur le désir aliéné et la solitude, est d'ailleurs de prendre un classique de la littérature japonaise au pied de la lettre, d'en exposer l'outrance en refusant de s'arrêter à son statut de « grande œuvre sérieuse ». L'exercice est périlleux et Ishii étire peut-être un peu la sauce. Mais son intransigeance force le respect. (Alexandre Fontaine Rousseau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2024
Prochaine projection : 13 octobre à 15h15 (Cinéplex Quartier Latin
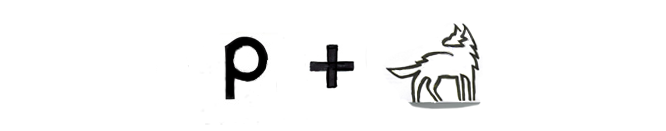
PARTIE 1
(Rumours, The Hyperboreans,
Pepe, The Box Man)
PARTIE 3
(Bluish, Matt and Mara,
A Traveler's Needs, Reas,
By the Stream)
PARTIE 4
(Lázaro de noche,
All the Long Nights, Patient #1,
Favoriten, The Real Superstar)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
