

prod. Snowglobe Films
INHERENT
Nicolai G.H. Johansen | Danemark | 2021 | 16 minutes | Compétition internationale - courts métrages
Un aigle se repait d’une carcasse grande ouverte, une trame sonore muette multiplie les sifflements, le 16mm s’obstine à reposer sur la lumière extérieure, et toute cette mise en scène de l’agression, de l’intrusion, nous mène vers le regard empreint de certitude que nous lance une jeune héroïne, qui observe de loin un garçon qui ferait une bonne proie. La sorcellerie de Nicolai G.H. Johansen tient dans sa mise en scène du macabre, elle-même le fruit d’un travail de suture où le style travaille à relier symboles et habitudes, références aux genres cinématographiques (le film de sorcière ou le film de vampire) et aux faiblesses humaines (dépeintes sur fond de conte initiatique). On découvre ainsi comment la jeune fille ramène à une créature dissimulée dans le grenier des litres et des litres de sang humain pris à des victimes qu’elle attrape en jouant aux autostoppeuses. Sa routine se transforme peu à peu en lassitude, sa vie réprimée entamant une contamination de sa vie ordinaire. La chasseuse voit son existence châtiée, assombrie, se refléter contre les limites de sa vie sociale, extérieure, lumineuse, amoureuse. La superposition des deux vies devient alors périlleuse, et la proximité d’une recherche de tendresse et d’une obligation de violence s’avère insoutenable pour elle.
Si le synopsis fait déjà penser à Let the Right One In (2008), il faut ajouter du même souffle que le film de Johansen est à la hauteur de cette comparaison et qu’il endurerait aussi un rapprochement plus cérébral envers James Wan (ou Tourneur), dont la mise en scène écono-dimensionelle (mise en scène de la schizophrénie fauchée) imprègne les valeurs éthiques et imagières du réalisateur (qui terrorise sans aucune forme de surenchère). L’inhérence du titre propose ainsi un exercice de style probant autour de basculements polarisants interrogeant le réconfort familial, où la violence côtoie de bien près la tendresse et où la détresse intérieure de la protagoniste répond d’une hantise manifeste face à sa condition de proche aidante. Le sang contre son visage lorsqu’elle boit les restes d’une livraison de nourriture n’est essuyé que dans la scène suivante, prise de jour alors qu’elle a le visage propre. Dans cette scène, une balle de tennis qu’elle lance pour s’amuser près d’un étang ne rebondit que plus tard, dans la maison délabrée qu’elle partage avec une créature monstrueuse qui lui sert de figure parentale. En cela, c’est le montage elliptique d’Inherent, encore plus que des directions artistique et photographique diablement efficaces, qui constitue la force organisatrice des peurs et des angoisses distillées par ce petit film de 16 minutes, gracieuseté d’un cinéaste qu’on n’oubliera pas de sitôt. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Itar Productions
MIGUEL'S WAR
Eliane Raheb | Liban/Allemagne/Espagne | 2021 | 129 minutes | Compétition internationale
S’il évoque le cinéma d’Errol Morris du fait de son sujet excentrique et de la multiplication des mises en scène loufoques auquel il se plie (je m’imaginais par moments Fred Leuchter dans son dôme électrifié), Miguel’s War transcende celui-ci grâce à une profondeur psychologique inouïe, constituant une expérience cathartique pour sa vedette titulaire, l’interprète et doubleur barcelonais Miguel Alonso, né Michel Jelelaty à Beyrouth. La cinquantaine avancée, Jelelaty déclare d’entrée de jeu à la réalisatrice être né le 31 octobre 1994. « Menteur », rétorque-t-elle. Or, il n’en est rien. Cette date correspond en fait à son arrivée dans la capitale catalane, lieu de redécouverte où il finit d’enterrer un triste passé fait de souvenirs traumatiques et d’errances décadentes en quête d’un amour dont il a manqué dans son jeune âge, passé que la réalisatrice, roublarde et astucieuse, ramène ici à la surface à l’occasion d’une triple psychanalyse, subjective, nationale et auctoriale.
Relater ici toute la complexité du film d’Eliane Raheb serait impossible. Disons seulement qu’il constitue une expérience thérapeutique extrêmement complète pour son sujet, volubile et flamboyant, mais profondément meurtri, lésé par ces blessures d’enfance qui ne guérissent jamais et qui transforment la vie entière en quête d’amour vaine. La profondeur de la plongée est vertigineuse, l’objectif étant l’extériorisation totale de la psyché de Miguel, obtenue à l’aide de maintes prouesses de mise en scène : superpositions temporelles, utilisation de collages symboliques, reconstitutions historiques à l’aide d’acteurs et multiplication ahurissantes des mises en abîmes, lesquelles supportent de brillante façon la transparence technique et émotionnelle de l’œuvre. Miguel se retrouve, grâce à elle, forcé à gratter tous ses bobos : les problèmes de toujours qu’il entretient avec ses parents décédés, ses souvenirs de guerre traumatiques, mais surtout son désir brûlant d’amour, que dissimule à peine les pulsions nymphomanes qui ont caractérisé sa période madrilène (de la mi-1980 à 1994). Entretenant un rapport de franche camaraderie avec l’autrice, il narre librement diverses anecdotes de sa vie, des histoires lascives, surprenantes et blasphématoires, qui contribuent à la maïeutique précieuse d’un esprit brisé en mille morceaux. Une question fondamentale demeure pourtant quant à ses témoignages, et celle-ci est dûment exploitée par une Raheb magistrale ; elle concerne la véracité des souvenirs narrés, lesquels tiennent parfois du pur fantasme, issu de la convergence des événements stigmatiques qui ont contribué à former l'individu.
L’amnésie sélective du protagoniste permet à son tour d’explorer l’amnésie nationale libanaise, pays marqué par des atrocités de guerre dont il peine encore aujourd’hui à faire sens. C’est le cas du massacre de Sabra et Chatila perpétré par les phalangistes chrétiens en septembre 1982, événement ressassé maintes fois par Miguel, qui se révèle à la fois pieux et hérétique, un chrétien amoureux de Jésus-Christ, de sa virilité, de ses pieds, qui entretient le fantasme masochiste de se retrouver à la place d’une jeune Palestinienne violée et recouverte de sperme. La juxtaposition constante du présent et du passé, qui constitue le mode opératoire de l’autrice, aussi monteuse et productrice, suggère ainsi une forme de simultanéité des époques au sein de l’esprit mutilé des nations et des gens, chez qui les cicatrices d’hier béent toujours aujourd’hui et menacent d’en nécroser le cœur. Sauf le potentiel réparateur des rencontres socratiques. (Olivier Thibodeau)

prod. Exovedate Productions
STE. ANNE
Rhayne Vermette | Canada | 2021 | 80 minutes | Compétition nationale/Les nouveaux alchimistes
Ste. Anne est le sentiment d’un lieu. Du film, on retient l’impression d’une image plutôt que son souvenir. Tout juste aperçue, la vieille porte de bois se dérobe déjà au regard comme cette silhouette que l’on a cru deviner dans le cadran de la fenêtre. Ces petits riens se constituent en une collection de traces visuelles qui construisent un espace de mémoire en faillite : celui du village qui, donnant son titre au film, se transforme en un espace à la fois réel et fantasmé.
Rhayne Vermette invite ainsi à penser un rapport au territoire canadien et à la communauté Métis à travers une œuvre qui tente de traduire les tensions d’un espace non cédé à travers sa photographie. Les poutres des maisons tout comme les corps qui les habitent sont tantôt gardés à distance dans des compositions très froides, tantôt ramenés vers le sensible par des plans plus intimes des individus. Là, une jeune fille regarde une photographie allongée dans un lit, puis des mains ridées caressent l’eau du fleuve ; autant d’images sublimes viennent tisser un réseau de signes sans jamais tomber dans un symbolisme trop explicite.
Un voile mystique recouvre ainsi le travail de Rhayne Vermette et, bien que le film soit moins expérimental que ses œuvres précédentes (constituées de collages faisant intervenir des techniques argentiques d’une grande complexité), il conserve les traces de cette filiation. Le mystère est redoublé par une pellicule parcourue de fuites de lumière et de variations de couleur tremblantes. Ces choix esthétiques renforcent le sentiment étrange qui émane de Ste. Anne, mais une certaine lassitude finit par s’installer, transformant ces fulgurances graphiques en un effet de style quelque peu redondant qui, s’il reste secondaire et n’enlève rien à la beauté des tableaux de la cinéaste winnipegoise, participe néanmoins à alourdir le film. Dans le même ordre d’idée, on en vient parfois à regretter que l’œuvre ne se soit pas pleinement enfoncée dans ses idées les plus expérimentales, ses éléments narratifs étant à la fois trop confus pour capter l’attention et pas assez diffus pour créer un effet volontairement brumeux. Les performances des acteurs, par exemple, oscillent du décalage perturbant au mélodrame un peu ridicule sans que l’on soit certain de l’effet escompté.
Ste. Anne commet quelques erreurs qui incombent en partie à des maladresses de construction et à des choix pas toujours pleinement assumés, mais facilement pardonnables pour un premier long métrage. Cette proposition visuelle parvient surtout à trouver un équilibre parfait entre son propos hautement politique et une esthétique qui n’est jamais reléguée au second plan. Le film constitue donc à la fois une œuvre essentielle de la production expérimentale canadienne de cette année 2021 mais aussi une grande réflexion sur les enjeux identitaires et autochtones qui parvient à apporter des nuances, ô combien stimulantes, à leur propos. (Samy Benammar)
prod. Peter Tscherkassky
TRAIN AGAIN
Peter Tscherkassky | Autriche | 2021 | 20 minutes | Les nouveaux alchimistes – courts métrages
Du pur plaisir. Comme de coutume chez Tscherkassky, ce galant alchimiste qui nous livre comme un cadeau cette première œuvre en six ans, expérience en chambre noire exquise qui s’impose comme une stratigraphie simultanée du cinéma et de la conquête de l’Ouest, mais surtout comme une expérience pure de l’art cinématographique. Étrangement, le film s’est présenté à moi par hasard, mais je crois qu’il s’agit peut-être du destin. Peut-être étais-je dû pour qu’on me rappelle, avec cette éloquence brutale des matérialistes, toute la puissance hypnotique d’un médium adoré, dématérialisé aujourd’hui, mais dont le cinétisme primordial demeure ancré dans une mémoire que l’auteur ravive ici avec fougue. Pour la joie d’une expérience transcendante des images séquentielles, mais aussi pour suggérer que le progrès incessant mène inévitablement au désastre.
Jamais ailleurs qu’ici ne m’était apparu avec autant d’évidence le lien intime qu’entretiennent trains et cinéma. Non seulement le développement ferroviaire coïncide-t-il avec l’apparition du cinématographe (à la fin du 19e siècle), mais le cinéma des premiers temps est tissé d’images de trains, celui de La Ciotat (1896) ou le grand rapide (1903) par exemple. Ces deux entités possèdent surtout, et c’est là que l’auteur s’amuse, des qualités graphiques et motrices similaires. Lorsque le wagon file sur les rails, ses fenêtres s’apparentent aux photogrammes de la pellicule argentique, dont le défilement stimule la persistance rétinienne et ouvre l’esprit à mille incursions en territoires inexplorés. Ce rapprochement résulte ici en moult permutations fascinantes, le véhicule se transformant sans cesse en pellicule et la pellicule en véhicule, acheminant à la vitesse grand V les fantasmes colonialistes d’une Amérique mythifiée, animée par un fantasme délétère de progrès.
Si l’essence du film réside dans un jeu de correspondance savant entre l’un et l’autre de ses sujets constitutifs, locomotives et septième art, celui-ci interroge surtout leur pouvoir transformatif commun, alternant de manière magistrale entre une perspective esthétique et sociologique sur le matériau friable de l’histoire. Tscherkassky aborde en premier lieu la nature thaumaturgique du médium, grâce auquel le cavalier peut se transformer en train par simple juxtaposition graphique. Déconstruisant le phénomène de persistance rétinienne, l’auteur réduit le défilement imagier caractéristique du cinéma à une forme de clignotement stroboscopique où chaque élément individuel apparaît distinctement. Il dévoile ainsi la violence cachée inhérente à la narration cinématographique, qui s’effectue par le biais d’un bombardement sensoriel incessant. Par extension, il évoque aussi la violence cachée qui sous-tend le déroulement de l’histoire, incarnée ici par la conquête de l’Ouest américain immortalisée par les images à l’écran. Ce ne sont donc pas que les mécanismes implacables propres à la projection argentique, mais aussi au progrès industriel et à la recherche incessante de vitesse qui caractérise le 20e siècle que révèle le film, culminant conséquemment avec une iconographie du crash, du déraillement. Train Again est un film très violent en somme, envers le spectateur d’abord, qu’il soumet à un barrage stroboscopique constant, mais c’est aussi un film où le sens jaillit de cette violence-même, apanage d’un art intimement lié à une histoire funeste dont il fait la chronique depuis maintenant 125 ans. (Olivier Thibodeau)
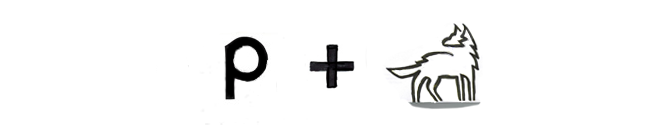
PARTIE 1
(Introduction, Les oiseaux ivres, The Power of the Dog, Sycorax)
PARTIE 2
(Celts, Extraneous Matter, North Shinjuku 2055, Wheel of Fortune and Fantasy)
PARTIE 3
(La contemplation du mystère, Damascus Dreams, Wood and Water, Zeria)
PARTIE 4
(Earwig, Saloum, What Do We See When We Look at the Sky?,
The Worst Person in the World)
PARTIE 5
(Inherent, Miguel's War, Ste. Anne, Train Again)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
