

prod. Petit Film, Anti-Worlds, Frakas Productions
EARWIG
Lucile Hadžihalilović | France/Royaume-Uni | 2021 | 114 minutes | Les incontournables
Nous reconnaissons facilement dans Earwig les lubies de Lucile Hadžihalilović (qui signe son troisième long métrage après Innocence [2004] et Evolution [2015]) : des enfants isolés dans un lieu clos, des expériences étranges menées par des adultes qui cherchent à surveiller, contrôler, et semblent obéir à une sorte de société secrète aux codes énigmatiques. Cette fois, il s’agit d’une jeune fille sans dentition (Romane Hemelaers) vivant avec un homme (Paul Hilton) qui lui fabrique des dentiers éphémères, qu’il doit remouler encore et encore, jusqu’à ce qu’il reçoive un appel de ses maitres, lui disant qu’il doit préparer l’enfant à apprivoiser le monde extérieur. Que tirer de ce récit, trouant son minimalisme austère par de rares éclats d’horreur grotesque, je me le demande encore. Même le titre demeure des plus cryptiques : la créature désignée, un perce-oreille, fait une brève apparition lors d’un plan où il longe un mur, puis c’est tout.
Bien sûr, une œuvre n’a pas besoin de « signifier » quelque chose, ni d’être immédiatement saisissable, mais la proposition paraît ici tellement mince que l’atmosphère s’épuise assez vite. La lenteur du film, sa quasi-absence de dialogues, sa musique souvent discrète, ses images sombres, cette esthétique assez radicale est d’abord envoûtante, mais du moment que nous comprenons qu’il n’y aura rien de plus, qu’aucune question ne trouvera de réponse, le tout devient lourd et prétentieux. Quelques scènes, d’abord intrigantes (un tableau où se perd le regard des personnages, des images psychédéliques semblant surgir d’un verre de vin, le rituel de fabrication des dents), deviennent répétitives à force de rejouer sans aller plus loin. Le surréalisme d’Hadžihalilović demeure ainsi trop timide pour enflammer l’imagination, le récit étant si fier de son hermétisme qu’il ne laisse aucun espace au spectateur (alors que d’ordinaire, l’intérêt de ce genre de fantaisie tient à ce que l’œuvre nous invite à délirer avec elle).
D’autres se laisseront sans doute séduire plus facilement par Earwig, mais pour le présent rédacteur, outre quelques images époustouflantes et la sensibilité singulière de la cinéaste (on a beau la comparer à David Lynch ou à Peter Strickland, les deux points de référence qui s’imposent naturellement ici, son œuvre ne ressemble qu’à elle-même), il reste le souvenir d’un mystère sans substance, plus prompt à susciter l’ennui que la curiosité. (Sylvain Lavallée)

prod. Lacmé, Rumble Fish Productions, Tableland Pictures
SALOUM
Jean Luc Herbulot | 2021 | Sénégal | 80 minutes | Temps Ø
Saloum se présente d’abord comme une version sénégalaise à petit budget du film d’action américain, suivant un trio de mercenaires aussi charismatiques que ridicules : le stratège qui dirige le groupe, le vieux sage et le grand musclé. Leur présentation se fait donc dans un bain de sang, alors qu’ils procèdent à l’extraction d’un caïd de la drogue (colombien évidemment). Malheureusement, et c’est le point de départ de l’intrigue, une fuite de gaz les pousse à atterrir dans le Saloum, où ils se réfugient dans une auberge qui n’est pas sans rappeler From Dusk Till Dawn (1996). Multipliant les références, Jean Luc Huberlot, brouille les pistes et crée un film hybride dont la profondeur naît de la rencontre des genres.
Le film commence ainsi par installer une douce tension entre ses personnages, que l’on sent tous animés par des ambitions cachées, et dont les vices transparaissent dans la fausseté de leurs sourires. Superposant les cauchemars et les conversations entre les protagonistes, le film dévoile progressivement leurs intensions tout en construisant un imaginaire fait de prières et de croyances. Ce mysticisme semble d’abord n’être qu’un élément secondaire, fruit de l’imaginaire des locaux, puis il s'amplifie par de petites touches horrifiques (on pensera aux oreilles mutilées des habitants). Une pression grandissante envahit ainsi l’espace, le danger ne venant pas simplement des personnages mais du lieu lui-même, jusqu’au basculement du thriller vers le fantastique qui se fait de manière aussi surprenante que pertinente.
La diversité de formes, qui renvoie autant à The Expandables (2010) qu’au vaudou, permet de lier les enjeux criminels actuels aux traditions du Sénégal, créant un parallèle entre l’instabilité politique contemporaine et les traumatismes de l’histoire dont le personnage principal a été l’une des victimes. Les crimes commis dans les espaces les plus reculés du pays sont au cœur de l’œuvre, qui traite en définitive de l’impact des colonisations, des décolonisations et des sacrifices imposés aux populations au nom de diverses religions. Les mercenaires finissent donc par devenir l’incarnation d’une pensée révolutionnaire empêtrée dans son désir de vengeance, le patron de l’auberge est l’héritier des anciennes royautés sérères, et le policier peut être perçu comme l’incarnation de l’hypocrisie d’une dictature militaire déguisée en démocratie.
La force de Saloum réside dans sa capacité à développer sans lourdeur et dans une mise en scène explosive et extrêmement divertissante, une réflexion autour d’une impossible rédemption. Ses personnages finissent pris au piège entre leurs querelles internes et les fantômes du passé qui reviennent assiéger l’auberge sous la forme de monstres assoiffées de sang. Les difficultés que rencontrent ces mercenaires, initialement présentés comme des héros invincibles, se constituent finalement en une réflexion sur les problèmes majeurs d’un pays qui subit encore les conséquences de son histoire. À l’image des nombreux plans symboliques qui rythment le récit – l’enfant perdu dans le vaste océan ou les trois protagonistes réunis sous un arbre centenaire - le dénouement du film est à la fois tragique et sublime, lyrique et un peu grossier, mais pas moins lucide. (Samy Benammar)

prod. Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB), New Matter Films, Sakdoc film
WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?
Alexandre Koberidze | 2021 | Géorgie | 150 minutes | Compétition internationale
Dès la séquence d’introduction, Alexandre Koberidze donne le ton de cette comédie romantique réflexive à travers un gros plan : deux paires de pieds entre lesquels tombe un livre suite à la tamponnade de deux corps. On devine ensuite, dans le ton de leurs voix, que les propriétaires de ces corps viennent d'être frappés par un coup de foudre. Très vite par contre, alors que les personnages ont quitté le cadre, la caméra opère un zoom arrière cocasse pour montrer la grille du parc maintenant vide, et afficher le titre du film. La vitesse du mouvement de caméra à la suite de cette rencontre stéréotypée verse dans un romantisme d’une telle mièvrerie, que l’on saisit dès lors la posture à la fois bienveillante et critique du cinéaste vis-à-vis de l’histoire qu’il raconte. Ainsi, alors que ses personnages se donnent rendez-vous le lendemain, une malédiction les transforme dans la nuit si bien que, présents dans le café où ils devaient se retrouver, ils sont incapables de se reconnaître.
Cette pirouette scénaristique, volontairement laissée sans explication, relègue l’amour au second plan et ramène l’attention sur le véritable sujet du film : la petite ville de Koutaïssi en Géorgie, prise dans l’effervescence de la Coupe du monde de soccer. On se délecte ainsi des plans d’exposition montrant les devantures des cafés et les passants qui traversent la ville. La galerie de personnage, bien que réduite, transpire l’humanité et un réalisme sincère s’exprime à travers les plus insignifiants des personnages, comme ces enfants qui viennent s’essayer à l’attraction foraine de la barre tournante. Enfin, une voix off, n’ayant rien à faire là, interrompt régulièrement le récit pour proposer un commentaire tantôt cynique, tantôt humoristique, toujours inattendu et imprévisible. Au milieu du film, le cinéaste s’adresse par exemple au spectateur pour le ramener à la réalité du monde dans lequel s’inscrit l’action : le nôtre, aux prises avec une crise climatique mondiale qui ne sera pas résolue par la naïveté d’une romance.
Puis, il y a les chiens errants qui habitent l’image et la narration. Ils peuvent sembler secondaires — lubie absurde n’ayant rien à faire là — mais ils ancrent l’imaginaire de l’espace dans les petits riens qui en constituent le cœur vivant. Ils révèlent également une fascination du cinéaste qui signale l’aspect le plus jouissif de son film : chacune de ses scènes déborde du plaisir communicatif de filmer. On pensera, par exemple, à la séquence de la malédiction où une succession d’inserts donne la parole à un lampadaire et à une foule d’objets prophétiques ou encore à celle qui conclut la première partie du film : un match de soccer mémorable où la caméra, dramatique, joue avec la maladresse des enfants du village.
Si l'on ferme les yeux sur la normativité du couple amoureux, qui reste assez centrale dans le film malgré la critique qu’on en fait, What Do We See When We Look at the Sky est un festin visuel simple et excitant. Multipliant les voix off et les facilités scénaristiques, Koberidze ne fait pas dans la finesse, mais son travail est bien trop délicieux, drôle et sans cesse stimulant pour que l’on ait le temps de lui formuler le moindre reproche. (Samy Benammar)

prod. Arte France Cinéma, B-Reel Films, MK2 Productions, Oslo Pictures, Snowglobe Films
THE WORST PERSON IN THE WORLD
Joachim Trier | Norvège/France/Suède/Danemark | 2021 | 127 minutes | Les incontournables
Après le thriller fantastique (Thelma, 2017), Joachim Trier s’essaie à la comédie romantique, dans un registre qui rappelle la période Greta Gerwig de Noah Baumbach (Greenberg [2010], Frances Ha [2012], Mistress America [2015]…). Le genre lui convient mieux, sans surprise, lui qui a déjà adapté la philosophie amoureuse de Kierkegaard dans Reprise (2006). Or, s’il est bien capable de faire rire et pleurer, peut-être lui manquait-il une Gerwig à la scénarisation pour paraitre convaincant dans son portrait d’une jeune femme millenial : en effet, je n’ai pas pu chasser l’impression que, derrière la prétention à observer avec un certain détachement amusé (maintenu entre autres par une narratrice anonyme en voix off et un découpage par chapitres titrés), l’auteur adoptait en réalité un point de vue des plus conservateurs, plutôt condescendant envers son sujet et sa protagoniste.
Il est vrai que, quand le film aligne les clichés à propos des millenials (perte d’attention devant les écrans, incapacité à s’engager ou à mener un projet à bout, éparpillement émotif, etc.), il ne semble pas les endosser ; il s’agit, tout simplement, de choses que nous entendons dire. De même pour une discussion sur le sexe oral à l’ère #MeToo, une autre sur le déni de la réalité menstruelle sur la scène publique, les convictions écologistes liées à une quête spirituelle des origines, ainsi qu’une scène se déroulant lors d’une émission de radio où un artiste quarantenaire s’enfonce dans l’incompréhension devant de jeunes féministes lui reprochant son sexisme : tout est là, nous reconnaissons notre contemporanéité, c’est bien ce que nous entendons par une comédie de mœurs. Mais plus le film avance, plus la distance empruntée apparait comme un leurre, tant nous sentons à quel point Trier s’identifie à l’un des personnages masculins, Aksel (Anders Danielsen Lie, un régulier du cinéaste), alors qu’au centre du récit se trouve plutôt Julie (Renate Reinsve), une jeune femme en quête de liberté amoureuse et professionnelle.
Or, cette liberté, elle ne peut la trouver que d’une façon : à travers le regard que lui renvoie Aksel, l’un de ses amants. En soi, nous pourrions dire que c’est en cela que consiste l’amour : se découvrir autre, plus beau, plus belle, à travers le regard de l’être aimé, se dessaisir de soi pour mieux se voir par le biais d’une sensibilité extérieure, ce que la rencontre avec l’autre permet. C’est pourquoi Julie devra entendre Aksel (et par extension Trier) lui dire à quel point elle est extraordinaire pour enfin en arriver à une forme d’épiphanie. Tout cela est bien souligné par le fait que le générique du début emprunte les couleurs par lesquelles Aksel a appris à voir le monde, comme si elles enveloppaient tout le film, et parce que Julie devra, elle aussi, regarder à travers une fenêtre portant ces couleurs. Mais ce qu’elle apprend ainsi, c’est qu’elle n’a pas d’autre choix que de se ranger, de quitter son éparpillement qui, finalement, traduisait une hésitation aveugle plutôt qu’une liberté. Elle pourra donc devenir attentive ; auparavant incapable de se concentrer sur le moment présent (tel qu’en témoigne une séquence où elle arrête le temps pour fuir son amant et vivre une journée parallèle avec un autre), Julie est montrée, en épilogue, comme entièrement dédiée à la vérité d’un instant. En outre, puisqu’elle ne semble avoir aucun.e ami.e, que sa famille est quasi-inexistante, elle apprend aussi que, sans vie amoureuse dans le cadre d’un couple conventionnel, elle n’est rien ; elle finit par être entièrement déterminée par ses relations avec ses amants, alors que, pendant une bonne partie du film, elle cherchait précisément à leur échapper. À ce moment, tous les clichés émis finissent par être adoptés, sous le regard d’un artiste quarantenaire seul capable d’enseigner la vie à ces jeunes perdu.e.s dans un monde bordélique.
Heureusement, il y a Renate Reinsve, réellement extraordinaire dans le rôle de Julie (son prix d’interprétation à Cannes est bien mérité) : elle confère au personnage une densité que le scénario, plus opportuniste qu’observateur, n’arrive pas à cerner. À travers elle, le personnage gagne une liberté capable de défier le projet conservateur du film, et de rappeler que ne pas choisir (un emploi, un.e amoureux.se, une vie bien tracée) peut aussi être un choix. (Sylvain Lavallée)
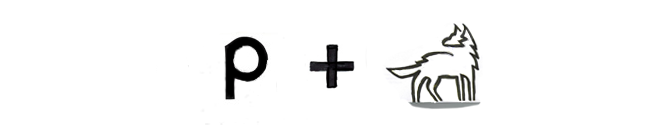
PARTIE 1
(Introduction, Les oiseaux ivres, The Power of the Dog, Sycorax)
PARTIE 2
(Celts, Extraneous Matter, North Shinjuku 2055, Wheel of Fortune and Fantasy)
PARTIE 3
(La contemplation du mystère, Damascus Dreams, Wood and Water, Zeria)
PARTIE 4
(Earwig, Saloum, What Do We See When We Look at the Sky?,
The Worst Person in the World)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
