

:: HyperNormalisation (2016) [BBC]
Voilà déjà quatre décennies que la BBC, le service national de radiodiffusion britannique, patronne le travail d’un journaliste paranoïaque. Payé par les impôts des contribuables, caché dans une voûte d’archives poussiéreuse du diffuseur public, Adam Curtis écrit, monte et réalise des miniséries formées de moyens et longs métrages qui exposent les rouages des idéologies dominantes, des systèmes politiques et économiques faisant tourner la Terre depuis le début du 20e siècle. Son matériau de prédilection est l’archive oubliée — les innombrables rushes inutilisés par son employeur, les vieilles bobines de pellicule, les vidéos diffusées sur le Web par des internautes anonymes — dont il se sert pour sonder les dessous d’une réalité officieuse à laquelle, dit-il, nous n’adhérons plus collectivement. Ce travail est-il celui d’un journaliste, d’un cinéaste, d’un artiste, d’un historien, d’un analyste politique, d’un trublion ou d’un parano ? Un peu tout cela à la fois, mais la démarche qui le sous-tend est beaucoup plus nuancée qu’elle n’y paraît aux premiers abords et justifie… qu’on investigue.
Après l’abandon d’une carrière académique entamée à Oxford où il enseignait les sciences politiques, Adam Curtis fait ses armes dans le milieu de la télé en travaillant comme recherchiste et réalisateur pour des segments humoristiques d’émissions populaires. Quelques années plus tard, lorsqu’on lui concède des mandats plus sérieux et davantage de liberté, il commence à créer des œuvres marquées par l’influence paradoxale des deux milieux l’ayant formé. « The Road to Terror » (Inside Story, saison 9, 1989) et Pandora’s Box (1992), déjà, allient la rigueur critique du chercheur à la pétulance de la sensibilité pop. On y retrouve le germe d’une poétique sans pareil motivée par un positionnement que Curtis défend encore aujourd’hui : le grand public est capable de comprendre les idées complexes de la politique, de l’économie, des sciences sociales — ce sont les grands médias et le journalisme de l’époque qui échouent à en expliquer les tenants, par fainéantise ou par bêtise, et à rendre leur travail accrocheur pour un auditoire contemporain. Dans un monde toujours plus anxiogène où la vérité acquiert peu à peu la consistance d’un mirage, la tâche n’est pas mince et justifie les moyens déployés par Curtis.
D’abord : la narration. Source de bien des critiques et railleries, c’est par la voix posée et les élégantes inflexions proprement britanniques de Curtis qu’elle se déploie au-dessus des images pour discourir sur le capitalisme et l’individualisme occidentaux, la sottise de la rationalité bureaucratique ou les tares de la contre-culture. Les liens causaux déconcertants s’entremêlent aux énoncés emphatiques pour décortiquer des événements marquants du siècle dernier ; on nous parle des puissantes figures charismatiques, d’une vérité insaisissable, d’une vieille élite avare de pouvoir et d’autres sombres individus souvent désignés par un simple pronom indéfini : they. « [Ce film] porte sur la manière dont, au cours des 40 dernières années, les politiciens, les financiers et les techno-utopistes, au lieu d’affronter les véritables complexités du monde, ont battu en retraite. Plutôt, ils ont construit une version simplifiée du monde pour s’accrocher au pouvoir » [1] — ainsi nous présente-t-on le projet de HyperNormalisation (2016) dès la première minute du long métrage qui s’étend sur 2 h 47. Si des expert·e·s sont souvent convoqué·e·s pour appuyer les thèses de Curtis, les sources du journaliste brillent tout aussi régulièrement par leur absence et menacent de faire s’effondrer l’argumentaire, surtout quand le fil de la logique qui les sous-tend s’étire encore et encore (parfois à travers plusieurs épisodes), puis entrecroise d’autres réflexions, des plaisanteries, des fausses pistes… La structure narrative y joue pour beaucoup : plutôt que de s’acharner à interpréter des faits qu’on nous décrit de toute façon comme instables et non fiables, c’est à la vie sensible des humain·e·s ayant modelé le monde d’aujourd’hui que le Britannique s’intéresse. Dans All Watched Over by Machines of Loving Grace (2011), par exemple, une place centrale est accordée à Ayn Rand, romancière de science-fiction et philosophe polémique, pour expliquer les développements du néolibéralisme. À ses idées prônant l’individualisme, à sa vie amoureuse et à son cercle de fidèles sectaires sont carrément rattachées l’édification de la Silicon Valley et la crise financière de 2008. Bill Gates et les grands banquiers peuvent aller se rhabiller.
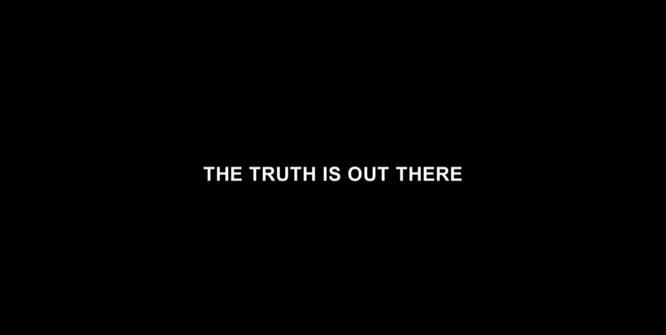
:: HyperNormalisation (2016) [BBC]
Mais ce qui paraît d’abord anecdotique et hétéroclite finit, presque à tout coup, par trouver son sens alors que le récit raccorde enfin l’ensemble des pistes explorées. Les liens causaux ainsi noués sont-ils pertinents, suffisent-ils à tout expliquer ? Qu’importe. Curtis invite les spectateur·rice·s à considérer une vérité alternative qui stimule la pensée et décloisonne les habitudes interprétatives, encourageant le doute à l’égard des grands récits et de toute figure d’autorité, y compris celle du journaliste, du documentariste et de ses propres films. Car au-delà de leur narration à la fois convaincante et grandiloquente se trouve un travail formel qui problématise notre rapport au réel et aux médias, tous médiums confondus.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les extraits d'un mélodrame des années 1950, d'un documentaire animalier, de capsules propagandistes russes, chinoises et américaines, d’un film de famille tourné en 8 mm, de dessins animés côtoient des passages de vieilles entrevues, de discours politiques, d’une publicité d’électroménagers, d’images satellitaires ou infrarouges, de vidéos de surveillance policière et d’émissions pour enfants, de scènes de guerres rugissant au Moyen-Orient et de vidéoclips entrecoupésde photographies candides, de portraits présidentiels, de coupures de journaux, de peintures et captures d’écrans, formant un ensemble phénoménal d’images qui s’enchaînent parfois à une vitesse fulgurante et provoquent le choc par leur violence ou leur combinaison, ébranlent par leur beauté, amusent par leur ridicule, suscitent la surprise. Leur rôle est multiple. D’une part, les images d’archives servent l’enquête en perçant la toile de l’Histoire et dévoilent l’armature qui lui donne forme. À travers le monde, d’immenses lots de rushes captés par les reporters de la BBC au fil des décennies furent excavés des bureaux internationaux du diffuseur public, numérisés, puis transférés à Londres où ils atterrirent entre les mains d’Adam Curtis ; des centaines de milliers d’heures d’enregistrements inutilisées ayant immortalisé l’Afrique coloniale, le quotidien des citoyens de l’URSS, des crises politiques, des guerres civiles, des fêtes nationales. Rassemblés, ces fragments du passé montrent l’Histoire sous des angles inédits. Ainsi ce passage de Bitter Lake, qui condamne l’interventionnisme occidental en Afghanistan : durant une entrevue avec un journaliste anglais, un taliban masqué est interrompu par la sonnerie candide de son téléphone cellulaire et, mal à l’aise, il doit dépêtrer l’appareil du large châle (tabu) l’emmitouflant. Cette séquence coupée au montage des téléjournaux dévoile l’humain caché derrière la façade menaçante et rappelle que le mensonge se fabrique également par omission. Plus tard encore, d’autres reporters ajustent la mise scène d’une entrevue pour accentuer son potentiel larmoyant ; le réalisateur du segment, sans doute, donne des indications au père d’une jeune victime afin de capter sa tendresse et accentuer le pathos de la situation. Transparaît à nouveau l’effort déployé par les institutions occidentales à fabriquer une version des faits protégeant leurs propres intérêts.
D’autre part, et Curtis le soutient depuis longtemps, c’est moins le souci de clarté discursive qui guide sa sélection d’images que leur potentiel affectif, leur capacité à établir une ambiance [2]. Avec ses collages, le Britannique ne se contente pas de réitérer visuellement les thèses développées par la narration comme le font tant de documentaires : ils exploitent à fond les atouts du médium cinématographique. Certaines séquences contredisent la voix off du narrateur, creusant un décalage où s’engouffre l’ironie ; des successions de plans produisent de véritables métaphores filmiques, à la manière des surréalistes ; et la juxtaposition visuelle de deux réalités étrangères suffit à les rapprocher et à rappeler que nous appartenons tous·te·s à la même espèce. Dans leur contexte originel, les images recyclées par le journaliste n’entretiennent peut-être aucun rapport avec le nouveau sujet qu’elles illustrent, mais voilà que sous les manipulations du montage elles se chargent d’une signification nouvelle et modulent à leur tour notre interprétation des images qui la précèdent et la suivent. On sait depuis longtemps la force du montage, aussi son usage abusif est-il condamné en documentaire pour la simple raison qu’il est capable de transfigurer le réel et tromper le public — c’est justement pourquoi Curtis s’en sert aussi allègrement. Les documentaires cherchent généralement à invisibiliser les traces de leur énonciation pour produire une impression de réalisme et d’objectivité afin de mieux convaincre, comme si les images présentées surgissaient d’elles-mêmes, par nécessité. Or, par leur abondance et leur ardeur, les procédés déployés par les films de Curtis attirent l’attention sur leur présence et leurs effets, sur le statut des images qu’ils organisent et réinterprètent, puis qu’ils déforment littéralement, parfois, sous l’effet des ralentis, des rembobinages et de l’altération des couleurs nous invitant à réfléchir aux manipulations subies par les images peuplant notre quotidien. Quelles transformations ces traces du réel ont-elles subies avant d’arriver jusqu’à nous, et dans quel intérêt ? Voilà donc le doute qui s’amplifie, mais le plaisir aussi, car le dynamisme du jeu stylistique de Curtis en met plein les mirettes, puis maintient l’attention du public à qui on inculque en même temps des notions d’économie et de politique autrement complexes et assommantes.

:: Bitter Lake (2015) // Can't Get You Out of My Head (2021) [BBC]
Un plaisir élevé par la trame musicale toujours impeccable, elle aussi composée de morceaux éclectiques qui servent plusieurs fonctions. De l’électro de Kraftwerk au disco de Donna Summers, de la dream pop signée Cocteau Twins au jazz de Louis Armstrong, en passant par le folk de Leonard Cohen, le rap de 2Pac et de Kanye West (Ye ?), le punk rock des Sex Pistols, sans oublier le ska des Specials et les nombreux arrangements orchestraux : les sélections musicales de Curtis sont indiscutablement « cools » et constituent la trace la plus éloquente de cette sensibilité pop évoquée plus tôt. L’adéquation des images et des chansons extradiégétiques confère régulièrement aux séquences des allures de vidéoclips [3], celles-ci s’accordant au rythme de celles-là pour dynamiser l’ensemble en puisant dans un large répertoire connu au moins en partie par chaque membre de l’auditoire. Curtis manie ces deux moyens d’expression cinématographique avec brio, les conjuguant pour développer ses réflexions critiques d’une manière sensible que la narration seule aurait peiné à produire. C’est principalement par la musique et les images que l’ironie du Britannique prolifère pour souligner l’absurdité de situations fort sérieuses. Un montage de politiciens se battant aux poings devient une comédie slapstick sous le rythme d’un ragtime énergique ; et l’ironie devient grinçante lorsque la jovialité d’une chanson pop accompagne des scènes de radicalisme et d’intolérance, comme pour souligner l’insouciance du Mal — Fu Manchu, un policier violent, le KKK, une famille s’adonnant au salut nazi… Mais la blague n’est plus drôle du tout lorsqu’on nous montre des images de massacres au Rwanda, cadavres en décomposition et meurtres inclus, accompagnées d’un Rock n’ Roll énergique (« On the Rebound » de Floyd Cramer). L’espièglerie laisse place à la sévérité : l’intention n’est plus de provoquer le rire, mais le choc, le malaise profond, qui sont des réactions beaucoup plus adéquates que l’accablement face à cette tragédie. Après tout — et Curtis l’avait préalablement exposé avec minutie —, « nous » (les Occidentaux) sommes les responsables du génocide rwandais puisque l’exceptionnalisme blanc, Wall Street et l’impérialisme européen en sont la cause principale.

:: Can't Get You Out of My Head (2021) // All Watched Over by Machines of Loving Grace (2011) [BBC]
La gamme d’émotions provoquées par les choix musicaux de Curtis est donc très large, au grand dam des rabat-joie qui y voient, là encore, une méthode subreptice de manipulation. Il faut admettre que le ressort musical de prédilection du journaliste, qui consiste à introduire les sonorités planantes et répétitives de synthétiseurs pour installer une ambiance de danger diffus, imprègne efficacement notre expérience de visionnage. Lorsque le narrateur nous parle d’une version factice de la réalité, et qu’il accompagne ses propos d’images de banlieues manucurées sur des airs de Nine Inch Nails ou de musique drone, la gravité de son propos paraît décuplée ; idem pour l’emploi tout aussi fréquent des trames sonores de thrillers et de films de science-fiction, en particulier celles de Cliff Martinez, d’Ennio Morricone et de John Carpenter. L’effet se complexifie néanmoins lorsque ces mélodies sont reconnues des cinéphiles, comme quand on remarque que la musique électronique de Prince of Darkness de Carpenter introduit chaque épisode de Power of Nightmare (2004) ; l’association de ce film d’horreur déjanté à une réflexion sérieuse sur la mort des idéologies en Occident et la démonisation de l’Islam fait dévier l’interprétation. Le ludisme du journaliste transparaît à nouveau, déstabilisant, et invite à la méfiance ; comment départager le sérieux de la blague ?

:: Century of the Self (2002) // HyperNormalisation (2016) // Can't Get You Out of My Head (2021) [BBC]
À l’image de la réalité sur laquelle ils enquêtent, les films d’Adam Curtis sont trop complexes et vastes pour qu’on puisse en offrir une vue d’ensemble totalisante — même en enchaînant les énumérations. Ces dernières années, surtout, les codes du documentaire s’y sont rapidement dégradés pour laisser de plus en plus de place à l’expérimentation, les entrevues jadis enregistrées par Curtis ayant été abandonné au profit d’un travail exclusif de l’archive. Le visionnage de Can't Get You Out of My Head: An Emotional History Of The Modern World (2021), qui compte six épisodes totalisant huit heures, désoriente, envoûte et trouble quiconque accepte de se prêter au jeu. Des plans se répètent périodiquement, provoquant une fâcheuse impression de déjà-vu, et tandis que les chansons (plus d’une centaine de titres) s’enfilent à un rythme effréné, les glitchs et les altérations de l’image s’accumulent, hachurant cette œuvre où s’entremêlent quatre trames narratives distinctes (l’histoire de l’Amérique, de l’Angleterre, de la Russie et de la Chine). Encore une fois, des détracteur·trice·s de Curtis se sont insurgé·e·s contre la prétendue préséance de la forme sur le fond, or je pense avoir bien souligné combien son travail du son et de l’image sert à développer son argumentaire tout autant que le font les mots. J’irai jusqu’à avancer qu’un essai traditionnel, imprimé dans un livre, serait incapable de reproduire ainsi cet effet de saturation et d’égarement produit par Can't Get You Out. Par l’entremise de la vitesse et de l’intensité des signaux auxquels elle nous soumet, cette série de films reconstitue le sujet principal qu’il aborde, c’est-à-dire l’expérience contemporaine du réel dans tout ce qu’elle a d’angoissant et de bizarre. Sans surprise, les héros de la post-vérité que sont Donald Trump et Vladimir Poutine y occupent un rôle principal, tout comme les développements de la surveillance de masse, l’ultra-connexion numérique, l’anxiété, le conspirationnisme et la géopolitique internationale.
Si j’ai pris soin jusqu’ici d’éviter au possible de désigner Curtis comme un réalisateur ou un documentariste, c’est bien parce que l’homme en question récuse ces dénominations. Ses œuvres ne sont pas des documentaires, maintient-il en entrevue [4], parce qu’il ne prétend pas à l’objectivité, ni a proposer une solution aux problèmes systémiques et idéologiques qu’il dévoile. Plutôt, son travail est celui d’un journaliste qui admet sa subjectivité et ses propres biais, et dont la responsabilité consiste à prendre le pouls des sociétés contemporaines pour nous éclairer sur ses les enjeux et le mood de notre époque. Sans contredit, notre ère est au soupçon et à la chimère, et les films d’Adam Curtis en sont le reflet confondant.
*
La distribution des films d’Adam Curtis est un phénomène fascinant. En raison du nombre faramineux de sources audio et visuelles rassemblées dans chacune de ses œuvres, leur distribution internationale cause bien des soucis de droits d’auteur. Aucune sortie en salles ou diffusion télé au Canada, donc. Mais la quasi-totalité des films de Curtis se trouve facilement, et gratuitement, ici et là sur Internet… au grand bonheur du principal concerné. Certains épisodes hébergés sur des sites de diffusion bien connus cumulent des millions de visionnements et existent paisiblement depuis plus d’une décennie, laissant deviner qu’aucune vendetta légale n’est entreprise par Curtis et la BBC.
[1] Hans Ulrich Obrist, « In Conversation with Adam Curtis, Part II », e-flux Journal, no. 33 (2012), 2, https://www.e-flux.com/journal/33/68302/in-conversation-with-adam-curtis-part-ii/ ; Sarah Keith, « ‘Half of it is just the fun of finding the right music’: Music and the films of Adam Curtis », Studies in Documentary Film, vol. 7, no. 2 (2013), 164 ; et Jon Ronson, « Jon Ronson in Conversation with Adam Curtis », Vice (2016), https://www.vice.com/en/article/jon-ronson-interviews-adam-curtis-393/.
[2] Ma traduction. En anglais, la narration va comme suit : « [This film] is about how, in the last 40 years, politicians, financiers and technological utopians, rather than face up the real complexities of the world, retreated. Instead, they constructed a simpler version of the world in order to hang on to power. » Hans Ulrich Obrist, op. cit. ; Jon Ronson, op. cit. ; et Sarah Keith, op. cit.
[3] À noter qu'Adam Curtis a amorcé sa carrière en télé au tout début de la décennie MTV. Plus concrètement, son appétence mélomane se remarque par ses collaborations avec des musicien·ne·s, dont la création d'une installation immersive avec Massive Attack (2013) et la réalisation d'un vidéoclip de Weyes Blood (2023).
[4] Chris Darke, « System Analyst », Film Comment, vol. 48, no. 4 (2012), 22 ; Rob Coley, « "Destabilized Perception": Infrastructural Aesthetics in the Films of Adam Curtis », Cultural Politics, vol. 14, no. 3 (2018), 309.
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
