
JOUR 7

prod. Cobalt Pictures / Fire and Ice
BLUE IMAGINE
Urara Matsubayashi | Japon | 2024 | 93 minutes | Section Bright Future
En sortant de l’édifiant et douloureux Blue Imagine, sur les victimes d’abus sexuels dans le milieu du show business japonais, je constate que le prochain morceau sur ma liste de lecture est A Question of Time de Depeche Mode ; visiblement l’univers tient à me rappeler que le problème ne date pas d’hier… Mais ça fait d’autant plus plaisir de voir les femmes continuer à riposter, dans ce cas-ci l’actrice Urara Matsubayashi qui, en passant derrière la caméra, vient raconter une histoire basée sur ses propres expériences. Et ça fait mal dès le début, alors que le témoignage en voix off cruellement familier d’une comédienne agressée par un bonze de l’industrie, couplé à une scène où un réalisateur saoule une jeune première, qui s’effondre dans la rue à hauteur de braguette, fait l’effet d’un uppercut. Et je me mets déjà à pleurer, même si la réalisatrice refuse heureusement de montrer les détails de l’attaque ; je pleurerai d’ailleurs durant tout le film, de douleur d’abord, en écoutant le récit des survivantes et en constatant le mépris des violeurs, pour qui les accusations portées contre eux ne constituent qu’un problème de relations publiques transitoire, puis de joie, devant la puissance cathartique de la solidarité féminine, qui culmine à l’occasion d’une scène de confrontation particulièrement libératrice contre un célèbre agresseur, acculé lors d’une conférence de presse.
Centré autour du récit de Noel, aspirante actrice victime d’une agression aux mains d’un réalisateur réputé, dont elle parvient à guérir grâce à la sollicitude du groupe d’aide titulaire, le film de Matsubayashi se déploie comme un mélodrame très sobre et candide où c’est la prise de parole, mais surtout l’écoute qui importe, au sein d’un processus d’exorcisme qui fait énormément de bien pour tout le monde. Et où c’est finalement l’entraide entre les victimes qui sert de seul remède à leur déprime, mais aussi de seul levier politique et judiciaire dans leur quête de justice, endiguée par un système légal qui demeure encore et toujours la chasse gardée des ordures.
Comme dans tout mélodrame, le pouvoir d’évocation du film tient ici à l’opposition féconde entre la tragédie et l’allégresse, qui s’expriment respectivement dans la normalisation des comportements odieux adoptés par les prédateurs du monde du spectacle et dans la faculté des survivantes d’émerger de l’ombre vers la lumière. « C’est ça le monde du showbiz », s’accordent pour dire une panoplie d’intervenants, comme s’il s’agissait d’une réalité acceptée ; « Vois-le comme un accident de la route », dit le frère avocat de Noel, résigné devant la cause perdue que constituerait un recours judiciaire des mois après les faits. « Pour moi, un grand acteur, c’est quelqu’un qui montre son trou de cul sans hésitation », déclare l’agresseur à un groupe d’aspirant·e·s interprètes qui applaudissent sa perspicacité. Et les choses pourraient bien en rester là — « le silence, c’est le statu quo » dira l’une des survivantes philippines de Blue Imagine — si ce n’était des journalistes consciencieuses qui, face au refus de leurs éditeurs de publier le témoignage des victimes, le postent sur leurs blogues culinaires personnels, si ce n’était de ces victimes qui brisent courageusement le silence, si ce n’était des réalisatrices comme Matsubayashi, à qui je fais ici la révérence que je n’ai pas eu le temps de lui offrir après la projection.

prod. Bjartsýn Films / Tekele Productions
NATATORIUM
Helena Stefánsdottir | Islande / Finlande | 2024 | 105 minutes | Section Bright Future
Voilà finalement le film que j’attendais ! Pile le genre de découverte qui vaut la peine de se pourrir la santé en festival. Natatorium a beau déployer un imaginaire et une prémisse relativement familières, il est dur de s’en formaliser. Ce n’est pas vraiment pour l’originalité que l’on consomme du cinéma d’horreur, mais pour la froideur oppressante de l’atmosphère, la texture cauchemardesque des lieux, la mythologie blasphématoire des récits, l’aura de secrets qui auréole les personnages, l’expression décomplexée de la cruauté familiale, l’enchevêtrement de la beauté et de la mort, bref la puissance viscérale des images, et en cela, Stefánsdottir livre un premier long métrage très impressionnant, dont les éclairages et la direction artistique méticuleusement travaillés nous submergent et nous suffoquent jusqu’à l’extase dans les profondeurs aqueuses de l’univers diégétique. La vérité est un peu dure à cerner, et certains enjeux narratifs demeurent opaques, mais on s’en fout aussi, puisque cette ambiguïté ne sert finalement qu’à épaissir le mystère, de même que le potentiel d’interprétation d’un drame qui est plus symbolique que réaliste, plus évocateur que descriptif, plus sensuel qu’intellectuel.
On est happé·e d’emblée dans le film par des images insondables turbinées par une mise en scène hydraulique faites de fuyants kaléidoscopes et de liquoreux raccords qui détaillent une maison morte baignée de couleurs froides, comme engloutie par le temps, remplie de meubles enrobés de plastique. Le reste de l’introduction est plus convenu : il implique un sombre manoir qui point à l’horizon comme un doigt décharné et une jeune femme charnue, Lilja, qui vient y passer quelque temps, l’instant d’être submergée dans le monde ritualisé de Áróra, une grand-mère austère et inquiétante, à la manière des matriarches du cinéma d’Argento. D’ailleurs, il est dur de ne pas penser au maestro ici, dans le spectacle ostentatoire de couleurs criardes et complémentaires : le rouge sanguin et le bleu des profondeurs, dont la superposition évoque la chaleur des pulsions brûlantes qui dorment sous la surface glacée de la lande islandaise, la laideur qui sommeille derrière la beauté statuesque des personnages.
Le lexique symbolique du film révèle en fait un grand nombre de mariages impies, entre le sang et l’eau (voir la débarbouillette sur les plaies de lit de l’oncle malade et le verre d’eau qui coupe le grand-père), mais aussi entre la piété chrétienne et le paganisme, que l’on combine dans d’étranges scènes de baptêmes funestes et de BDSM incestueux, où la matriarche enchaîne sensuellement son fils sous l’eau, dans ce qui constitue sans doute l’une des séquences clés du film, contractant cruauté et désir d’une manière bizarrement érotique, comme un fétiche triomphant de la dysfonction familiale (ou du complexe d’Électre). Le concept de sorcellerie — et c’est là que la conscience féministe de Stefánsdottir s’oppose au paternalisme tordu d’Argento — se déploie également ici comme une réalité richement ambiguë, qui s’exprime dans le conflit entre Áróra, la matriarche rigide, amatrice d’icônes, et la tante Vala, l’apothicaire alcoolique et ange-garde de Lilja, à qui elle explique les célébrations traditionnelles du vendredi 13, et avec qui elle danse librement. Et même si le symbolisme de l’œuvre peut sembler abstrus, voire confus, il est pour moi foisonnant et contribue à la richesse de l’œuvre, qui supporterait sans doute de multiples visionnages que je me tarde déjà d’entamer.
*
JOUR 8

prod. Our Invisible
THE PARAGON
Michael Duignan | Nouvelle-Zélande | 2023 | 83 minutes | Section Bright Future
Celui-là aussi on risque de le revoir tellement il s’inscrit parfaitement dans le Zeitgeist du cinéma de genre contemporain, s’imposant comme une célébration nostalgique de la science-fiction psychédélique des années 70-80, teinté d’une sorte de réflexivité révérente, avec, bien sûr, une banging bande sonore électro ! Le délicieux humour néo-zélandais, emblématisé par Dutch, l’ex-tennisman feignant et prétentieux de Benedict Wall, ajoute une touche de saveur irrésistible au mélange, qui bénéficie en outre de l’apport de Florence Noble, qui campe un personnage de mentor psychique qui, par son stoïcisme extrême, sert de parfait contrepoids à l’exubérance de son disciple. Parce que c’est aussi un buddy movie, Paragon, et un drame de mœurs, avec une épouse insatisfaite (qui envoie un courriel à Dutch avec une liste à puces de ses doléances) et un frère adoptif opportuniste… C’est de la pure purée postmoderne… et on ne peut qu’en rester pâmé·e ! Surtout avec une pinte de Peroni sur la petite plaquette penchée qui nous sert d’accoudoir…
Le film commence par une expérience de mort transitoire, vécue par le protagoniste principal après avoir subi un délit de fuite perpétré à bord d’une Toyota Corolla argentée, qu’il tentera ensuite de retrouver coûte que coûte, question d’exiger réparation. Tout de suite, la puissance comique des contrastes fait son travail, opposant le potentiel mystique de la prémisse et le prosaïsme prolétaire des décors urbains déliquescents de New Lynn, combinant en outre l’esthétique des vidéos de motivation des années 80s et des capsules TikTok dans un épisode de la série Knife Fight Tennis, où Dutch nous apprend l’art du compliment sarcastique (ex. : « Beau service pour quelqu’un qui a arrêté de mouiller son lit à 15 ans ! »). Infructueux dans ses recherches initiales du véhicule fautif, notre stardu sport des rois décide alors de joindre un programme d’éducation psychique que lui propose la mystérieuse voyante Lyra afin d’apprendre la « télélocalisation », se retrouvant impliqué malgré lui dans une lutte fratricide opposant sa maîtresse à son frère Haxan pour le contrôle de tout l’espace-temps. Cela donne lieu à pas mal toutes les séquences obligatoires, conçues néanmoins avec un flair charmant et une bonne dose d’inspiration : les montages d’entraînement aux arts psychiques et de combats psioniques, l’enseignement de la philosophie New Age, les flashbacks mystiques expliquant l’histoire du légendaire cristal Paragon et les face-à-face avec Haxan et ses troupes d’esclaves décérébrés vêtus de ponchos de pluie. On se désole un peu du concept d’étudiant prodige et d’entraînement accéléré, qui afflige le cinéma de genre contemporain et dénature le concept disciplinaire inhérent aux classiques de kung-fu dont s’inspire Duignan — dans les films de Liu Chia-liang, on s’entraînait pendant dix ans pour atteindre la grâce — mais, en même temps, l’humour est aussi bâti sur cette transgression, et le choc créatif entre la veulerie de Dutch et la gravité de Lyra, dont les frasques sont sûres de faire marrer les gens de culture qui traînent à Fantasia et autres Gérardmer.

prod. Giovanni C. Lorusso

prod. Kenno Filmi
SONG OF ALL ENDS
Giovanni C. Lorusso | France / Italie / Liban | 2024 | 73 minutes | Section Harbour
+
NÉCROSE
François Yazbeck | Liban / Finlande | 2024 | 80 minutes | Section Bright Future
Dur d’ignorer le lien thématique qui unit ces deux films, projetés l’un après l’autre dans la salle #6 du Pathé Schouwburgplein en ce 1er février. Ils abordent le même sujet après tout, soit l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, mais ils le font d’une manière si différente qu’une étude comparative s’impose presque naturellement. En effet, là où Giovanni Lorusso montre des gens déplacés dans le camp de Chatila avec une touche d’espoir précautionneuse, évoquant la résilience d’une famille dont les croyances aident au processus de deuil, François Yazbeck filme les ruines sur une bande sonore industrielle qui ajoute une couche de nihilisme à son pesant récit mythologique. Là où Song of All Ends revêt une facture documentaire, s’apparentant presque à un photoreportage, Nécrose constitue plutôt un film de genre expérimental, quelque part entre la science-fiction low-tech et l’horreur corporelle, le tout sur fond de fin du monde. Retour sur deux solitudes qui traitent de la même solitude.
À voir Song of All Ends, on a souvent l’impression d’assister à un simple trip de photographe tellement les somptueuses images noires et blanches du quotidien de ses sujets évoquent une exposition de type World Press Photo (où l’on découvre les enfants qui pêchent dans les déchets, les couples qui dansent sur la terre battue, les vieux qui se font des œufs dans des poêles en fonte, la résilience, l’attente, l’ennui provoqués par le monde ruineux et transitoire qui les entourent). Mais il y a plus. Il y a la tragédie de l’explosion en tant que telle, que l’on rend à la manière d’un bref hurlement, grâce à un montage rapide d’images saccadées couplées à des voix paniquées. Ça a l’effet d’un ciné-poing qui te rentre direct dans la gueule. Il y a aussi la présence dans l’absence, celle d’une jeune fille décédée qu’on devine à la vue d’une peluche abandonnée que se disputent des chatons, puis qui nous apparaît comme une apparition fantomatique, curieuse, qui arpente langoureusement les lieux jusqu’au chevet de son père pieux, dont la spiritualité trouve alors un sens salutaire.
La foi est envisagée d’une façon beaucoup plus vitriolique dans Nécrose, qui revisite quelques récits du livre de la Genèse (l’histoire d’Adam et Ève notamment, l’épisode de la tour de Babel et de Sodome et Gomorrhe) en y ajoutant des références aux vers d’Abdul al-Hazred, « l’Arabe dément » de H.P. Lovecraft, invoquant ainsi un monde postapocalyptique qui pourrait bien être le produit de la divinité unique des chrétiens ou des dieux impies du mythe de Cthulhu. Couplé aux poèmes cafardeux que récitent les deux narrateurs, où un genre de fétichisme chirurgical accompagne la description dantesque d’un univers déliquescent arpenté par les deux derniers humains, le monde de ruines qui se déploie à l’écran (incluant des images de désert rocailleux, de champs grisâtres, de sites industriels éventrés, d’édifices abandonnés, et du port de Beyrouth dévasté) nous plonge dans un cauchemar éveillé aussi hypnotique que répugnant. Et même si l’exercice s’apparente parfois à une sorte de performance audiovisuelle, il ne s’agit pas moins d’une expérience unique et prenante, élaborée héroïquement avec les moyens du bord, si vibrante de désespoir qu’elle étouffe le peu de lumière qu’on retrouve dans le film de Lorusso, ce qui démontre bien son pouvoir d’évocation infernal.
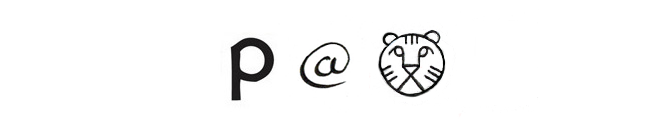
PARTIE 1
(Head South, Rei,
A Man Imagined, La Parra)
PARTIE 2
(Blackbird Blackbird Blackberry, So Unreal,
Confidenza, Slide)
PARTIE 3
(Explanation for Everything, She Fell To Earth
King Baby, It is Lit)
PARTIE 4
(Blue Imagine, Natatorium,
The Parangon, Songs of All Ends, Nécrose)
PARTIE 5
(Maia - Portrait with Hands, A Spoiling Rain,
Krazy House, Los delincuentes)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
