

prod. Parce Que Films
ADAM CHANGE LENTEMENT
Joël Vaudreuil | Québec | 2023 | 94 minutes | Compétition nationale
La satire banlieusarde au cinéma est éminemment protéiforme. Elle peut être camp (Polyester, 1981), élégante (Far from Heaven, 2002), surréaliste (Gummo, 1997), cruelle (Dog Days, 2001) ou monstrueuse (August Underground, 2001), partageant désormais des racines inextricables avec le cinéma d’horreur. Au Québec, beaucoup d’auteur·ice·s différent·e·s s’y sont attelé : Anaïs Barbeau-Lavalette, Robert Morin, Stéphane Lafleur, Myriam Verreault, Philippe Lesage... Or, ce qui distingue le film de Joël Vaudreuil, ce n’est pas sa nostalgie vinaigrée pour les années 1990, son mélange de genres (comédie, drame, horreur, action) ou même le fait qu’il s’agisse d’une œuvre animée. C’est plutôt le pouvoir d’évocation du trait, ou plus précisément du contraste des traits, qui forment, d’un côté, les humains difformes et exsangues du récit, et de l’autre, l’univers géométrique, dépouillé et oppressant qui leur sert d’habitat. On croirait voir évoluer les personnages de Mike Judge chez Chris Ware. C’est ce contraste qui nous frappe d’emblée, et qui incarne le plus organiquement le drame des protagonistes, qui vivent dans un monde carré où ils détonnent constamment, un monde qui ne semble jamais à leur mesure, avec toutes ces canettes de liqueur et ces bouteilles de bière minuscules.
Adam, le protagoniste principal, est l’archétype de l’adolescent rejeté, tourmenté à l’école pour son physique ingrat, que le trait accentue énormément, et forcé de vivre cloîtré dans sa chambre, à rêver aux vedettes d’action de ses films préférés et à la belle Jeanne, la copine d’un de ses bourreaux. On le suivra ici lors des vacances scolaires, alors qu’il doit apprendre « l’autonomie » en s’occupant de la maison d’un de ses camarades riches et de la pelouse d’un vieil homme insupportable, interagissant entre temps avec une magnifique ménagerie de personnages apathiques ou névrosés. Or, le lent changement titulaire réfère à trois choses : sa laborieuse puberté, source de moqueries traumatiques de la part de sa grand-mère acariâtre, qu’on voit mourir dans la première scène juste après avoir déclaré : « J’ai toujours trouvé que t’avais un long tronc. » ; les transformations physiques que son corps subit soudainement au gré des railleries d’autrui, manifestations extérieures d’un mal-être psychique ; et l’idée du conte initiatique, lequel se conclut ici par une catharsis réjouissante, mais prosaïque, loin du fantasme de puissance martiale que laissait miroiter son imaginaire fiévreux.
Basé sur une prémisse plutôt banale, le film regorge de brillantes trouvailles visuelles (le chat sans pattes, les arbres à caca, le petit garçon monstrueux, balafré par un coup de bascule au visage), mais aussi de dialogues savoureux. Ceux-ci s’inscrivent tous dans un humour pince-sans-rire parfaitement ad hoc pour rendre compte de l’absurdité de l’existence banlieusarde, mais aussi pour célébrer cette sorte de nonchalance adolescente qui avait fait les choux gras de Mike Judge (on pense particulièrement aux sbires monosyllabiques et ricanant du méchant Glazer, tout droit tirés de Beavis and Butt-Head). Force est également d’apprécier la puissance psychanalytique du film, qui s’exprime par le recours à de beaux paysages oniriques, à un inventaire tristement hilarant des traumas du protagoniste, aux transformations physiques soudaines que ce dernier subit, mais aussi aux touches d’horreur dont le film est parsemé. À ce titre, il incombe d’ailleurs de souligner le travail musical exceptionnel de Vaudreuil, qui signe une bande sonore fascinante marquée par le bruit des synthétiseurs, lesquels nous transportent alternativement chez John Carpenter et chez John Hugues. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 9 octobre à 16h00 (Cinéma du Parc - Salle 1)

prod. Activ Docs
BETWEEN REVOLUTIONS (ÎNTRE REVOLUTII)
Vlad Petri | Roumanie /Croatie / Qatar / Iran | 2023 | 68 minutes | Forum
Les liens qu’il tisse ne sont pas toujours parfaitement probants, mais Between Revolutions demeure un projet fascinant et précieux, moins une relecture de l’Histoire qu’un survol créatif qui en souligne les improbables corrélations sous l’ombre délétère d’un aigle américain qui, depuis l’après-guerre, obscurcit toute la planète. Usant de matériaux d’archives de source diverses, cimentés par une correspondance épistolaire fictive en voix off, le film décrit de façon riche et astucieuse la période « entre les révolutions », soit de la révolution islamique iranienne de 1979 à la chute du régime de Ceaușescu en 1989. Il crée ainsi des parallèles frappants entre l’histoire iranienne et l’histoire roumaine grâce à un brillant montage eisensteinien et quelques incursions dans le cinéma expérimental, incluant l’utilisation de la pellicule meurtrie, qui renvoie au cinéma de Bill Morrison. Inspirée par des documents retrouvés dans les archives de la police secrète roumaine, les scénaristes Vlad Petri et Lavinia Braniste ont imaginé les personnages de Maria et de Zahra, consœurs à l’Université de Bucarest jusqu’au départ de cette dernière pour son Iran natal, après quoi les deux femmes s’écriront pendant dix ans, jusqu’à la chute de Ceaușescu et la disparition de Zahra, liée sans doute à son implication politique dans le pays de Khomeini.
Le tout débute avec des images argentiques joyeuses de l’insouciante fratrie universitaire de Bucarest vers 1978, au gré d’une chanson nostalgique qui rappelle une période de félicité remplie de promesses. Mais l’espoir ne dure pas très longtemps, le temps de s’émerveiller du mouvement organisé contre le shah Mohammad Reza Pahlavi (dont les politiques, notamment les politiques énergétiques, étaient alignées avec les désirs de Washington) et de la mobilisation monstre qui s’ensuivit — les plans de foule sont particulièrement impressionnants, exsudant toute la puissance de l’histoire en marche. Plane ensuite le spectre d’un gouvernement islamique où les femmes risquent de perdre des plumes. « À bas le conservatisme ! », scandent alors les femmes roumaines ; « À bas les femmes qui ne portent pas la burqa ! », leur répondent les partisans de la doctrine khomeinienne dans un parallèle éloquent qui évoque le surplace de la condition féminine globale face au ressac constant du conservatisme mondial. L’impératif de maternité est aussi abordé de manière frontale dans les vidéos de propagande des deux pays, de même que dans le témoignage des deux femmes, qui discutent ouvertement de la pression patriarcale vers l’enfantement.
Et bien que l’œuvre adopte une posture féministe distincte, il traite plus largement des écueils de la contestation sociale face aux forces inéluctables du dogme religieux et du dogme capitaliste, réunissant ainsi les deux récits d’une façon symétrique qui permet de prolonger subrepticement l’un dans l’autre. « Nos reflets se superposent », écrira d’ailleurs Maria à son amie perdue, et c’est ce que le film fait lui aussi, proposant un portrait unifié de l’échec des luttes antidictatoriales plombées par les alternatives autocratiques latentes qu’elles dissimulent (ici la loi islamique, là la loi du marché qui a dévalorisé la monnaie roumaine et plongé la population dans la pauvreté). Le résultat est un portrait vibrant et immersif de l’histoire en marche, que nous arpentons un peu à la manière de touristes candides, et au bout duquel nous dégageons naïvement un constat fataliste dont ressort une leçon universelle à propos des rites politiques humains, et de la promptitude des peuples à remplacer un monstre par un autre… (Olivier Thibodeau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2023
Prochaine projection : 8 octobre à 13h00 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 11)

prod. Fictive / NEOPA
EVIL DOES NOT EXIST (AKU WA SONZAI SHINAI)
Ryûsuke Hamaguchi | Japon | 2023 | 106 minutes | Les incontournables
Il y a quelque chose de déroutant à propos du dernier Hamaguchi, à commencer par son titre, qui préfigure une sorte d’opposition manichéenne d’inspiration religieuse, inattendue chez l’auteur de Drive My Car (2021), Wheel of Fortune and Fantasy (2021) et Happy Hour (2021). Il y a quelque chose de déroutant à propos de la conclusion pesamment symbolique de l’œuvre, où les deux fils narratifs croisés à la mi-parcours s’effilochent soudainement parmi le treillis des branches défilantes qui ouvrent et closent le récit. On reste également surpris devant la (trop) longue introduction silencieuse du monde diégétique et de ses personnages villageois, dont on scrute les gestes plutôt que d’écouter les paroles. Pas que ce soit inintéressant de voir un rugueux homme à tout faire couper du bois devant sa cabane en hiver, mais on sent que le réalisateur n’est jamais à son plein potentiel dans ce genre de longues scènes d’exposition dramatique. Même l’occasionnel bris du quatrième mur (au moment de zyeuter du wasabi sauvage) ou l’usage de curieuses caméras placées dans l’habitacle des automobiles paraît bizarre. Et c’est sans compter la scène où notre bûcheron marche dans la forêt en entretenant sa fille à propos des différentes espèces d’arbres, à l’occasion d’une séquence où le didactisme du cinéma dramatique traditionnel mine le naturalisme bluffant qui était aujourd’hui devenu la marque de commerce du réalisateur.
On se sent revivre lors de la séquence de consultation publique entourant le projet de glamping qu’une compagnie tokyoïte propose de construire dans la région. Les dialogues sont absolument savoureux, les plaidoyers des villageois sont passionnés, leur logique est irréprochable et le malaise d’un des promoteurs (surprenant Ryuji Kosaka) est palpable. Les discours entourant la fosse septique sont également délicieux, mais ils versent vite dans le pamphlet écologique. Le film revendique alors une position politique si tranchée qu’elle finit par asservir la posture philosophique généralement si subtile de l’auteur, qui découlait naturellement des situations filmées, mais qui s’exprime ici de façon tapageuse, grâce au recours à de grands slogans rassembleurs comme « l’eau coule vers l’aval ». Tout semble ensuite revêtir une fonction allégorique. Même les séquences astucieuses, où l’on effectue des raccords entre les glampeurs qu’on aperçoit sur une vidéo promotionnelle et les protagonistes évoluant sur le chemin des chevreuils, de même que toute l’iconographie hydraulique finissent ainsi par troquer leur beauté prosaïque contre une valeur d’échange sémiotique dans une grande guerre idéologique. En cultivant le mystère autour de son dénouement, Evil Does Not Exist participe en outre à l’impression qu’il recèle une sorte de « message caché », et donc une lourdeur symbolique supplémentaire à décoder. Le film a beau rattraper un peu les choses en humanisant les personnages de promoteurs, qui accaparent le focus durant deux scènes, dont l’une en auto qui rappelle sans doute le plus la griffe auteurielle à laquelle nous sommes habitués, mais cette avenue ne possède pas de véritable finalité, outre que de réempêtrer le film dans les grosses métaphores dont on croyait l’avoir libéré en contrecarrant le manichéisme inhérent à la caricature desdits promoteurs. Malgré la pertinence politique et le caractère opportun du film, il reste désormais à savoir si Hamaguchi est plus utile, ou habile, dans l’art de nous faire apprécier les subtilités philosophiques du quotidien ou dans celui de ressasser élégamment les évidences entourant les effets délétères du système capitaliste. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 13 octobre à 18h15 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 12)

prod. Homeless Bob Production / White Picture / et al.
THE INVISIBLE FIGHT
Rainer Sarnet | Estonie / Lettonie / Grèce / Finlande | 2023 | 115 minutes | Temps Ø
Trois guerriers chinois habillés de cuir noir se lancent à l’assaut d’un édifice militaire soviétique en faisant jouer du Black Sabbath sur leur ghetto blasterrouge vif : aucune arme à feu ne peut résister à ce black metal kung fu, les balles se font arrêter par des lames tournoyantes pendant que l’on danse sur le canon des fusils. La scène d’ouverture de The Invisible Fight est irrésistible, avec ses chorégraphies d’arts martiaux transposées dans le décor improbable de l’URSS des années 1970. Si la blague est d’abord jouissive, malheureusement le cinéaste ne fait que l’étirer sur près de deux heures, bien au-delà du point où elle cesse d’être drôle, tout comme il réutilise sans cesse la même pièce de Sabbath, The Wizard, jusqu’à accomplir l’exploit inconcevable de nous la rendre quasi indigeste.
Il y a bien quelques autres touches surréalistes plutôt délicieuses parsemées ici et là, dans ce récit d’initiation au kung-fu où le personnage principal doit apprendre autant à maîtriser son corps que son esprit pour se montrer fidèle aux enseignements religieux de ses maîtres. Certes, il s’agit ici d’un christianisme orthodoxe plutôt que de philosophie chinoise, mais The Invisible Fight demeure assez près d’un classique comme The 36th Chamber of Shaolin (Liu Chia-lang, 1978), autant dans sa structure narrative épisodique que dans son humour. La déception émerge en partie de cette fidélité, d’abord parce que la réussite de ce pastiche constitue pratiquement le seul enjeu, le film étant dépourvu de progression dramatique comme de quelconques aspects thématiques, critiques, politiques, ensuite parce que cela force une comparaison qui joue nettement en sa défaveur. Rainer Sarnet rend ici hommage à un genre faisant preuve d’une imagination étonnante, s’amusant à cataloguer de manière déjantée tout ce qu’il est possible de détourner par le kung-fu, et à multiplier les comportements, les gestes et les attitudes (humains, animaliers, minéraux, peu importe) que les arts martiaux peuvent imiter, dans ce qui constitue finalement une réinvention émerveillée des possibilités du corps. Le black metal kung fu de chrétiens orthodoxes n’est pas plus absurde que ce que l’on peut déjà voir dans la tradition hongkongaise, mais ici l’idée n’est jamais développée au-delà du pitch, et ne débouche que rarement sur des chorégraphies originales. Il reste ainsi une pâle imitation, certes fidèle et parfois efficace, mais se pavanant d’un décalage (de la Chine vers l’URSS) finalement bien pauvre.
On regrette surtout l’absence de mordant et de critique politique, tant des thèmes comme l’émancipation du peuple et la démocratisation du savoir, prônés dans un film comme 36th Chamber of Shaolin, auraient pu être repris de façon fructueuse dans le contexte du régime soviétique. Mais nous avons plutôt droit à une sorte de parodie de la religion, qui perd peu à peu de son aspect caricatural pour se transformer pratiquement en prêche chrétien sincère, qui aurait emprunté des habits inusités pour mieux nous berner. C’est finalement ce qui étonne le plus, mais aussi ce qui nous laisse le plus perplexe. (Sylvain Lavallée)
Prochaine projection : 9 octobre à 12h45 (Cinéma du Parc - Salle 1)
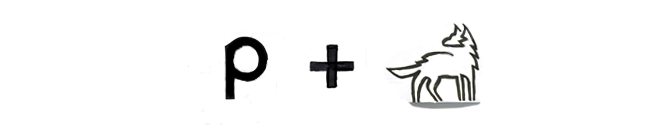
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
