
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Palmarès

prod. Affinity Cine / Pemplum / et al.
IN THE REARVIEW
Maciek Hamela | Pologne / France / Ukraine | 2023 | 85 minutes | Panorama – États du monde
Les festivals de films, surtout quand ils sont bien programmés, sont les lieux par excellence d’une sorte de comparatisme cinématographique qui rend difficile d’en imaginer une couverture critique idéale. Si, par exemple, nous optons pour des textes plus brefs mais consacrés à des films individuels (plutôt que d’offrir des découpes de « sections » ou un compte-rendu général), cela a toujours été pour mettre en valeur la singularité d’œuvres trop souvent réunies dans une structure qui les énumère sans en dégager les qualités propres. Et comme l’état de la distribution fait en sorte que la plupart de ces films ne sont jamais présentés dans le circuit régulier, il faut dire que la très grande majorité de cette cinématographie plus nichée n’a que rarement la considération qu’elle mérite.
Or In the Rearview, du Polonais Maciek Hamela, gagne en comparaison avec un autre film sur des réfugié·e·s présenté dans la même section des RIDM cette année : Far From Michigan de Silva Khnkanosian. Les deux œuvres, très différentes dans leur approche et dans leurs sujets mais pas dans leur urgence, entretiennent pourtant des oppositions fortes et éclairantes. Le film de Hamela notamment, portant sur la route parcourue par les Ukrainien·ne·s en direction de la Pologne, se regarde d’abord comme un road movie humaniste, où la voiture sert de dispositif narratif aussi idéal que rigoureux. Peu ou prou d’esthétisation. Le cinéaste est essentiellement installé dans le siège du copilote et braque sa caméra sur l’habitacle, la banquette arrière avec ses passager·ère·s qui y entrent en fuyant un pays en guerre et qui en sortent espérant retrouver leurs proches, une stabilité, un avenir. Pas de gros plans, aucun aparté possible : la caméra est centrale à la mise en scène, les intervenant·e·s la regardent et se confient. Ielles arrivent de toutes les horreurs imaginables — les bombardements, les maisons abandonnées, les animaux délaissés, les familles séparées, même le racisme des alliés supposés — et trouvent dans l’espace rassurant du véhicule un havre en même temps qu’un microcosme d’expériences diverses, sorte de stagecoach fordien au temps de la guerre moderne. Comme l’annonce le titre du film, on regarde dans le rétroviseur pour voir les réfugié·e·s comme on les entend nous raconter ce qu’ielles laissent de cette vie dont ielles s’éloignent au fil de l’œuvre.
À l’inverse, Far From Michigan montrait ses survivant·e·s arméniens dans une mise en scène sans espaces institués. L’abri souterrain équivalait à la rue comme au balcon et la maison de campagne, affichant en rétrospective toute l’agilité de la survivance et de l’existence vécue dans l’assiègement, avec une caméra subjectivée au point d’être intrusive. Le film dérangeait dans son impudeur esthétisante, indiscrétion doublée d’une opacité contextuelle qui empêchait de rendre un état des lieux géopolitique, ce qui en disait long, finalement, sur toute l’importance de la position qu’occupe la caméra documentaire face à la détresse et sa capacité, à même un contexte, de produire un dispositif (comme la voiture de Rearview) qui fait défaut à ce Michigan pourtant bien intentionné. C’est toute la tension entre la constance de l’enregistrement régulé par le cadre de l’automobile et une captation pulsionnelle, humainement imparfaite, qui apparaît ainsi plus clairement à la vue des deux œuvres, confirmant toute la qualité du film de Hamela et bonifiant, à rebours, l’expérience de celui de Khnkanosian à travers leurs différences les plus sensibles. Créer de la solidarité entre des images de détresse étrangères les unes des autres, aider à les faire se tenir ensemble malgré certains écueils parfois intrinsèques, c’est bien ce que peut accomplir un festival de films bien programmé. (Mathieu Li-Goyette)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 20 novembre à 18h15 (Cinéma du Parc)

prod. Les Productions des films de l'autre
JOURNAL D’UN PÈRE
Claude Demers | Québec | 2023 | 75 minutes | Compétition nationale
Visant à combler de nombreux vides dans son histoire familiale, Claude Demers crée ici un document extrêmement dense, labyrinthique mais fascinant, honnête mais pudique, où il s’adresse simultanément à sa fille, qui habite à Berlin avec sa mère, et à son père adoptif décédé, qu’il pardonne de son mutisme d’autrefois dans un geste à la fois généreux et intéressé, qu’on pourrait interpréter à la fois comme une forme de dédouanage personnel et de résipiscence. Qu’à cela ne tienne, c’est l’humanité palpitante de l’auteur qui constitue ici le cœur du film, et dont la transposition hypersensible et perspicace, presque alchimique à l’écran, au gré d’images oniriques, métaphoriques, incantatoires où une mise en scène n’attend pas l’autre, forcera l’admiration des cinéphiles. La structure éclatée du récit, que justifie la forme du journal narré en voix off, sert ainsi à l’épanchement bordélique d’une subjectivité confuse, mais non moins évocatrice, infectée par l’amour déférent que porte Demers pour le cinéma.
La narration débute sur des images anesthésiantes de fonds sous-marins, lesquelles suggèrent une sorte d’imaginaire amniotique d’où le réalisateur s’adresse à sa fille, directement, comme pour oblitérer la distance qui les sépare. On le voit ensuite assis sur le plancher de sa cuisine, où, à la manière d’un enfant, il prépare une grande affiche pour elle, juste avant de professer sa tristesse de ne pas pouvoir la voir grandir. Or, c’est sur des images d’autres enfants, aperçus dans un parc montréalais, que Demers effectue cette confession, et il s’agit là d’un processus révélateur pour l’auteur, qui cherche ici à créer des images pour conjurer l’absence, manifestant par procuration la nostalgie d’un objet évanescent et s’affairant à garnir un album de photos familiales lacunaire — les clichés qu’il accroche au mur ou qu’il remue sur sa table s’inscrivent donc comme les mailles d’une longue trame généalogique dont il vise à combler tous les chaînons manquants. On note ensuite que les images des enfants dans le parc cèdent soudain à des images d’enfants dans des vidéos d’époque, le film annonçant ainsi la porosité des frontières entre les différentes sources où puise sa diégèse hétéroclite, modelée d’après un esprit enfiévré chez qui la fiction empiète sans cesse sur la réalité.
Il existe plusieurs niveaux de mise en scène au sein du film (illustration allégorique des pensées de l’auteur, reconstitution d’époque visant à restituer la figure paternelle et insertion subreptice d’extraits de films), lesquels se mélangent constamment pour mieux cerner la subjectivité auteurielle et font de ce Journal d’un père une véritable vue de l’esprit. L’utilisation du noir et blanc accentuant la confusion entre les images d’hier et les images d’aujourd’hui, Demers pige pêle-mêle dans son propre imaginaire et dans l’imaginaire collectif, générant des souvenirs pour l’avenir de sa famille tout en opérant une maïeutique cinéphile fascinante. Empruntant des scènes de félicité pastorale au cinéma de la première modernité, il projette ses désirs d’utopie familiale ; en montrant la jeune protagoniste d’Alice in the Cities (1974) de Wenders, il crée un pont onirique avec sa fille, comme il crée un pont avec son père adoptif via La Source (1960) de Bergman, et avec son père biologique grâce à des extraits de films italiens (ce parallèle n’étant d’ailleurs pas sans rappeler la quête imaginaire du protagoniste de Léolo [Lauzon, 1992]). Demers parle de lui, de ses proches, de Primo Levi, de son écoanxiété, de la peinture rupestre et de Joseph, le père absent de Jésus, au gré d’une narration où c’est finalement la franchise et la sagacité du narrateur qui servent de ciment. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 20 novembre à 20h15 (Cinéma du Parc)
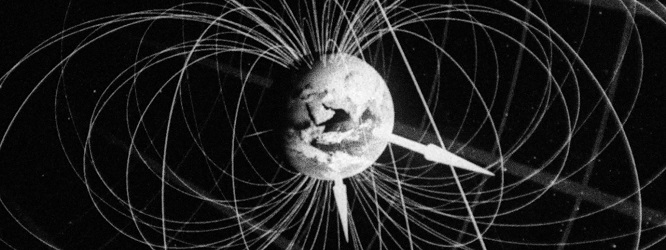
prod. Terratreme Filmes
LAST THINGS
Deborah Stratman | France / États-Unis / Portugal | 2023 | 50 minutes | Forum Expanded
Last Things se déroule au début du temps pour s’étirer jusqu’à sa fin ; de la formation du système solaire et de ses blocs inchangés qu’on retrouve sous la forme de chondrites, ces roches météoriques qui ont erré et qui, lorsqu’on les compare aux matières pierreuses de la Terre, demeurent des prismes intacts, le mètre-étalon du cosmos. En nous plongeant les yeux dans la matière la plus résistante, en nous pointant ces formes de microcosmes insoupçonnés, tirées d’images scientifiques glanées dans les archives de centres de recherche géologiques et astrologiques, adjointes ensuite à des images de paysages en 16 mm que Stratman a elle-même captées, Last Things ressemble à une méditation encyclopédique comme Alain Resnais se plaisait à en faire sur le plastique ou les bibliothèques : un catalogue d’images surprenantes que la voix-off poétise jusqu’à leur faire atteindre le sublime.
Sublimes cailloux, ils le sont dès que la narration nous fait comprendre qu’aucun d’eux ne peut se « rappeler » des origines de la Terre. Qu’à côté des chondrites cosmiques, toutes nos roches ont été labourées par le temps, ses cataclysmes, ses métamorphoses induites qui ont fait d’elles pléthores d’orgues minuscules dans lesquelles les intempéries ont creusé, foré et desquels la vie est sortie par oxydation. D’abord influencés par la rencontre géologique accidentelle, dans leurs formes, leurs allures, leurs cavités, ces creux humides d’où le vivant a retenu ses racines fait du sol une multitude de genèses à découvrir, naissances de vie mais aussi de formes drôlement géométriques que Stratman rend avec la fascination de la rencontre du troisième type. Ainsi Last Things, par son montage ambitieux et son texte capable de télescoper le futur lointain jusqu’au passé immémorial — le présent n’y est qu’une parenthèse, une anecdote dans laquelle notre espèce se glisse furtivement par des images d’entomologie — fait vivre les minuscules trous de roche en en faisant l’origine de toutes choses en même temps que le dernier témoin de ce qui aura été.
Évidemment, l’odyssée post-anthropocène de Stratman montre bien que la cinéaste expérimentale est consciente de l’aspect presque ésotérique que peuvent revêtir les objets inanimés qu’elle décortique. La stylisation du film verse dans une sorte de mysticisme cristallin, avec des séquences hallucinées où la réfraction du soleil qui parcourt la pierre rappelle que cette lumière multicolore, aveuglante, est elle-même canalisée par un rhizome de matières immémoriales qui fait dévier les rayons en son for intérieur, à l’instar de la pellicule du film qui elle aussi enregistre la lumière en se faisant traverser par elle et qu’en cela, le celluloïd et le cristal partagent plus de vertus qu’il n’y paraît (ou encore qu’il faut prendre l’image-cristal que Deleuze conceptualisait au pied de la lettre, avec cette idée d’une indiscernabilité du réel et du virtuel qu’on retrouverait ici face à ces images « impossibles », à tout le moins déréalisées, de l’infiniment petit qui ne colle dans l’infiniment grand qu’à travers une symétrie aux disproportions monstrueuses). D’un rebond lumineux à l’autre, Last Things se déploie et marque en bout de ligne par les dynamiques rétroactives qu’il met en scène dans son vertige, par le « je te creuse » que dit le temps éphémère face au roc immanent, montrant comment l’un et l’autre interagissent jusqu’à produire de la vie et, surtout, jusqu’à se laisser marquer par elle. (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2023
Prochaine projection: ANNULÉE

prod. Primeira Idade
NOCTURNE FOR A FOREST
Catarina Vasconcelos | Portugal | 2023 | 16 minutes | Compétition internationale
Couvrez ce sein que ne sauraient voir les Portugaises du 17e siècle, exclues de son lieu d’exposition claustral par un édit papal qui préférait en réserver l’usage (érotisant) aux moines carmélites du Buçaco ! C’est avec une belle causticité féministe que Catarina Vasconcelos (Metamorphosis of Birds, 2020) raconte l’histoire de la toile de Josefa de Óbidos représentant la Sainte Famille, où apparait la poitrine nue de la Vierge. Jalousement gardée par les frères du Convento de Santa Cruz, à l’instar de la beauté « invisible et ineffable » des arbres de leur jardin, cette peinture emblématise ici les limites imposées par le patriarcat au regard féminin, que l’autrice finit par libérer à l’occasion d’un procès intenté contre l’Église catholique par une congrégation de femmes immortelles.
Le film débute dans une nature morte en clair-obscur où le souverain pontife Grégoire XV nous apparaît dans ses luxueux quartiers. Soucieux d’assurer son héritage face à sa mort imminente, il remplit un crâne de fleurs tranchées, puis imagine l’idée d’envoyer une plaque commémorative au monastère de Buçaco, interdisant son accès aux femmes. Or, il y a quelque chose de dreyerien dans la représentation de cet ecclésiaste suffisant, dont le gros doigt pénètre violemment les pages rouges d’une bible, et dont les souhaits les plus mesquins ont pouvoir de loi. Cette représentation caricaturale assure d’ailleurs le caractère jouissif du retournement de situation qui marque la deuxième partie du film, où ce sont les âmes de femmes décédées, réincarnées ironiquement dans le feuillage des arbres dont la contemplation leur était prohibée de leur vivant, qui reprennent en esprit une forme de suprématie législative. Émergeant du noir de l’obscurantisme, les feuilles irisées se mettent alors à parler, revendiquant un accès équitable à l’art, à l’esthétique, mais aussi à la vie éternelle. (Olivier Thibodeau)

prod. Kimikat Productions
ONLOOKERS
Kimi Takesue | États-Unis / Laos | 2023 | 72 minutes | Panorama – Horizons
J’aimerais dire qu’il y a quelque chose du photographe ironiste Martin Parr dans le film de Takesue, mais pas tout à fait. Car si les touristes constituent bel et bien l’un des sujets de prédilection du Britannique, ils sont aussi l’objet principal de sa mise en scène ; ils nous sont présentés dans une sorte d’autarcie, où le cynisme naît justement d’une forme d’autosuffisance colonialiste, tandis qu’ils ne sont ici que des intrus dans un cadre plus large. En effet, l’objet de la mise en scène de Takesue n’est jamais vraiment « les touristes », mais plutôt la beauté pittoresque du Laos, dont les paysages sont tournés exclusivement dans des plans larges statiques que viennent compromettre ou consommer ces badauds, de sorte que le film lui-même s’avère touristique, voire exotisant — c’est là d’ailleurs qu’il finira par trouver un sens, mais nous y reviendrons. Onlookers est un film d’observation anecdotique, sans véritable vision d’ensemble, où chaque plan nous apparaît comme une vignette indépendante. Mais que vise-t-il donc à cerner ? Le caractère sacrilège de la visite des pagodes ? Le colonialisme par essaimage ? La nature polluante de l’industrie touristique ? Le sacrifice de la beauté et la quiétude des lieux ? La quête d’esthétique dans l’ailleurs ? Toutes ces réponses s’appliquent en vrac, de sorte qu’on a parfois l’impression de devoir réfléchir à la place de la réalisatrice.
Là où le film semble trouver un sens, c’est dans la tension entre l’acte diégétique et extradiégétique de regarder. En effet, s’il est vrai que nous, en tant que spectateur·ice·s, observons des gens curieux, nous nous intéressons avant tout au paysage. Le fait d’imaginer la présence d’autres touristes dans le cadre comme une intrusion, comme un obstacle à notre propre contemplation de l’espace fait alors de nous les badauds du titre. La même notion s’applique aux images des populations locales, que nous scrutons de façon fouineuse. Il se dégage ainsi du visionnage une série de questions quant à la nature du cinéma d’observation ethnographique. Car si le rapport des touristes au paysage est explicitement exotisant, le nôtre ne l’est pas moins, même si nous bénéficions d’une posture dérobée qu’on pourrait qualifier de distance intellectuelle. « Quelle est ma place dans l’économie du film ? » serait donc peut-être une question plus pertinente que d’interroger la place des touristes dans une économie nationale où ils constituent pour certain·e·s une denrée indispensable. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 20 novembre à 21h15 (Cinémathèque québécoise)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
