

Eyes and Ears (2022) [Tahuaroa Ohia]
COURTS MÉTRAGES MAORIS (PROGRAMME #2)
La sélection de ce deuxième programme proposé par Leo Koziol, directeur du Festival Wairoa Maori, est tellement cohérente qu’il est dur de ne pas la considérer dans son ensemble, surtout qu’elle m’a permis de découvrir le travail exceptionnel de Mâoriland, l’organisme responsable de la production des cinq premiers titres.
Le bal débute avec Eyes and Ears (He karu he taringa, Tahuaroa Ohia, 2022), qui comme A Morning With Aroha (2021) de Nicholas Riini (présenté dans le programme de courts métrages de fiction), vise à extérioriser l’intériorité d’un enfant autiste. Tourné entièrement en caméra subjective, avec des clignements d’yeux à titre de fondus, le film évoque une perspective curieuse, mais secrète sur le monde, empreinte d’une magie inaccessible aux adultes intransigeants alentour. L’utilisation de crayonnages enfantins superposés à l’image illustre d’ailleurs très bien ce point de vue singulier qu’Ohia capture si tendrement, montré en porte-à-faux de celui des grandes personnes hystériques qui viennent agressivement ausculter le jeune garçon à la manière d’une huître fermée…
Dans le magnifique et déchirant Voyager’s Legacy (2022) de Bailey Poching, le regard rêveur et la posture de conteur adoptées par les trois jeunes protagonistes permettent de substituer un monde doux, fantastique et lumineux, recouvert d’un beau grain pastel, au drame familial socioréaliste qui se déroule autour d’eux, alors que les personnages se transforment soudainement en rois et en chevaliers au gré de leur narration. C’est aussi une façon de mythologiser leur famille aimante, que Poching cadre dans des vignettes domestiques charmantes, face à la dureté d’un monde où les autochtones d’Aotearoa sont encore assimilés à des singes, chez qui la police entre comme dans un moulin. C’est finalement l’occasion d’inverser les rôles, et d’imaginer les parents en train de tabasser les constables à l’instar des cochons de cartoons, plutôt que de les voir subir la torture entre leurs mains. « We want to tell you that the hero beat the monster », concluent les enfants, résignés devant la réalité des faits, « that’s the story we want to tell you ».
On quitte ensuite le fantastique pour un cinéma purement réaliste, à mi-chemin entre le film de braquage et le drame familial, nourri par la performance touchante d’un autre jeune acteur, via The Retrieval (2022) d’Aree Kapa, production soignée où l’on pose la question à savoir si l’on peut voler ce qui nous a été volé (littéralement). Mettant en scène un père de famille qui dérobe le pendentif en pounamou de ses parents dans un musée, l’œuvre montre elle aussi une police intrusive qui, à la fin, vole de nouveau les parents à leurs enfants… Or, le Ruarangi (2022) d’Oriwa Hakaraia poursuit en quelque sorte là où The Retrieval avait commencé, c’est-à-dire avec le vol d’un autre pendentif en pounamou effectué par les forces colonialistes à la fin du 19e siècle. Démarrant au cœur de la forêt, avec une excitante course-poursuite aux relents gibsoniens, le film développe subséquemment une sorte de subjectivité de la captivité, cadrant avec une attention méticuleuse l’expérience d’un prisonnier maori dans un galion britannique, au gré d’un clair-obscur carcéral soigné doublé d’une habile esthétique du tangage.
On renoue par la suite avec le regard enfantin dès les premiers plans de Street Lights (Te Mahara Tamehana, 2022), où l’on « assiste » à un virulent conflit parental se déroulant en hors-champ, sous les yeux d’un enfant impuissant. Flashforward dix ans plus tard, alors que cet enfant est devenu un jeune adulte hésitant, paralysé par le spectre d’une violence paternelle qui perdure, au sein d’un drame typiquement urbain, intimiste et expressivement monté, ponctué par une savoureuse bande sonore rap. Un drame se déroulant dans un monde saturé d’échappatoires, narcotique, éthylique et amoureux, rendu dans un style onirique où les reflets lumineux forment de doux halos autour des visages, et où persiste l’espoir salutaire d’une réconciliation intergénérationnelle.
Finalement, le drame d’animation homoérotique Aikâne (Daniel Sousa, Dean Hamer et Joe Wilson, 2023) nous ramène au thème de la captivité à l’époque coloniale, alors que nous assistons à la capture d’un bel homme-pieuvre par les rustres ténébreux à la barre d’un autre galion. Or, le style fluide et sexy préconisé par les auteurs dans leur exploration des lumineux fonds marins, où les protagonistes bénéficient d’une exquise liberté de mouvement, contraste alors avec la noirceur carcérale de la cale du bateau, qui ne deviendra un espace affranchi qu’après avoir été déboulonné et ébréché par les tentacules de la créature, emblématique d’un désir d’émancipation que M. Koziol nous permet ici de savourer gaiment. (Olivier Thibodeau)

prod. Formidable Entities / Nevo Shinaar Production / The Redford Center
DEMON MINERAL
Hadley Austin | États-Unis | 2023 | 95 minutes
Dès son premier plan, composé d’un arbre à l’arborescence sphérique, aux feuilles surlignées par la surexposition d’un noir et blanc hautement contrasté et saturé, Demon Mineral affiche son ambiance délétère, sa capacité à sculpter dans la terre aride du désert des Navajos cette ombre radioactive qui plane sur le territoire. L’arbre en question, on dirait un champignon nucléaire, rappel insidieux que cette terre est hantée par l’extraction de minerais mortels, impossibles à nettoyer, impossibles à ignorer tellement leur impact sur l’environnement est grand, sinon que c’est justement d’ignorance et d’oubli dont traite le beau film de Hadley Austin. Face aux communautés navajos unies pour plaider devant le Congrès, on retrouve des capitalistes et des avocats experts en exploitation indue, filmés à dire aux militant∙e∙s que si l’uranium est un métal dont la toxicité radioactive se dissout si facilement dans l’eau, ce n’est qu’une raison de plus pour en continuer et même en accroître l’extraction… Au diable les risques du fracking sauvage et des détonations qui font perdre l’ouïe, l’uranium est trop important pour l’indomptable complexe militaro-industriel.
L’empoisonnement des sols, qui plus est par la radioactivité, représente un enjeu de politique du visible autour duquel Demon Mineral s’articule adroitement. Comment rendre intelligible, présent, voire terrifiant, ce que la science s’évertue à dire et ce que les témoignages des Navajos répètent depuis des générations, à regarder leurs terres et leurs bêtes devenir malades, impropres à la cultivation et à la consommation ? La réponse se trouve ici en partie dans le travail photographique mémorable de Yoni Goldstein, qui alterne entre les scènes d’intérieur avec des couleurs blanchies, donnant à la lumière qui pénètre une texture de transparence empoussiérée, porteuse de particules que les images en noir et blanc des extérieurs nous rappellent être une pollinisation irradiée, omniprésente, qui s’infiltre et se dépose au gré de la moindre brise.
En cela Demon Mineral fait bien de travailler son discours par une esthétique quasi apocalyptique, livrant des images impitoyables d’où seule la culture navajo finit par émerger comme une sorte d’oasis de solidarité à toute épreuve. D’une génération à l’autre, des aîné∙e∙s aux plus jeunes universitaires s’équipant intellectuellement pour affronter l’institution politique étasunienne, l’impression de désespoir est aussi forte que la structure du film d’Austin est implacable, cumulant les méfaits, les solutions et les témoignages dans une sorte d’inéluctabilité rendant l’issue aussi prévisible qu’outrageante. À l’heure où le cinéma américain célèbre la soi-disant intelligence d’Oppenheimer, le petit film d’Austin, financé par la fondation écologiste de Robert Redford, est à célébrer tellement il montre bien la complexité de ce combat souterrain contre l’empoisonnement global. D’un côté la production indépendante, travaillant l’impossibilité de montrer ce qui est depuis longtemps décrié ; de l’autre côté la superproduction jouant le jeu de la reproduction bureaucratique, gardant dans le hors champ la souffrance humaine et l’écroulement environnemental ; et entre les deux, le même démon radioactif, la même industrie qui provoque cet écroulement, la même humanité souffrante. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Cinco Cine / Conbrio
KAWA (NIGHTS IN THE GARDEN OF SPAIN)
Katie Wolfe | Aotearoa (Nouvelle-Zélande) | 2010 | 76 minutes
Lorsqu'il fut diffusé pour la première fois sur les ondes de la plus importante chaîne de télévision néo-zélandaise, à heure de grande écoute, le téléfilm Kawa happa le public par la représentation cosmopolite du tangata whenua (peuple de la terre) qu'il proposait. D'un côté, les Pākehā (les Blanc·he·s d'ascendance européenne) retrouvaient dans la famille maorie au centre du récit le reflet de leur propre idéal petit-bourgeois, auquel ils et elles pouvaient s'identifier — la famille nucléaire possédant une maison de ville cossue, un prestigieux emploi de bureau, une voiture de luxe... Les Maoris pouvaient quant à elleux se reconnaître dans ces images affranchies de tout exotisme, qui entérinaient leur contribution et leur intégration à la société néo-zélandaise contemporaine, mais qui soulignaient aussi la difficulté de composer avec des traditions en crise. Comment préserver l'héritage d'une culture qui, aussi belle et riche soit-elle, repose sur une délimitation rigide des rôles genrés alors que le progrès social appelle à la dissolution du patriarcat et des normes hétéronormatives ? C'est la question soulevée par le déchirant dilemme de Kawariki, le père, désormais incapable de refouler son homosexualité.
Kawariki sait qu'il aime les hommes depuis l'enfance, mais il a cédé à la pression sociale et s'est marié à une femme avec qui il a eu deux enfants qu'il adore de tout son être. L'amour platonique qu'il éprouve à l'égard de son épouse ne suffit toutefois plus — il dit avoir « perdu le combat », ce qu'illustrent ses visites récurrentes au sauna gai et sa carte de membre bien usée. Le contraste entre le foyer familial et les lieux de sa double vie sont marquants : ceux-ci sont clairs et baignés de tons chaleureux ; ceux-là sont sombres, enfumés, épais, à peine percés d'une lumière bleutée ou mauve, évoquant tantôt la concupiscence, tantôt la froide solitude à laquelle les pulsions et les choix de Kawariki le condamnent. Car assumer son homosexualité, c'est perdre ceux qui lui sont les plus chers au monde, c'est troquer son mode de vie « normal » pour celui du bachelor solitaire, croit-il ; aussi mène-t-il sa véritable existence à l'ombre de la nuit, en cachette, déchiré. La pression devient insoutenable pour le malheureux lorsque son propre père prend sa retraite et lui passe le flambeau, faisant de lui le chef de leur whānau (famille élargie), un rôle honorable et porteur de grandes responsabilités ; le vernis du mensonge qu'on l'exhorte d'entretenir finit par craquer et la vérité éclate au grand jour, avec violence. Indignation, dégoût et ressentiment s'entremêlent chez les différents membres du whānau alors que leur unité se voit ébranlée, mais le dénouement, heureux, témoigne de l'importance accordée par la culture maorie à l'amour familial.
Mis au service des dialogues et du scénario adaptés d'un roman de Witi Ihimaera, la forme de Kawa reste toujours discrète, mais se montre d'une grande efficacité dans sa capacité à déplier élégamment les nuances teintant les émotions des personnages. S'ils peuvent se montrer durs à l'égard d'autrui, ils ne sont en aucun cas méprisables ; leurs motivations, blessures et besoins paraissent en tout temps légitimes, mis en lumière par le très bon travail de Fred Renata à la caméra et de Katie Wolfe à la réalisation, tous deux Maoris. La proximité qu'ils parviennent à mettre en place entre le public et les personnages finit par établir un climat singulier et poignant duquel émerge la brûlante vérité. Confrontées à l'apparente incompatibilité de deux modes de vie, les conventions menacent de tout faire s'effondrer, mais la résilience de leur peuple, prompt à s'adapter au gré des changements sociétaux comme à celui de la colonisation, assure la pérennité de valeurs plus fortes que tout. (Anthony Morin-Hébert)

prod. Della and Goliath Productions
WOCHIIGII IO END OF THE PEACE
Heather Hatch | Canada | 2021 | 83 minutes
Que le documentaire judiciaire soit un genre récurrent du cinéma autochtone devrait moins encombrer nos exigences esthétiques habituelles que souligner l’urgence générale des enjeux soulevés par les cinéastes issu·e·s des premiers peuples. Heather Hatch, réalisatrice d’adoption haïda, ne livre pas ici un film au formalisme impressionnant ni au montage qui pourrait secouer ceux et celles qui frémissent à l’idée de regarder un énième documentaire de « têtes parlantes ». Or force est d’admettre que Wochiigii Io End of the Peace n’est pas moins traversé de toutes parts par son engagement et par son sens de l’écoute, montrant avec attention la lutte des communautés de West Moberly et de Prophet River en Colombie-Britannique, aux prises avec le projet hydroélectrique du Site C financé par la BC Hydro. Fruit de plusieurs décennies de lobbyisme facilité par la dynastie politique des Bennett (le père Wiliam Andrew Cecil est premier ministre de la province de 1952 à 1972, son fils Bill le sera de 1975 à 1986), la force d’inertie de la construction de ce troisième barrage est montrée comme monstrueuse par ses engrenages politiques ineffables, sa culture du secret, son blindage à l’épreuve de toute étude sérieuse ; les experts s’entendent depuis des décennies pour dire que la Colombie-Britannique ne présente aucun besoin énergétique qui nécessiterait la construction de ce projet pharaonique, au coût initial de 8 milliards, mais qui dépasse aujourd’hui les 16 milliards en dépenses publiques…
On voit le portrait. Quiconque s’est déjà intéressé à la politique canadienne et aux manières dont les nécessités économiques et la production d’infrastructures bousculent le bon sens, la science et la souveraineté territoriale sait comment les politiciens d’un océan à l’autre aiment s’afficher avec un casque de construction en bâtisseur des temps modernes. Or l’alliance pointée par Hatch est plutôt originale, montrant des « cowboys et des Indiens » s’allier autour de leur occupation de terres fertiles et ancestrales qu’ielles craignent de voir ensevelies sous les flots du réservoir planifié. Collectes de fonds, discussions en conseils de bande, pas même les efforts d’une quarantaine de nations autochtones de la Côte Ouest ne suffisent à faire plier la volonté politique provinciale, ici incarnée par Christy Clark, mainte fois représentée à affirmer vouloir porter le projet passé un « point de non-retour ». Ainsi Wochiigii Io End of the Peace, sous sa forme télévisuelle ponctuée par des prises de vue magnifiques sur le territoire, est structurellement redoutable, parvenant à montrer comment la politique kamikaze de la création d’emplois à tout prix fonctionne dans la création d’une inéluctabilité : dépenser jusqu’à tant que l’avortement du projet représente une perte plus importante que son éventuelle complétion.
Face à cette destinée préfabriquée, les protagonistes du film de Hatch n’ont plus qu’à lutter avec les armes du système judiciaire, se défendant d’un Canada hostile qui les poursuit en justice pour les faire taire, au point de porter l’affaire en cour suprême où toute défaite entrainerait une nouvelle jurisprudence quant aux droits autochtones. Faut-il espérer gagner le procès pour empêcher le Site C d’être construit, ou risquer de le perdre et, ce faisant, créer un précédent qui invaliderait toute poursuite future pour la protection du territoire ? Cette question impossible, Hatch en fait son dilemme central, déchirant, enrageant, montrant l’impuissance des communautés à s’engager et à faire durer le financement de leur tentative judiciaire jusqu’à l’épuisement de leurs ressources.
Le problème avec les documentaires judiciaires autochtones n’est pas formel. C’est qu’ils se terminent tous de la même manière. (Mathieu Li-Goyette)
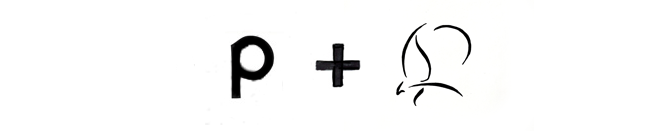
PARTIE 3
(Courts métrages Maoris - Programme #2,
Demon Mineral, Kawa,
Wochiigii Io End of the Peace)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
