

:: When the Phone Rang (2024)
J’ai rencontré Iva Radivojević mercredi après-midi à la Cinémathèque, et nous avons discuté de sa carrière autour d’une tasse de thé. Née à Belgrade à la fin des années 1980, cette documentariste globe-trotter a été expulsée de chez elle durant les guerres de Yougoslavie des années 1990. Elle a démarré sa carrière de cinéaste dans le nord-est des États-Unis au début des années 2010 alors qu’elle étudiait à l’Université de la ville de New York. Depuis ce temps, elle a réalisé plus de 40 films à travers le monde, abordant des questions de migration et d’appartenance d’une façon de plus en plus éloquente, ingénieuse et pertinente. Elle travaille aussi présentement à la rédaction d’une thèse de doctorat à la villa Arson de Nice.
*
Olivier Thibodeau : Pourrais-tu nous parler de tes premiers films sur Occupy Wall Street ? Quelle est l’origine de ces films ? Étais-tu directement impliquée dans le mouvement en tant qu’étudiante à l’Université de la ville de New York ?
Iva Radivojević : Je faisais toutes sortes de petits portraits à l’époque dans le cadre de la série ivaasks, pour laquelle je réalisais un film par semaine. C’était quelque chose que je faisais dans le cadre de ma pratique, pour rester en forme. Puis Occupy Wall Street est arrivé ; une de mes amies m’en a parlé et m’a suggéré d’aller faire un tour. En tant qu’étudiantes engagées dans tout ce qui touchait à la vie politique sur le campus, on s’y est rendues, et on s’est demandé comment attirer plus de gens. Mon amie, Martyna Starosta [co-réalisatrice d’Iva à l’époque], a suggéré : « Pourquoi ne pas filmer, pourquoi ne pas faire quelque chose dans le cadre de la série ivaasks ? » Alors, on a décidé d’y aller et de parler avec les gens. Nous ne le savions pas à l’époque, mais notre but était de propager le message à propos de ce qui se passait, car c’était très intéressant. Très excitant. Alors, on a fait cette petite vidéo. Cela fait déjà 13 ans. L’internet était différent à l’époque, tout était différent, les réseaux sociaux étaient différents. On a mis le film en ligne et, en une semaine, la vidéo avait 250 000 vues. Et les gens réagissaient. En visitant le lieu, on a rencontré des gens qui venaient de L.A., et qui avaient décidé de joindre le mouvement après avoir vu la vidéo. C’était vraiment excitant, et ça nous a fait réfléchir à notre responsabilité en tant que cinéastes, à ce dont on parlait et comment on en parlait puisque, clairement, les gens nous regardaient. C’était une période très excitante, mais aussi très instructive pour nous.
OT : Ton cinéma s’intéresse beaucoup aux migrations forcées et aux refuges temporaires. Dirais-tu que tes premiers film new-yorkais sont liés à cette idée d’éphémérité, ou peut-être à une sorte d’idéal communautaire ?
IR : Oui, c’est une bonne façon de voir ça. Je crois qu’il y a toujours un désir d’appartenance, particulièrement dans le cas des migrants et des personnes déracinées. Tu as raison de dire que ces films abordent le besoin de rassemblement, de collectivisme, de communautarisme, surtout que c’est l’une des choses que l’on perd en tant que personne déracinée. Je crois que tout le monde a besoin de camaraderie, de considération et d’un sentiment d’appartenance. Dans ce sens, c’était un moment très excitant pour moi.
OT : Dans chacun de tes films, dès Following Crickets (2010), on ressent très bien l’esprit des lieux, le sentiment d’appartenir aux espaces à l’écran. Mais en même temps, tes films traitent de la difficulté de trouver un chez-soi. Comment conjugues-tu ces deux idées contradictoires dans ton travail ?
IR : C’est une bonne question. Je relisais récemment l’essai d’Edward Said, Réflexions sur l’exil. Là-dedans, il parle de l’exil comme une façon d’être discontinue. Il mentionne aussi qu’une personne déracinée, ou une personne exilée, finit par interagir avec le monde comme si le monde entier lui était étranger. Et si le monde entier semble étranger, tu dois développer une nouvelle façon d’interagir avec lui, où tu essaies de t’intégrer partout. Pour en revenir à ta question, c’est un sentiment d’appartenance à un lieu où tu tentes de t’insérer, et même si tu ne t’intègres pas nécessairement, tu essaies quand même d’entrer en relation avec lui. Par exemple, dans Following Crickets, je vois le lieu. Je ne proviens pas de ce lieu, mais il me rappelle un lieu que je connais, et je développe cette relation, voire cette familiarité qui me fait sentir chez moi.
OT : On le sent bien. On sent que le film est à propos d’un chez-soi, mais d’un chez-soi imaginaire.
IR : Oui, ou à propos de la recherche constante d’une façon d’appartenir à un lieu ou à une communauté.

 :: Following Crickets (2010)
:: Following Crickets (2010)
OT : Tu as aussi fait plusieurs road movies, comme Let's See Where This Road Goes (2011) Between Colors of I (2013) ou Nattō (2018), où les personnages cherchent à trouver leur identité loin de la maison. Dirais-tu que leurs parcours s’apparentent aux errances des réfugiés dans tes films ou visent-ils plutôt à incarner une perspective coloniale ?
IR : Non, je crois que c’est lié à l’idée qu’une personne qui est expulsée de chez soi se retrouve en quelque sorte dans une errance perpétuelle, ou finit par errer constamment ; même quand elle s’installe quelque part, elle ne s’y établit jamais vraiment. C’est le fait de se retrouver toujours dans un nouveau lieu, de devoir s’adapter et adopter de nouvelles identités. Quand on regarde ces films, c’est comme si chacun d’entre eux possédait une nouvelle identité, nous permettant de prendre une certaine distance par rapport au lieu. Comme une personne italienne dans le Sud-Ouest des États-Unis, ou un Français exilé au Maroc… Ce sont toutes des identités déracinées qu’on retrouve dans ces films. Et je dirais que, peut-être, le fantôme ou le spectre qui saute de film en film, c’est moi qui revêts différentes identités. Moi et, par extension, toute personne déracinée.
OT : Par fantôme, tu veux dire la narratrice ?
IR : Oui, puisque la narratrice est toujours une personne désincarnée. Elle se dérobe à la vue, il s’agit d’un fantôme qui se promène à travers ces films.
OT : Dans tes films, tu utilises souvent des formes de narration subjective empreintes de lyrisme, et souvent, le sens que nous retirons des images provient presque exclusivement de la narration. Quel genre d’affirmation politique ou philosophique proposes-tu lorsque tu attribues la réalité des faits à une perspective spécifique ? Lorsque je regarde Aleph (2021), par exemple, le sens que je retire des images provient de la narration. Si l’on regardait les images seules, on ne saurait pas ce qu’elles signifient.
IR : Pour répondre à cela, je dois revenir au fantôme, puisqu’on parle de quelque chose de visible et d’invisible à la fois, n’est-ce pas ? Le fantôme t’introduit à sa façon de voir les choses et de rendre visible l’invisible, mais il se présente aussi à toi par le biais de ses observations.
OT : Il s’externalise à travers son processus de pensée.
IR : C’est ça.
OT : Dirais-tu que l’utilisation des écrans divisés ou l’idée de créer différents films à partir du même matériel, par exemple, MAGIK FIKUS (2012) et Evaporating Borders (2014) [le second contenant l’entièreté du premier], est une façon de dire que la réalité est le produit de notre perspective individuelle sur le monde ?
IR : Oui. Enfin, toi et moi sommes assis ici, et nous sommes en train de discuter, mais j’ai l’impression que nos façons de voir le monde diffèrent probablement de manière drastique, n’est-ce pas ?
OT : Probablement. Je n’ai pas vécu ce que tu as vécu.
IR : Bien sûr, mais je n’ai pas non plus vécu ce que tu as vécu.
OT : C’est vrai.
IR : Et même si nous avions vécu des expériences semblables, nous verrions toujours les choses de manière très différente. Et c’est là que réside la beauté de l’art en général, non ? Dans le fait qu’il nous permet d’aborder le monde à travers les yeux d’autrui, de voir le monde avec des yeux neufs.
OT : Quel est le lien entre MAGIK FIKUS et Evaporating Borders ? Tu as d’abord filmé MAGIK FIKUS, puis tu as créé tout un film autour de ça ?
IR : Non, j’ai tourné MAGIK FIKUS alors que je travaillais sur Evaporating Borders. C’était juste une petite soirée entre amis, et on s’est dit : « Pourquoi est-ce qu’on ne filmerait pas ? » Je n’avais pas initialement l’intention de l’intégrer à Evaporating Borders. Mais quelque part, au moment de monter, ça m’a semblé important de le mettre puisque c’est le moment dans Evaporating Borders, où l’on change de réalité, et où l’on montre ma vraie place dans cette société. C’est aussi un beau moment qui nous extirpe de la situation.
OT : Oui, exactement, ça nous sort du récit identitaire, mais en tant que tel, en tant que MAGIK FIKUS, c’est tellement un beau film. C’est une belle expérience. Et puis, quand tu le vois dans Evaporating Borders, ça reste un beau moment, mais qui est souillé par le contexte politique.
IR : C’est à la fois ces deux choses. C’est un beau moment, mais un moment souillé. En tant qu’œuvre isolée, bien sûr, on ne peut pas distinguer la souillure ; elle est souillée par le processus créatif puisque je l’ai tournée entre mes visites dans tous ces différents centres [de réfugiés]. Et donc, pour moi , le fait de pouvoir passer d’un monde à l’autre, c’est… un privilège.


:: MAGIK FIKUS (2012)
OT : Des films comme Themistokleous 88 (2017) et Evaporating Borders abordent spécifiquement le processus à travers lequel les discours identitaires créent des Autres. Comment cette critique se rapporte-t-elle, ou anticipe-t-elle les discours populaires actuels à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile ?
IR : Lorsque j’ai présenté le film hier, je disais qu’Evaporating Borders avait été tourné en 2013, et qu’il pré-datait la crise migratoire de 2015. Et j’ajouterais, pour revenir à ce que tu disais à propos de la perspective et de la réalité, que nous avons tous une façon très spécifique d’aborder le monde. Si tu es quelqu’un qui a vécu une expérience spécifique, qu’il s’agisse d’un déracinement ou de discrimination, j’ai l’impression que tu auras une certaine affinité avec ce type de sujets et ce type de considérations. Je ne sais pas s’il s’agit nécessairement pour moi d’anticiper quelque chose. Je crois que c’est plutôt une question d’être à l’affut de ce qui se passe.
OT : Ce doit être quelque chose que tu as constaté de première main en habitant en Grèce, près de Chypre.
IR : Je crois que chaque fois que tu es forcé de migrer, lorsque ce n’est pas un choix volontaire et que tu te retrouves dans un nouvel endroit, ça devient ta première expérience en tant qu’Autre, c’est ta première expérience de marginalisation. C’est une réalité très spécifique, et, bien sûr, je suis une personne blanche, donc mes expériences sont très différentes de celles d’un réfugié syrien ou d’un réfugié nigérien. Mais chaque identité spécifique possède ses propres stigmates. Je dirais que la vie en tant qu’Autre est quelque chose de très, très spécifique, et quelque chose qui te permet de développer une affinité avec tous les Autres.
OT : Il y a aussi la question du langage, qui est centrale dans ton œuvre. La narration de tes films s’effectue presque toujours dans une langue différente. Dirais-tu qu’il s’agit là d’une réflexion sur la façon dont le langage nous permet de faire sens du monde ? Par exemple, dans Utuqaq (2020), le tire réfère à une réalité qui n’a pas d’équivalent dans les langues non inuites.
IR : C’est une question complexe, je crois. Le langage est la façon la plus évidente et la plus directe de communiquer. Personnellement, je parle trois, presque quatre langues, mais jamais parfaitement. Je les parle toutes, mais soit avec un accent ou une sorte de « handicap ». Je ne maîtrise pas l’intégralité de ces langues, et ce partiellement puisque j’ai dû déménager à différentes périodes de ma vie. Et donc, le fait d’apprendre de nouvelles langues est une façon de créer sa propre façon de parler qui n’est pas parfaite. J’aime faire des erreurs en anglais. J’ignore les articles. Je sais que ce n’est pas juste, mais c’est simplement ma façon de faire, n’est-ce pas ? C’est une façon de réaffirmer ma présence spécifique dans le monde. Lorsqu’il est question des langues dans ces films, j’ai l’impression que ça renvoie à l’expérience migratoire, où l’on change constamment d’identité, de langue, etc. Mais dans Utuqaq, il y a aussi le fait qu’il s’agit d’un espace colonisé. Une certaine culture s’est imposée sur le territoire. Et donc, pour moi, le fait d’utiliser le mot « utuqaq » [qui réfère à la neige qui perdure toute l’année] est aussi un geste politique. En donnant la place centrale à la langue [kalaallisut]. J’aurais facilement pu narrer en anglais ou en danois.
OT : Peut-être est-ce une façon de redonner le territoire aux Premiers peuples ?
IR : Oui, mais c’est aussi parce que le film décentre les êtres humains. Le personnage principal est l’esprit de la terre. C’est comme le fantôme de la terre, le récit est raconté du point de vue de la glace. Et bien sûr, la glace ne va pas parler danois ou anglais. Et tous les scientifiques qui débarquent, leur exploration du territoire, sont liés au colonialisme. Alors, nous allons évidemment donner au personnage la langue des autochtones. C’est comme une réaffirmation des pouvoirs, une réappropriation des pouvoirs.
OT : Et dirais-tu qu’il y a aussi un choc entre les types de langages qui sont utilisés dans le film ? D’un côté, il y a cette langue poétique. C’est celle du fantôme. Et de l’autre, il y a le langage scientifique des « visiteurs ».
IR : Oui, je crois que c’est une bonne observation puisqu’il y a quelque chose de très scientifique, de très modéré, de très rigide, mais il y d’autres façons d’être qui sont plus intuitives, plus ouvertes, plus en harmonie avec la nature. Je crois que c’est l’une des dynamiques qu’on retrouve aussi dans le film.
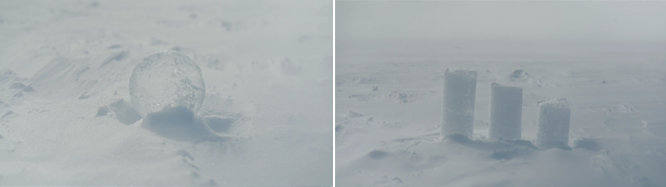

:: Utuqaq (2010)
OT : Tes narrateurs parlent souvent d’un « pays qui n’existe pas » en référence à la Yougoslavie, où tu es née. Qu’est-ce que cela signifie pour toi d’être née dans un pays qui n’existe pas ? Et qu’est-ce que cela signifie pour tes sujets, à une époque où plusieurs pays comme la Palestine, la Syrie et l’Ukraine sont en train de se faire détruire ?
IR : Pour en revenir à Edward Said, c’est comme une douleur constante et insurmontable. Et bien qu’on puisse dire que, même si la Yougoslavie s’est effondrée, ces pays existent encore, ce ne sont pas les pays où j’ai grandi. J’ai aussi des origines mixtes à l’intérieur de ces pays, donc je ne peux pas revendiquer l’appartenance à un endroit, pas plus que je ne peux m’identifier à aucune de ces entités. Ce à quoi je m’identifiais a été brisé d’une certaine façon, n’est-ce pas ? Et ça peut sembler handicapant, mais ça peut aussi être stimulant, puisque tu deviens fluide. Tu as une faculté accrue de t’identifier aux choses, ou une façon unique de connecter. Si le monde entier t’est étranger, où se trouve ton chez-toi ? Tous ces endroits sont ton chez-toi.
OT : Et dirais-tu que les gens avec qui tu discutes, les Palestiniens d’Evaporating Borders, par exemple, pensent la même chose ?
IR : Je crois que oui. Et c’est quelque chose sur lequel je travaille et sur lequel j’écris en ce moment : comment ressent-on précisément l’expérience du déracinement et de l’exil ? C’est là que je retourne chez Dubravka Ugrešić, qui était une romancière croate qui s’est exilée volontairement puisqu’elle était considérée comme une traitresse. Elle écrivait à propos de la Yougoslavie d’après-guerre, et elle décrit l’expérience de l’exil ou du déracinement comme une sorte de rêverie permanente où ta réalité, ta langue et ton identité changent constamment. Et donc, ta perception de la réalité est décalée ; le passé, le présent et le futur commencent à se mélanger, des gens que tu n’as jamais vus ont l’air familiers, les gens et les endroits que tu as connus deviennent méconnaissables. Toute ta perception de la réalité et ton expérience de vie commencent à s’apparenter à un rêve. Et je dirais que c’est quelque chose qui touche à mon expérience, et j’ai l’impression que la plupart des personnes déracinées ressentent la même chose. Le fait de se retrouver dans une réalité altérée.
OT : Et tu rédiges présentement ta thèse, n’est-ce pas ?
IR : Oui.
OT : Quel est ton sujet ?
IR : Je m’inspire des idées de Dubravka Ugrešić, mais je les applique au monde du cinéma. Je m’intéresse à la façon dont l’expérience du déracinement ou de l’exil de cette rêverie se traduit dans le langage somatique. Je parle de la fragmentation, de notre expérience du temps, de la poétique liée spécifiquement à l’expérience du déracinement, etc. Je m’intéresse au langage du déracinement qu’on retrouve dans le cinéma.
OT : Et quels types de films utilises-tu en exemples ?
IR : Je vais me pencher sur des cinéastes comme Basma al-Sharif, qui est une réalisatrice expérimentale palestinienne ; je vais m’intéresser au travail de Miko Revereza ; je vais m’intéresser à Cecilia Vicuña, qui est une poétesse et cinéaste chilienne. Voici quelques-unes des œuvres que je compte explorer. Mais il me reste encore deux ans !
OT : When the Phone Rang (2024) est ton plus récent film. C’est une œuvre partiellement autobiographique, et en tant que telle, elle développe un bel équilibre entre le sentiment d’appartenance et le deuil du chez-soi. Mais c’est aussi un film à propos des défaillances de la mémoire et du besoin d’enregistrer. Étais-tu plus motivée par le désir d’immortaliser ta propre histoire ou de réfléchir sur la façon dont les migrations forcées tendent à effacer la mémoire des gens ?
IR : Je crois que ce que j’avais envie de faire avec ce film, c’est d’exprimer ou de documenter le chagrin du déracinement. Et je réfère toujours à ce genre de déchirure comme à une petite mort, où l’on te demande de te séparer de tout ce que tu connais. C’était ça qui m’a poussée à raconter cette histoire. Mais d’un point de vue personnel, je crois que je voulais créer un endroit où pourraient vivre tous les gens que j’ai perdus, pour m’en rappeler.
OT : Tu parlais tantôt de l’identité comme d’un lieu où le passé, le présent et le futur se mélangent. Or, le temps est très important dans tes films. On voit souvent des horloges et des montres dans tes plans. Mais elles tendent à révéler une vision cyclique du temps, comme avec le retour constant à 10h36 [dans When the Phone Rang] ou les parallèles que tu traces entre les mouvements sociaux historiques et contemporains dans Are You With Me? (2011) Ces leitmotivs visent-ils à réfléchir au concept de récurrence temporelle ou à l’idée d’une identité où se mêlent le passé et le présent ?
IR : Oui, je dirais que c’est exactement cela. Je crois que tous ces films, même dans leur structure, sont construits d’une façon non linéaire qui nous permet de ressentir le temps d’une façon différente. Ce n’est pas un déroulement horizontal, mais quelque chose qui tourne en boucles, quelque chose qui se déforme. Mais c’est aussi quelque chose qui remet en question la vision linéaire et capitaliste du temps. Dans When the Phone Rang, on revient tout le temps au même instant, aux différentes choses qui se déroulent. Et il s’agit aussi là d’un commentaire sur la faillibilité de la mémoire. Mais je crois surtout, et ça fait partie de cette idée d’un cinéma déraciné, que nous appréhendons tous le temps d’une manière différente. Notre temps est en suspens, d’une certaine façon.
OT : Eh bien, vous avez tendance à vivre en suspens, entre différents pays…
IR : …entre différentes cultures, entre différentes langues… Chaque langue possède sa propre temporalité, sa propre façon de l’aborder, dans sa cadence. Et donc, tu es toujours dans un entre-deux, pour ainsi dire.
OT : Il y a un plan récurrent de la mer ondulante dans tes films. Tu l’utilises souvent comme insert, dans Evaporating Borders et Notes from the Border (2015), par exemple. Et il semble avoir plusieurs significations, il semble évoquer l’idée de migration, mais aussi les dangers qui attendent les migrants. Comme une sorte de tombe aquatique. Pourquoi reviens-tu toujours à cette image ?
IR : La mer, en tout cas là où je vis, en Grèce, mais aussi à Chypre, c’est par là que les gens migrent. C’est le chemin des migrants. C’est la connotation la plus évidente. Mais il y aussi quelque chose à propos de la fluidité de l’eau. Bruce Lee avait abordé le sujet, n’est-ce pas, l’idée d’être fluide comme l’eau ? Les migrants doivent être fluides pour s’adapter, pour survivre ; je crois que c’est un mécanisme de survie. Alors, c’est ça que représente la mer pour moi : à la fois un piège et une forme de liberté. Un chemin dangereux, mais qui mène à la liberté. Encore une fois, il s’agit de deux idées contradictoires qui coexistent en même temps.

:: Notes from the Border (2015)

:: Evaporating Borders (2014)
OT : Dans Aleph, il y a plusieurs trucs de montage qui suggèrent une continuité spatiale entre des lieux très éloignés. On vient de parler de l’expérience migratoire et de fluidité. Est-ce que c’est en référence à cela, ou s’agit-il d’une forme d’utopie, d’un monde où les frontières n’existent plus ?
IR : J’aime ça. Oui, j’aime cette idée. Je crois que le film essaie aussi de nous dire, ou de nous rappeler constamment, que nous sommes dans un rêve, et dans un rêve, tu peux sauter d’un endroit à l’autre, et différentes choses sont possibles. Tu peux être à plusieurs endroits en même temps, et, encore une fois, le temps est déformé, l’espace est déformé, et tu ressens une sorte d’appartenance globale, où tout est partout en même temps.
OT : Aleph est un film magnifique. C’est un périple à travers différents espaces, différentes cultures, auprès de différentes personnes. C’est vraiment superbe, et ça redonne de l’espoir, contrairement à Evaporating Borders, qui plombe le moral.
IR : Oui. Je crois qu’Aleph est la conséquence d’Evaporating Borders, puisque j’avais envie de faire quelque chose de diamétralement opposé. Alors qu’Evaporating Borders pose la question, à savoir : « Qui est responsable de la beauté du monde ? » Aleph répond : « Voici comment le monde peut être beau. » C’est une célébration de la différence, de la multiplicité, de la polyphonie.
*
Ne manquez pas la discussion avec Iva qui se tiendra ce soir à 17h30 dans la salle Norman-McLaren de la Cinémathèque dans le cadre de la rétrospective organisée par les RIDM. Aleph sera aussi projeté ce soir à 19h30 dans la salle Fernand-Seguin. Vous pouvez également visionner gratuitement la plupart des courts métrages de la réalisatrice sur sa page web (https://ivaasks.com/).
Toutes les images, gracieuseté d'Iva Radivojević.
Traduit de l'anglais par Olivier Thibodeau.
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
