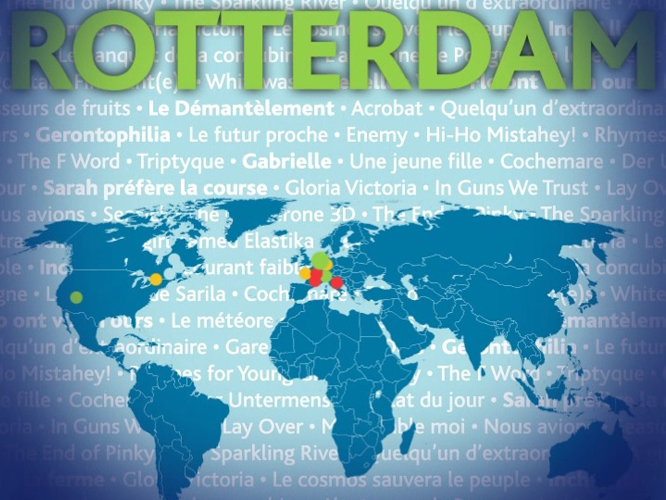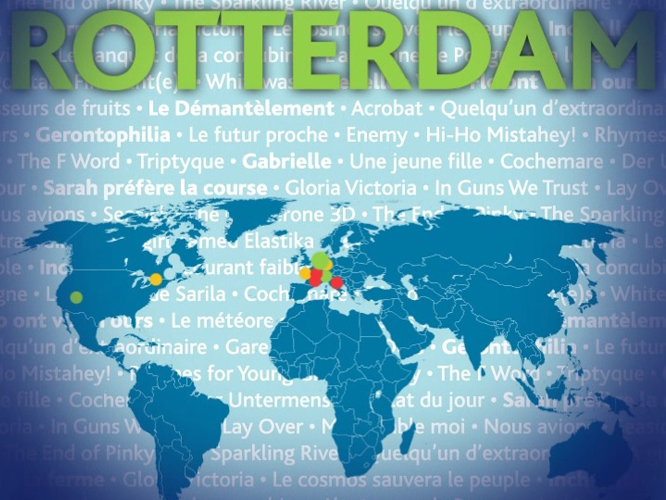
Les occasions de se réjouir du rayonnement « planétaire » des films québécois se succèdent dans les médias. Et il n’y a pas que les journaux et les téléjournaux de renom pour nous rapporter les communiqués émis par les boîtes de communication, les distributeurs et les cinéastes. Il fallait voir l’animation produite par la SODEC et diffusée sur Internet avec l’accroche « Comme nous, vous êtes fiers du cinéma québécois! »
1, moment euphorique institutionnel qui faisait suite au choix du film
Gabrielle pour représenter le Canada dans la course aux Oscars. Sur un air digne de
Sesame Street avec piano, clappements de main et sifflements, un Power Point agite les mots « Le cinéma québécois rayonne partout sur la planète et 8 millions de personnes en sont fières ». Une mappemonde apparaît ensuite sur laquelle nous sont montrées par des points les nombreuses villes canadiennes, américaines et surtout européennes où notre cinéma s’illustre, redéfinissant par le fait même de manière très étroite l’expression « partout sur la planète ». Cette formule simpliste utilisée par une institution de financement ne laisse-t-elle pas déjà entrevoir comment on limite la valeur du cinéma à des données et à un espace physique et géographique plutôt que de reconnaître des œuvres vivantes trouvant des résonances dans d’autres cultures du monde?
Ces accès de fierté alternent avec les proclamations de « crises » que traverserait notre cinéma chaque fois qu’on se rend compte que le public québécois n’est pas au rendez-vous. Entre ces deux pôles émotifs, je voudrais – non sans quelques détours et digressions aussi teintés de subjectivité – tenter d’aborder et d’expliquer un certain nombre de thèmes pour mieux comprendre notre cinéma.
Tout d’abord, on se demandera ce qui rend ces « crises » possibles, ce qui donnera l’occasion de (re)prendre conscience des limites géographiques du Québec ayant une incidence déterminante sur le potentiel de son cinéma. Ensuite, on tentera de comprendre l’orientation que prend notre cinéma à l’étranger sous l’impulsion des institutions publiques, des producteurs, des distributeurs et des cinéastes eux-mêmes. Une typologie binaire et quelque peu sommaire permettra d’associer, d’un côté, nos films de type hollywoodien aux Oscars et, de l’autre côté, nos films anti-hollywoodiens aux festivals. Enfin, il s’agira d’analyser et de critiquer les sujets, les enjeux et surtout les types de récits qui semblent assurer un succès commercial ou d’estime, non pas tellement dans le but de rejeter ces films que de comprendre pourquoi notre cinéma est tant en proie à l’uniformité et à l’absence de variété, au « même ».
Une crise systémique et permanente
Il semble tout naturel comme individu et comme société de se percevoir comme au centre de l’univers. « Tu n’es pas le nombril du monde. » « C’est évident, je le sais. » Et plein d’assurance on retourne immédiatement à ses petites affaires en se comportant comme un nombril. La SODEC se comporte de la même manière en affirmant tout bonnement que 8 millions de personnes sont fières du rayonnement du cinéma québécois partout sur la planète. Rappelons quelques évidences contre-nombrilistes. Le Québec compte 8 millions d’habitants, c’est vrai. Mais de ce nombre, une partie seulement pense et vit en français. De ce sous-ensemble, c’est une fraction qui s’intéressera au cinéma québécois, et encore, le plus souvent attirée par les films grand public et la publicité qui les entoure. Le Québec n’est qu’une province parmi d’autres dans le Canada. Qu’est-ce qu’un public potentiel de moins de 8 millions de personnes comparé aux énormes marchés américain (317 millions), chinois (1 350 millions), indien (1 277 millions) ou européen (742 millions)? Au plan de la production, comment concurrencer des pays où le privé peut investir dans un seul film ce que nous n’avons pas pour l’ensemble de la production annuelle au Québec?
Incendies, de Denis Villeneuve a coûté environ 6.8 millions de dollars (avec une grande part de fonds publics) et a rapporté environ 6.8 millions de dollars. À titre de comparaison, en 2005, le film
King Kong de Peter Jackson a coûté 207 millions de dollars (fonds privés) et a rapporté 550.5 millions. Au-delà du simple aspect financier, comment penser rivaliser avec des cultures, des systèmes d’éducation et des industries qui n’ont aucune commune mesure avec les nôtres?

::
Le Démantèlement (Sébastien Pilote, 2013)
Le Québécois susceptible et sensible se demandera avec raison ce que j’essaie ici de démontrer. Je ne suggère pas le suicide culturel, au contraire, même peu nombreux nous avons autant de potentiel imaginaire et créatif qu’ailleurs. Résistons, faisons toutes les œuvres artistiques que nous voulons, affichons et proclamons partout nos valeurs progressistes et modernes, mais je dis qu’il se pourrait bien qu’en ce qui a trait à la conquête – même très symbolique, commerciale ou culturelle – du monde et de la planète, l’enthousiasme soit très démesuré. D’une part, nous serons toujours une minorité dans le Canada et l’Amérique; une goutte dans l’océan planétaire. D’autre part, ayons à l’esprit que des films comme
Gabrielle de Louise Archambault,
Ressac de Pascale Ferland,
Le Démantèlement de Sébastien Pilote ou
Camion de Raphaël Ouellet seront et resteront absolument invisibles, inoffensifs dans les immenses blocs culturels évoqués – même en France.
En tenant compte de ces considérations et d’autres encore – la précarité identitaire et culturelle, un grand nombre d’artistes et de techniciens pour un public anémique, la compétition redoutable de nos voisins américains, l’industrie non rentable, etc. – il apparaît que les institutions publiques du Canada, du Québec et de Montréal sont extrêmement généreuses et même soucieuses de résister culturellement. D’un autre côté, il est vrai que cette résistance a ses limites.
Le Canada demeure depuis toujours un «
domestic market ». En l’absence de volonté politique, jamais nous ne sommes arrivés à nous affirmer face aux studios américains. La domination du cinéma américain sur nos écrans n’est pas un mythe. En 2010, la part de marché nationale totale des films canadiens s’élevait à 3,1 %
2. Et lorsque le cinéma québécois (sous-ensemble du 3.1 %) gagne des parts de marché, cela se fait au détriment du cinéma international (France et autres) et non à celui du cinéma hollywoodien. Notre système se contente de rendre possible l’existence d’un film mais il n’assure pas son rayonnement et son impact réel sur son propre territoire. La politique la plus simple consiste donc à financer des masses de films, de la scénarisation à la distribution, en ne se souciant guère de leurs résultats en salles, à savoir d’assurer par des mesures préventives qu’ils seront accessibles plus de deux semaines dans une poignée de salles spécialisées. Les causes de ce retrait sont politiques et ce qu’on considère comme des « crises » n’est en fait qu’une réalité systémique permanente.
Dans cette optique, faire reposer son jugement « objectif » sur les mesures des rendements au box-office ou les présences dans les festivals et s’émouvoir constamment du rayonnement du cinéma québécois est une stratégie douce de contournement qui permet, sur le mode de la célébration, de la positivité et de la publicité, de respecter les règles néolibérales de non-intervention. Les autorités politiques et l’industrie « privée » (entre guillemets parce qu’elle croit beaucoup plus au profit qu’à l’investissement) croisent les doigts et souhaitent naïvement conserver ou gagner des parts par la simple renommée tout en respectant les règles du libre marché – une situation très paradoxale puisque notre cinéma dans sa totalité sera toujours lourdement subventionné. Les chiffres ponctuels sortis de leur contexte et le capital symbolique permettent d’entretenir indirectement plusieurs illusions en évitant un engagement trop peinant, par exemple : que notre cinéma peut gagner des parts de marché à l’étranger, qu’il peut gagner des parts de marché au Canada sur un mode de croissance ou qu’il pourrait être lucratif, que notre cinéma (et donc le système qui le soutient) est d’une qualité exceptionnelle et est apprécié dans le monde.
Les « pro » et les « anti » action à la recherche de marchés
Puisque nos nombreux films financés par le public ne trouvent pas de place dans le circuit régulier des salles, le milieu a fini par viser le succès sur d’autres territoires grâce à deux niches principales : les grands événements comme les Oscars et Cannes; le circuit des nombreux festivals (y compris le FNC, le TIFF, le FFM, etc.). Pour atteindre à la fois les Oscars, quelques autres grands festivals (puis le marché local en publicisant le succès « planétaire »), on prise un certain type de
storytelling hollywoodien que le public peut suivre selon une expérience de réception commune. La mise en scène et le traitement des images participent également à ce réconfort en restant dans les limites des acquis du documentaire et du film d'auteur qu’on hybride
– dans la mesure où le budget le permet – avec l’esthétique hollywoodienne ou publicitaire. Incendies est un beau modèle de film qui se conforme aux conventions actuelles de l’image et de l’éthique en même temps qu’aux procédés structurels éprouvés du récit. À partir de la mort de la mère et de secrets révélés (qui touchent à la naissance, donc le cycle naturel du début et de la fin d’une histoire), il s’agit de faire retour en arrière pour expliquer la situation présente. En alternant de manière symétrique, didactique et lisible les épisodes autour d’un point culminant et vers un dénouement, la liaison causale est on ne peut plus facile à suivre. D’autres titres de micro_scope pourraient être rajoutés à cette catégorie de films comme
Monsieur Lazhar,
Inch’Allah, et
Gabrielle. On pourrait aussi nommer
Rebelle de Kim Nguyen et même
C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée. Tous ces films au look « indie international » ont été sélectionnés pour représenter le Canada dans la course aux Oscars à l’exception d’
Inch’Allah.
 :: Monsieur Lazhar
:: Monsieur Lazhar (Philippe Falardeau, 2011)
À l’autre bout du spectre se trouvent les films qui font la grande tournée mondiale des innombrables festivals, les anti-hollywoodiens. Ce cinéma obsédé par notre contemporanéité se définit par l’« anti » et passe par toutes sortes de degrés de « déformation réglée ». Dans cette déviance réglée du récit traditionnel (hollywoodien dirions-nous en cinéma), l’écart devient la règle. Dans ces films, on y met au défi la capacité du spectateur de configurer lui-même l’œuvre que l’auteur semble prendre un malin plaisir à défigurer. Dans ce cas extrême, c’est le spectateur, quasiment abandonné par l’œuvre, qui porte seul sur ses épaules le poids de la mise en intrigue
3. Ce type de cinéma « nouveau » chemine inconsciemment (et donc souvent maladroitement et sans maîtrise) sur la route ouverte il y a plus d’un siècle par des littéraires, des metteurs en scène et autres artistes et penseurs. Aujourd’hui encore, une bonne partie de nos artistes continue de faire de l’écart un dogme plutôt que de varier l’application des conventions du cinéma ou du récit traditionnel. Un cinéaste comme Denis Côté confirme cette tendance lorsqu’il déclare en recevant son prix à l’innovation à Berlin : « Ça fait 115 ans que le cinéma existe et à chaque fois que je fais un film, j'essaie de m'assurer qu'il y a dans mes films quelque chose de nouveau et qui, potentiellement, n'a jamais été vu. Ce prix prouve que je suis allergique aux choses conventionnelles et que j'ai raison de l'être »
4. Mais à quoi au juste ces cinéastes sont-ils allergiques?
Tous les auteurs n’ont pas la même obsession de l’écart du récit, mais tous se rejoignent sur leur emploi rétif de l’action, l’omniprésence de l’impuissance et de la mélancolie. La tendance à écarter l’action s’explique par la recherche de la neutralité éthique, par la crainte d’afficher des jugements moraux. Or l’action touche inévitablement au système de valeurs comme le souligne Paul Ricœur : « Il n'est pas d'action qui ne suscite, si peu que ce soit, approbation ou réprobation, en fonction d'une hiérarchie de valeurs dont la bonté et la méchanceté sont les pôles » (t. 1, p. 116). Il est impossible d’échapper au système de valeurs, même en s’éloignant de l’action au sens où on l’entend habituellement, par exemple en éclipsant le sens des interactions, en isolant un personnage; en étirant le temps dans la solitude pour mieux illustrer les affects subconscients et inconscients, l’évanescence ou l’indicibilité; en insistant sur l’inachèvement des désirs, des affections, des actions, etc.
Ce qu’on doit dire, et là-dessus il faut suivre Paul Ricœur, c’est que cette recherche plus fine des caractères enrichit la notion d’action, elle ne l’abolit ni ne la dissout :
« Par action, on doit pouvoir entendre plus que la conduite des protagonistes produisant des changements visibles de la situation, des retournements de fortune, ce qu’on pourrait appeler le destin externe des personnes.
« Est encore action, en un sens élargie, la transformation morale d’un personnage, sa croissance et son éducation, son initiation à la complexité de la vie morale et affective.
« Relèvent enfin de l’action, en un sens plus subtil encore, des changements purement intérieurs affectant le cours temporel lui-même des sensations, des émotions, éventuellement au niveau le moins concerté, le moins conscient, que l’introspection peut atteindre. »
Cette neutralité ne se manifeste pas de la même manière dans les films où l’on recherche moins évidemment la déviance et où les acteurs sont aux prises avec des problèmes moins abstraits, dans ces cas il faudrait davantage parler de « retenue éthique ». Que les films touchent à des sujets d’actualité ou non et que leur esthétique soit plus près du film d’auteur ou de Hollywood, la grande majorité n’échappent pas à cette difficulté de décrypter un sujet en dévoilant toute l’étendue de son spectre, sans tomber dans les jugements faciles – par exemple en réhabilitant des victimes impeccables. Dans plusieurs films au scénario prudent, une dose de complexité calculée et quelque teinte de critique suffisent à se prémunir contre les accusations de simplisme, mais on s’y garde bien de plonger au plus profond de la nature humaine, au risque de rencontrer le coup de grisou comme disait Cocteau.

::
Bestiaire (Denis Côté, 2012)
Le cinéma qui affiche d’ordinaire un jugement moral plus visible sur des sujets chauds d’actualité va bassement relayer les opinions et le discours dominants (ou pire les vérités de notre époque). En ce sens, il se situe bien plus au plan de la communication, telle une profession médiatique, comme le journalisme, que celui de l’art. Pour aller plus loin encore, certains font figure d’animateurs culturels en se faisant les justificateurs de ce qui est – pour reprendre les termes d’Annie Lebrun. Si on dépeint un handicapé, un vieux, un pauvre, un Palestinien, un immigrant, c’est très souvent pour les réintégrer sur le mode de la victimisation (et en jugeant leurs bourreaux), avec la subtilité d’une publicité du gouvernement ou le reportage d’un journaliste de Radio-Canada (quelques cinéastes à la mode sont d’ailleurs passés par la Course destination monde).
C’est donc un compromis éthique qui relie l’ensemble des films québécois et qui constitue un problème, ou au moins une faiblesse, une indigence, – disons de
Bestiaire de Denis Côté, à
Gabrielle de Louise Archambault en passant par
Incendies de Denis Villeneuve et
Sarah préfère la course de Chloé Robichaud. La question qui se pose alors, c’est de savoir pourquoi les institutions mettent en valeur ces films. Y a-t-il un espoir de voir un plus large éventail de films ?
La valeur-notation-prix du film
L’évolution des politiques culturelles des dernières décennies laissent penser que les revirements qualitatifs, esthétiques et éthiques ne viendront pas des institutions. Dans son livre sur le cinéma québécois
5, Christian Poirier démontre que « deux objectifs motivent habituellement l’intervention des États québécois et canadien dans la sphère culturelle:
1- l’identité, les valeurs, l’image;
2- la croissance économique, le développement des industries culturelles ».
Avec le temps, on observe que « ces deux dynamiques se déploient, se croisent, s’influencent » et que cependant « l’approche économique entre de plus en plus en contradiction avec l’approche identitaire. » L’identité et la culture ne deviennent qu’un porte-étendard, un argument de vente, alors que ce qui structure réellement le système de haut en bas, la réelle valeur, c’est la logique de marché capitaliste et l’obsession pour l’expertise.
Roland Gori résume bien comment nous en sommes venus à vider le concept de « valeur » de toute substance : « Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle que la valeur véhicule l’idée de prix et se dépouille progressivement de ses significations antérieures, idéaux héroïques, aristocratiques, sociaux, politiques ou éthiques. Le lien étroit de la valeur et de la mesure, de la valeur et du prix, s’est imposé avec l’émergence d’un type de rationalisme, le rationalisme économique et instrumental. Le néolibéralisme a poussé jusqu’à l’absurde cette logique, et d’une manière extrême puisque la valeur-notation-prix s’est insérée dans tous les secteurs, dans toute la chaîne existentielle de l’être humain, en chacun des maillons de son existence »
6.
En concédant au moins que tout appareil bureaucratique ait besoin d’outils de mesure les plus neutres possibles, par souci d’équité, et que le fin jugement esthétique ne semble pas l’apanage des institutions, on peut toutefois se demander dans quelle mesure les autres responsables ou délégués participent à promouvoir des films autrement que pour répondre à des modes, des publics spécialisés et des critères commerciaux. Il est difficile le chemin obligé du scénario entre les mains des institutions, des pairs, d’un producteur et d’un distributeur jusqu’à un public encore réceptif.
Comment donc expliquer cette contamination à divers degrés d’un enthousiasme pour le succès réduit à la valeur-notation-prix, pour des indices financiers et « culturels » creux? Non seulement de la part des institutions publiques et des commerçants directs (comme les propriétaires de salles), des quasi-commerçants comme les producteurs et les distributeurs, mais aussi des artisans (toutes les associations professionnelles liées au cinéma, incluant les réalisateurs) et même au bout de la chaîne des critiques, qui sont supposément désintéressés.
Rêver d’esprit critique, de jeu et d’imaginaire
À ce dernier niveau, celui de la critique ou de la réception, rien ne vient vraiment bousculer ou changer les réflexes des publics – populaires comme « pointus ». La variété est limitée parce que bon nombre de films qui ne rentrent pas dans les quelques cases considérées comme viables ne se rendent pas à l’affiche ou pire… n’ont même pas le contexte culturel et systémique pour exister. Pas étonnant que les critiques – peu importe leur « allégeance » – soient alors prévisibles et consensuels selon leur école puisqu’ils critiquent des films formatés visant des publics formatés (du banlieusard qui va au Cineplex à l’universitaire qui fréquente les festivals) dont ils font eux-mêmes partie. Les rares semblants de dissensions viennent le plus souvent de l’opposition entre films pour grand public (
Les Boys) et films « difficiles » pour public cultivé (
Le Météore). Les institutions et les boîtes de pub rajoutent leurs discours parasitaires à ce ronron médiatique, leurrant le public en le convainquant quelquefois d’aller voir des films qu’il trouvera ordinaires alors qu’on crie partout à l’excellence, nuisant ainsi au
branding « film québécois ».
 :: Sarah préfère la course
:: Sarah préfère la course (Chloé Robichaud, 2013)
Peut-on rêver voir plus de films qui cesse d’être moralisateur tout en déclarant être neutre et où l’expérience esthétique assume à la fois l’action (au sens large défini plus haut), les problèmes sociaux ou artistiques, l’esprit critique, le jeu, l’imaginaire? Les artistes toujours intéressés par un travail de réflexion éthique et esthétique trouveront-ils encore l’espace pour s’exprimer? Les portes sont-elles grandes ouvertes seulement pour les rebelles de service, les plasticiens et les animateurs culturels? Peu importe le genre adopté, les cinéastes devraient pouvoir jouer avec le système des valeurs, saisir à bras-le-corps les enjeux actuels, prendre de front les conventions, les convictions, les ambiguïtés, les perplexités pour en dissoudre et en résoudre un certain nombre.
Entre ceux qui recherchent la neutralité en s’enfonçant dans l’impuissance et le solipsisme et ceux qui relaient des jugements communs en feignant l’intérêt pour l’Autre, se trouve-t-il des cinéastes pour critiquer les lieux communs et les discours préfabriqués à la mode, pour explorer les complexités et les contradictions des individus et des groupes?
Entre l’art complaisant écrit au « je » et l’art populiste interchangeable, on souhaiterait plus de place à des artistes qui recherchent un plus juste équilibre entre soi et l’autre, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre la nouveauté et la traditionnalité, entre l’action et la contemplation. Ni en marge, ni au centre, mais dans le perpétuel mouvement d’échanges entre la marge et le centre. De toute manière notre cinéma n’est pas rentable, pourquoi ne pas sortir des niches et de l’autopromotion ?

1
http://www.sodec.gouv.qc.ca/gabrielle.html
2 Téléfilm Canada, Résultats pour l’exercice 2010-2011, communiqué du 23 novembre 2011.
3 Je reprends ici les termes de Paul Ricœur au sujet du lecteur, dans Ricœur, Paul. 1991.
Temps et récit, tome 1. Paris : Éditions du Seuil. p. 146. Les autres citations sont aussi tirées des tomes 1 et 2 de
Temps et récit.
4 Petrowski, Nathalie. 2013. « Denis Côté remporte l'Ours d'argent de l'innovation »,
La Presse (16 février).
5 Poirier, Christian. 2004.
Le Cinéma québécois: à la recherche d'une identité? Tome 2: les politiques cinématographiques. Québec : PUQ. p. 7
6 Roland Gori,
La fabrique des imposteurs, LLL, p. 99.
Biographie de l'auteur
Diplômé en histoire à l’UQAM, c’est comme amateur de cinéma qu’Antoine fait ses premières critiques de films pour Canoe.ca en 2005. Il ouvre son blogue cinéma The Stalker (en hommage à Tarkovski) en 2006, puis il collabore au magazine
Hors Champ de 2008 à 2012. En 2010, il organise à la Cinémathèque québécoise l’événement
Flashback sur le Festival international du film de Montréal 1960-67. En 2014, il participe à faire connaître le fondateur de la Cinémathèque québécoise, Guy L. Coté, en participant comme historien à la création du site
guylcote.com et comme programmateur-invité du cycle Guy L. Coté à la CQ. Depuis 2013, il écrit sur le cinéma pour
Liberté.